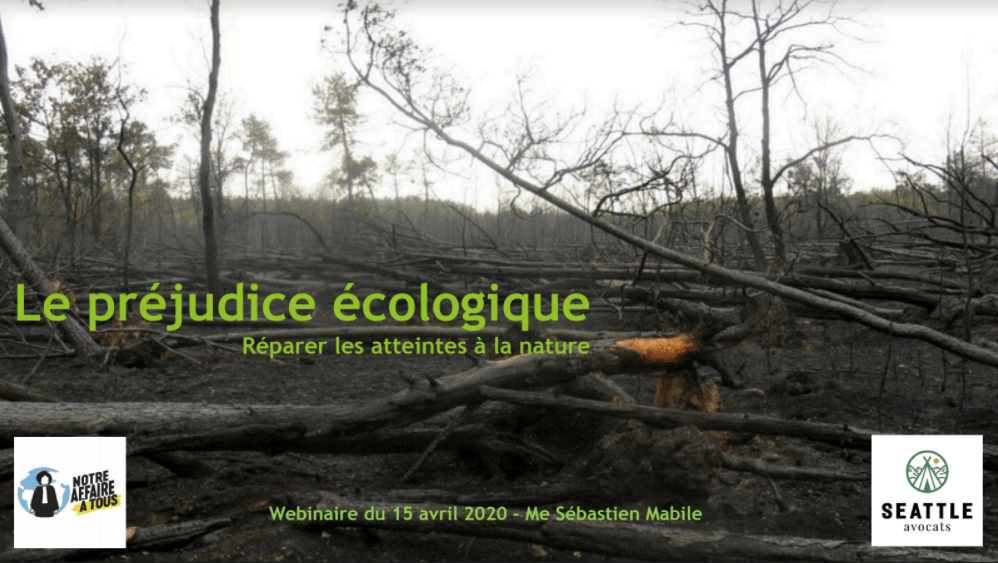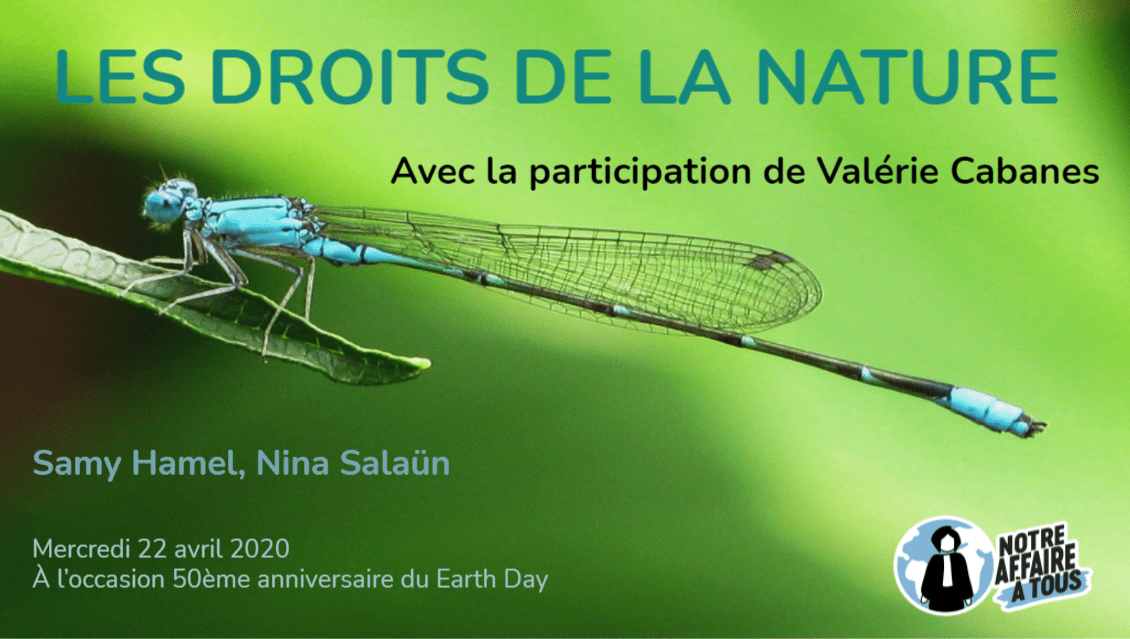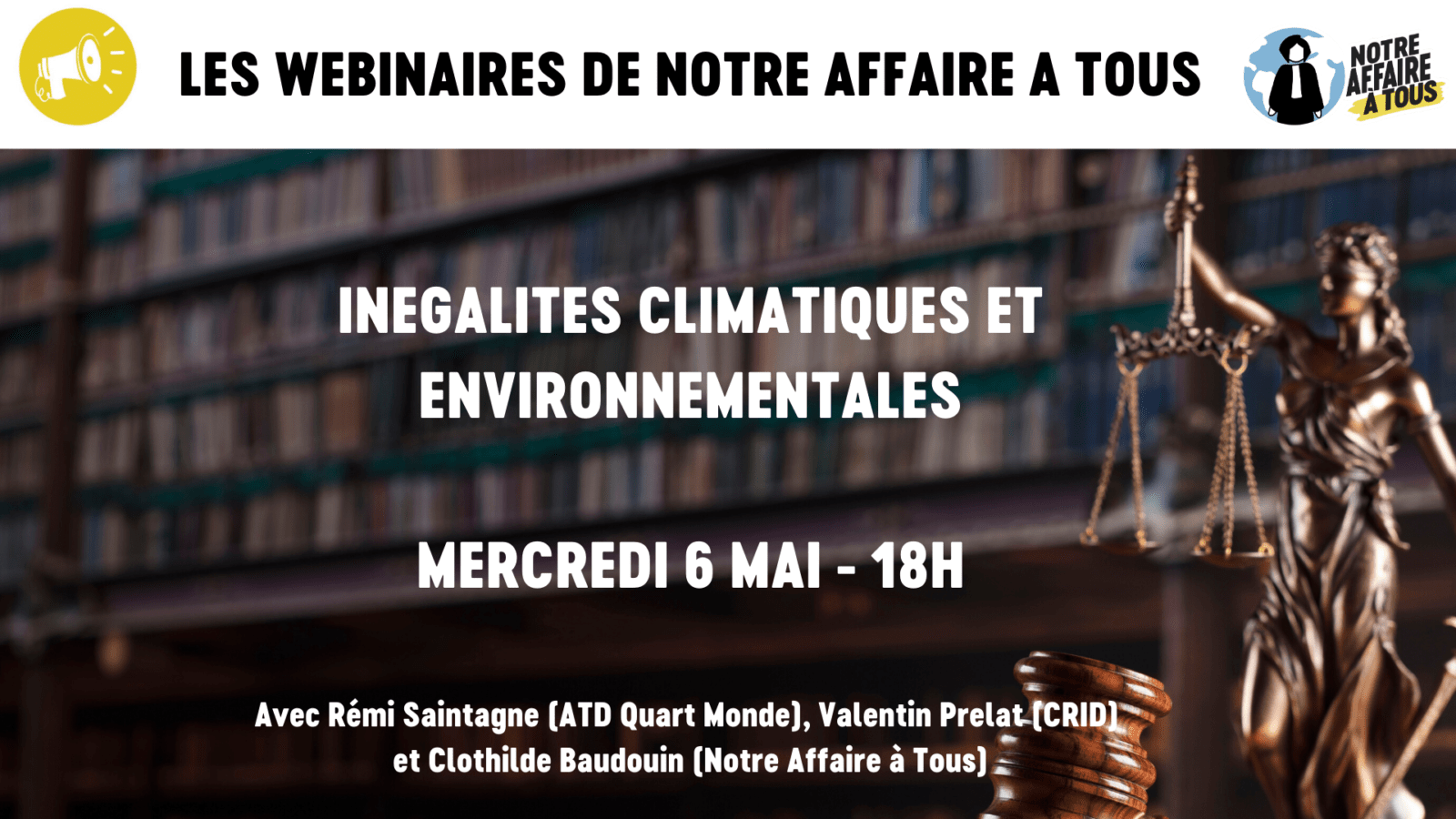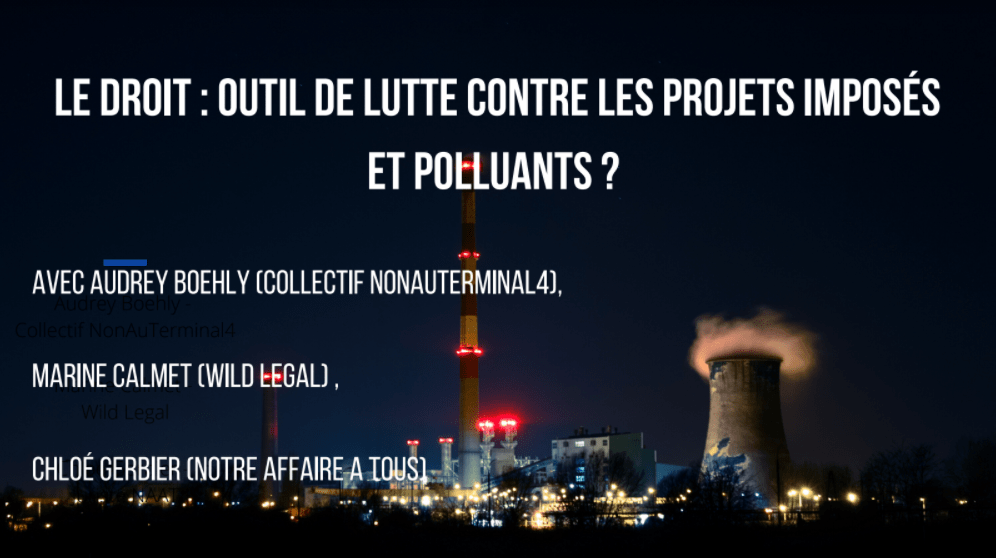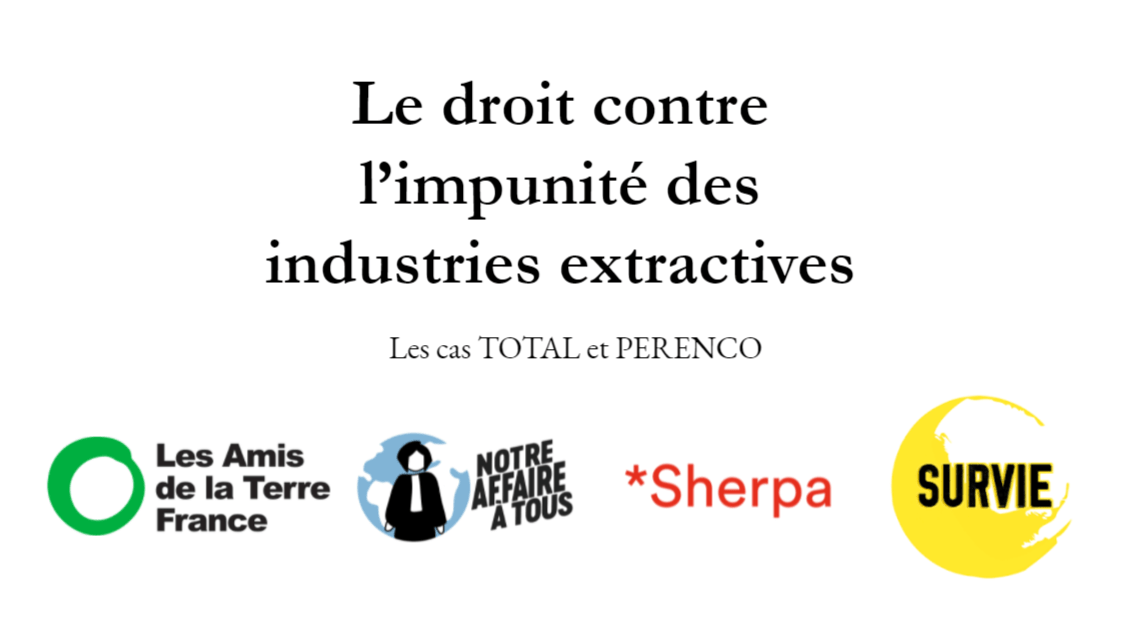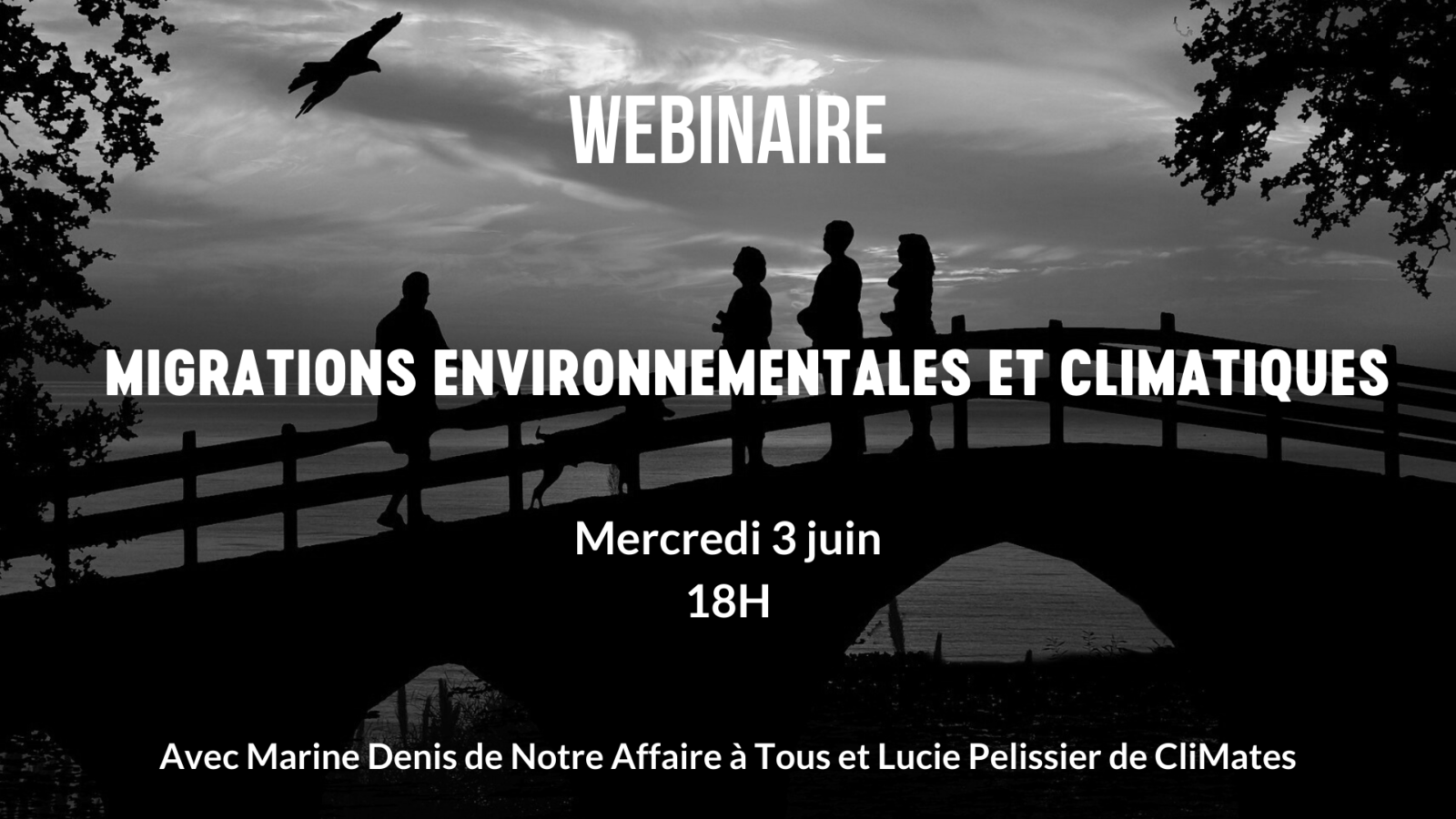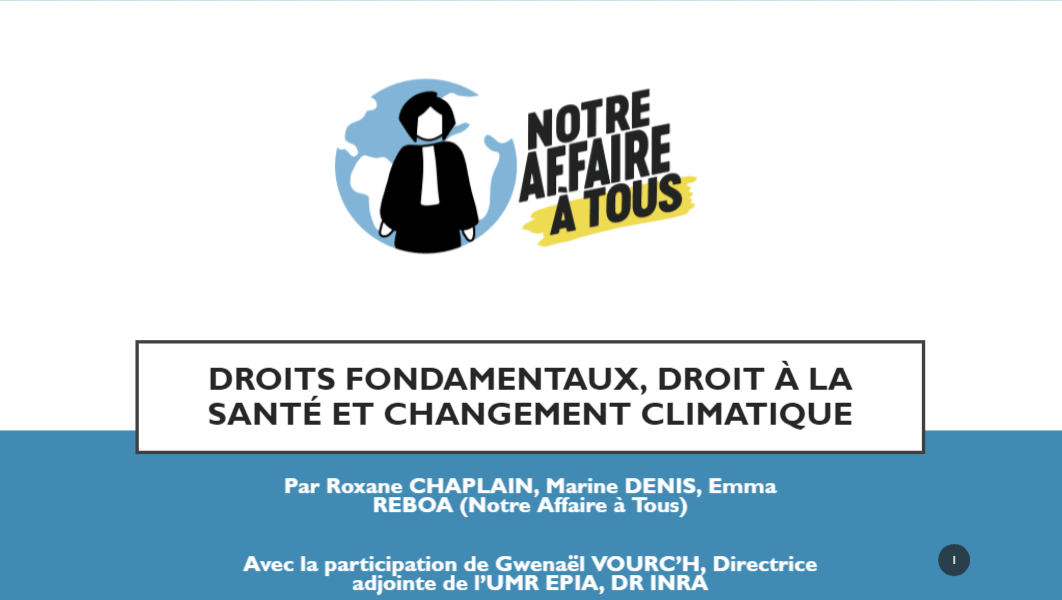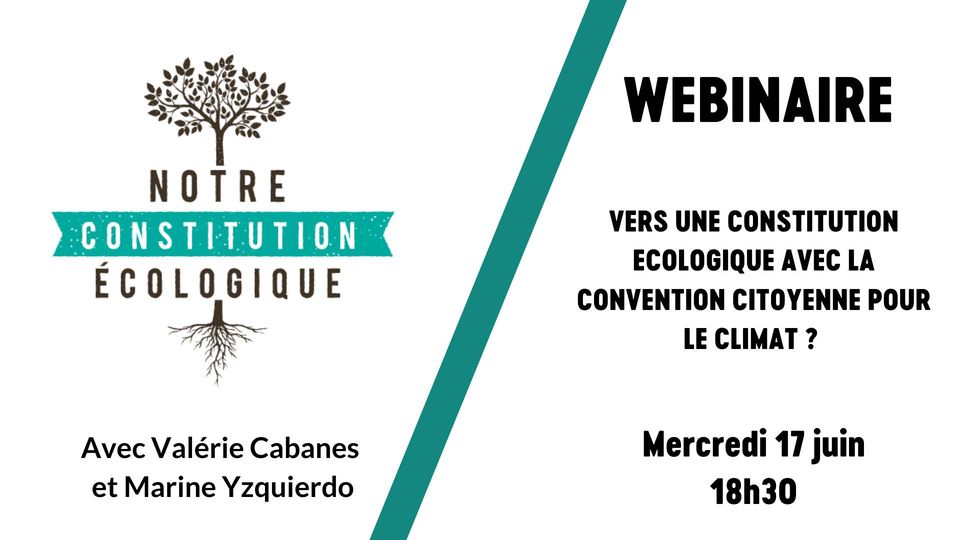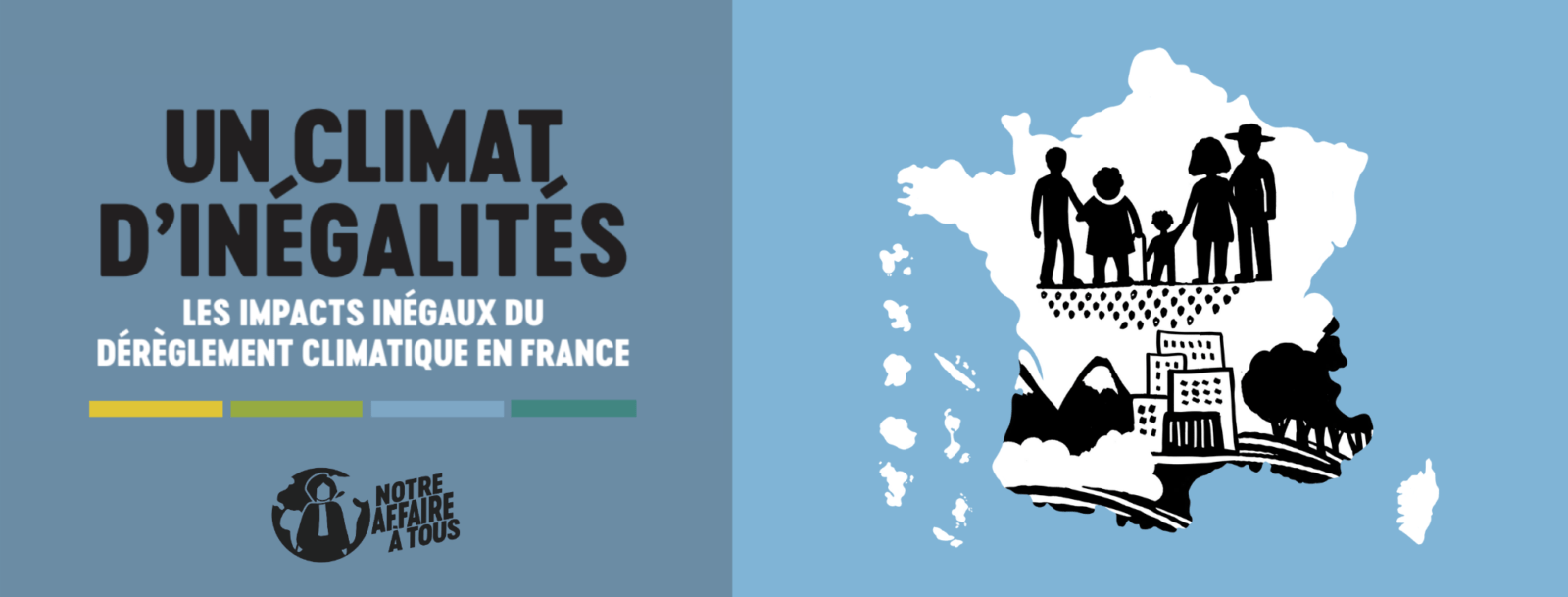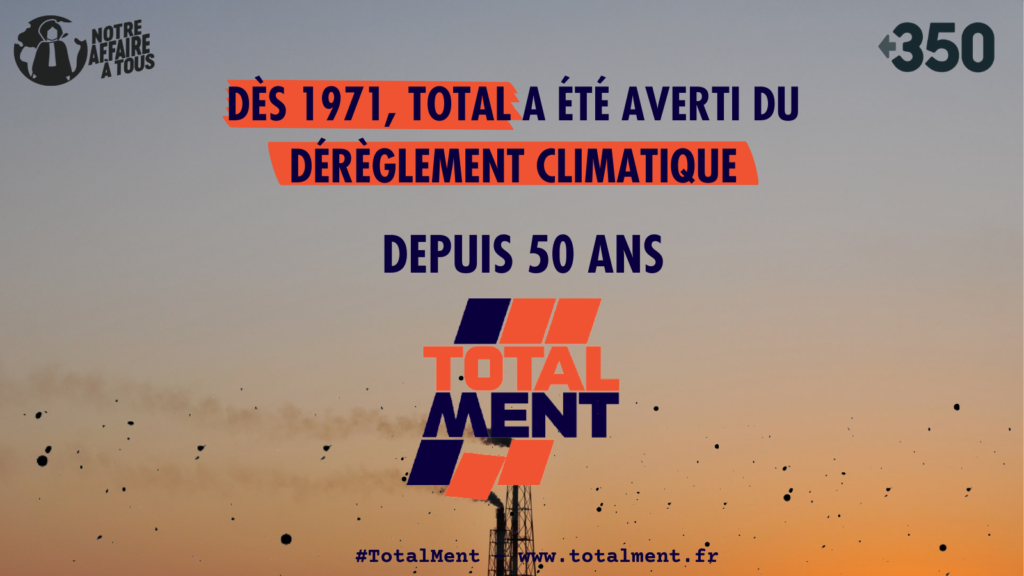Affaire du Siècle, communiqué de presse, 22 février 2024 – Le jugement du tribunal administratif de décembre 2023 donne raison aux associations de l’Affaire du Siècle. Et pourtant, le tribunal se refuse à mobiliser tous les outils à sa disposition pour obliger l’État à agir. Les associations s’inquiètent de cette décision qui donnerait un feu vert à une transition subie et non planifiée. C’est pourquoi elles se pourvoient en cassation ce jeudi 22 février 2024 devant la plus haute juridiction administrative française.

Le 22 décembre dernier, le tribunal administratif de Paris a reconnu que l’État avait manqué à ses obligations. En effet, le juge reconnaît que l’État n’a pas respecté l’échéance de fin 2022 qui lui était fixée et que les baisses d’émissions constatées sont imputables à des facteurs extérieurs. Les associations rappellent par ailleurs que, depuis la décision de 2021, les puits de carbone se sont effondrés, le retard climatique pris par la France s’est donc au contraire accru et le préjudice écologique aggravé.
Les associations continuent à dénoncer haut et fort la carence de l’État dans la mise en place de mesures structurantes, comme l’exigeait pourtant le jugement de 2021. Les quelques mesures prises depuis par les autorités ont été de courte durée, et elles ont surtout pesé sur les Français les plus précaires sans avoir généré d’impacts positifs durables et réels sur la trajectoire climatique de la France. Ce constat a été rappelé par le Conseil d’État en mai 2023. Et pourtant, le tribunal refuse de mobiliser les outils à sa disposition pour forcer l’État à agir : à ce stade de la procédure, il ne demande aucune nouvelle mesure structurante et refuse de prononcer des astreintes (1). Notre Affaire à Tous, Greenpeace France et Oxfam France s’inquiètent de cette décision, qui risque de créer une jurisprudence dommageable pour l’avenir de la justice climatique, et décident donc de se pourvoir en cassation.
Les dommages restant à réparer bien plus importants que ceux que le tribunal retient
D’abord, le juge intègre dans son bilan comptable évaluant la réparation du préjudice écologique les facteurs extérieurs à l’action de l’État. Comme le reconnaît le juge, la crise du Covid, la crise énergétique suite à la guerre en Ukraine et l’hiver 2022 particulièrement doux sont en grande majorité à l’origine de la récente baisse des émissions de la France et non des mesures de l’État. Pourtant le tribunal administratif ne retranche pas les 74% de baisse d’émissions qui sont issues de ces facteurs conjoncturels à son calcul du préjudice écologique à réparer (2).
Ensuite, le calcul du retard climatique de la France opéré par le tribunal administratif occulte le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF). Pourtant de 2019 à 2022, entre 83 et 92 mégatonnes équivalent CO2 ont été émises en trop, par rapport à ce que les puits de carbone étaient en capacité de réguler, en contradiction avec la Stratégie nationale bas-carbone.
Les associations de l’Affaire du Siècle réaffirment aujourd’hui que la transition doit être planifiée, pour être juste socialement et s’opérer dans un État de droit, et ne saurait se résumer à des mesures de court-terme pour répondre à des crises conjoncturelles et pesant de manière disproportionnée sur les plus modestes. L’Affaire du Siècle se pourvoit en cassation face à une décision jugée inquiétante pour la justice climatique.
Pour Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France : “Le gouvernement ne peut plus se permettre tant de paresse en matière de politique climatique : il doit respecter les objectifs de la France, sans exception de dernière minute, sans tour de passe-passe pour espérer afficher une bonne conduite de façade.”
Pour Jérémie Suissa, délégué général de Notre Affaire à Tous : “L’inaction climatique est aussi un péril social : en refusant d’agir sérieusement sans attendre, le gouvernement condamne la France à agir à la dernière minute, quand il sera déjà beaucoup trop tard. Et ce seront les classes populaires qui en subiront les conséquences les plus violentes.”
Pour Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France : “Si nous saisissons le Conseil d’État aujourd’hui c’est pour demander une nouvelle fois au tribunal de se donner véritablement les moyens de faire respecter son propre jugement de 2021. Celui-ci a été considéré comme historique au-delà des frontières françaises. Les attentes des 2,3 millions des Français.e.s qui ont signé la pétition de l’Affaire du Siècle sont grandes et ne retombent pas.”
Contacts presse
Greenpeace France : Kim Dallet – kdalletm@greenpeace.org
Oxfam France : Marika Bekier – mbekier@oxfamfrance.org
Notre Affaire à Tous : Justine Ripoll – justine.ripoll@notreaffaireatous.org
Notes
(1) L’Affaire du Siècle a réclamé une astreinte financière d’un milliard d’euros le 14 juin 2023 pour obliger l’Etat à agir.
(2) L’Affaire du siècle rappelle que deux secteurs sont responsables des baisses d’émissions de la France entre 2021 et 2022 : le secteur du bâtiment et le secteur de l’industrie manufacturière et de la construction. Le rapport d’expertise versé au dossier en 2023 démontre que dans ces deux secteurs, les baisses d’émissions observées sont dues à 74% à des facteurs conjoncturels mentionnés ci-dessus. Par conséquent, 11,9 MtCO2e des baisses d’émissions constatées dans ces secteurs ne sont pas imputables à une quelconque action volontaire structurelle de l’État. Sur la même période, les autres secteurs – transport, agriculture, déchets, production d’énergie – ont vu leurs émissions soit stagner, soit augmenter.