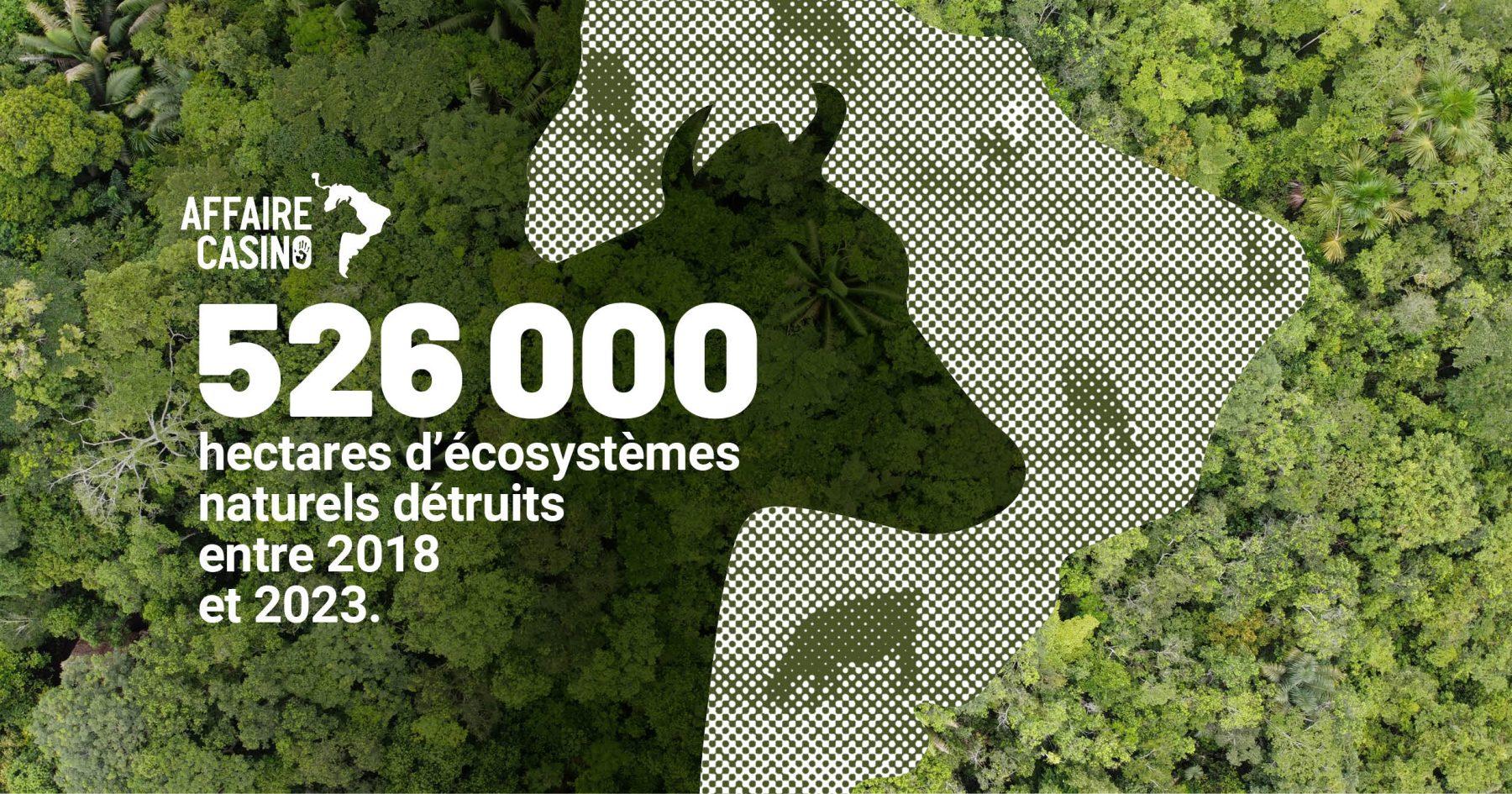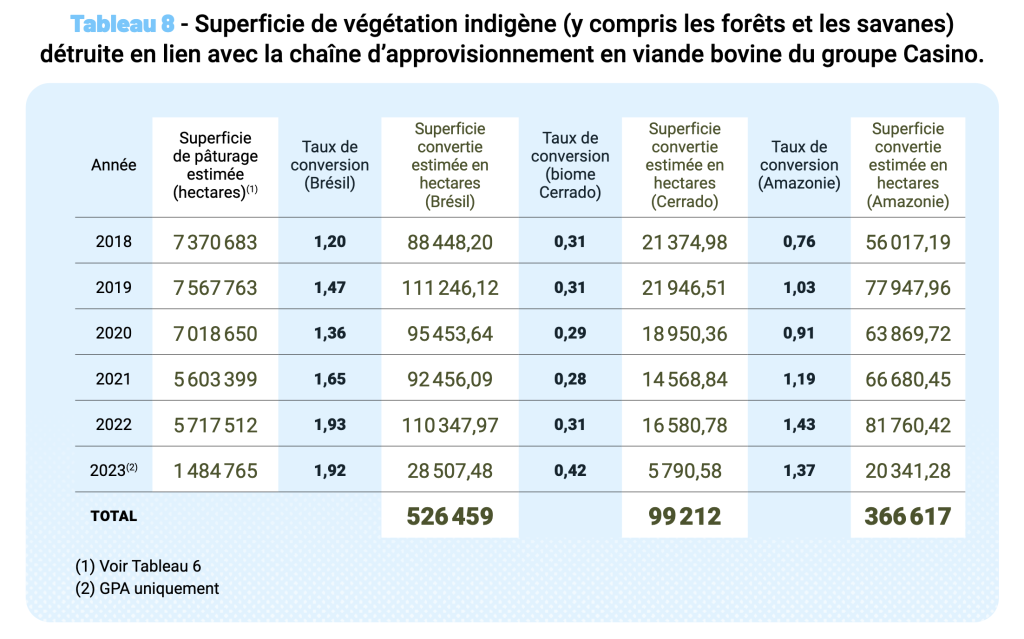Alors que la perspective d’un retour des néonicotinoïdes en France se précise, les associations de Justice Pour le Vivant qui ont obtenu une condamnation historique de l’État pour son inaction face à l’effondrement de la biodiversité tirent la sonnette d’alarme : il est urgent de réformer les protocoles d’évaluation et d’autorisation des pesticides par l’ANSES.
Le 6 juin 2025, se tiendra l’audience du procès en appel d’un État qui refuse d’appliquer la décision du tribunal administratif malgré un délai terminé depuis juillet 2024. À cette occasion, les associations requérantes souhaitent rappeler l’enjeu historique de cette nouvelle étape : la mise à jour des protocoles d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des pesticides par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES). Une décision qui pourrait marquer un tournant face à la contamination généralisée de notre environnement par les pesticides et à l’effondrement massif de la biodiversité en France.
Il y a deux ans, le tribunal administratif de Paris condamnait la France pour inaction face à l’effondrement de la biodiversité et reconnaissait la responsabilité de l’État dans la « contamination généralisée, diffuse, chronique et durable des eaux et des sols » par les pesticides. Une décision historique sans précédent, qui n’est pas encore à la hauteur de nos enjeux.. Si les juges ont reconnu des insuffisances dans l’évaluation des risques des pesticides au regard du principe de précaution et de l’évolution de la science, ils n’ont pas ordonné à l’ANSES de revoir les méthodologies d’homologation des pesticides, contrairement à ce que préconisait la rapporteur publique.
Or la faille est là. Si l’État français prenait en compte les connaissances scientifiques actuelles concernant l’évaluation des risques des pesticides avant d’autoriser leur mise sur le marché, nombreux sont ceux qui ne seraient plus autorisés tant ils sont dangereux pour les écosystèmes et la santé humaine. Et les industriels de l’agrochimie le savent : c’est pour cela qu’ils ont demandé à participer au procès, via leur représentant Phyteis, pour défendre l’inaction de l’État français face aux ravages des pesticides.
Dans quelques jours, le 6 juin 2025, aura lieu l’audience en appel dans le dossier « Justice Pour le Vivant », où les organisations Notre Affaire à Tous, POLLINIS, ANPER-TOS, l’ASPAS et Biodiversité sous nos pieds plaideront pour que la justice confirme la condamnation de l’État en première instance et l’enjoigne à mettre à jour les tests exigés par l’ANSES.
Une décision qui pourrait tout changer
Les protocoles actuels de l’ANSES, chargée d’autoriser ou non les pesticides sont obsolètes. De nombreux effets toxiques des pesticides ne sont pas pris en compte, comme l’exposition diffuse, répété ou prolongée, ou encore les effets combinés de plusieurs substances présentes dans l’environnement. Les niveaux de contamination réels ne font pas l’objet de suivis adaptés sur le terrain. Les autorisations, difficilement révocables, sont délivrées pour des durées trop longues avant même que l’industrie n’ait fourni toutes les données pertinentes. Résultat : rares sont les produits dont la mise sur le marché est refusée, alors que l’effondrement de la biodiversité se poursuit et que les scandales sanitaires se succèdent.
La défaillance de l’État a été reconnue par le tribunal administratif de Paris en juin 2023, sans toutefois l’enjoindre à réformer le protocole. Mais depuis, deux décisions majeures sont venues renforcer l’exigence de changement. D’abord, en avril 2024, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans un arrêt de principe, la responsabilité des États membres de se doter d’un processus d’évaluation des risques réellement efficace, fondé sur « les données scientifiques disponibles les plus fiables ainsi que les résultats les plus récents de la recherche internationale ». Plus récemment, en février 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’autorisation de mise sur le marché des insecticides Transform et Closer, produits par la multinationale Corteva et contenant du sulfoxaflor — une substance au mode d’action proche des néonicotinoïdes « tueurs d’abeilles ». Cette décision repose sur une critique explicite du protocole d’évaluation et d’autorisation des pesticides conduit par l’ANSES, au regard des exigences scientifiques et de protection de l’environnement.
Alors que 80 % des français sont favorables à la réduction de l’utilisation des pesticides dans l’agriculture (1), la cour administrative d’appel de Paris pourrait, dans les semaines à venir, contraindre l’État français à mettre à jour des connaissances scientifiques actuelles les procédures d’homologation des pesticides menées par l’ANSES. Une décision nécessaire à l’heure où le gouvernement et certains groupes parlementaires semblent en effet plus enclins à répondre aux demandes des firmes de l’industrie agrochimique plutôt qu’à protéger nos agriculteurs et notre agriculture, notre santé et le Vivant dont ils dépendent.
Note
(1) https://www.ifop.com/publication/les-francais-et-la-reduction-des-pesticides-dans-lagriculture/
Signataires
Philippe GRANDCOLAS, directeur de recherche au CNRS ; Florence VOLAIRE, chercheuse écologue INRAE ; Laurent PERRIN, directeur de recherches au CNRS ; Christel COURNIL, professeure de droit public à Sciences Po Toulouse ; Vinca DELAMARE DEBOUTTEVILLE, psychologue ; Julien LEFEVRE, enseignant-chercheur ; Stéphanie MARIETTE, chargée de recherche INRAE ; Emmanuelle BALLIAU, co-Présidente Avenir Sante Environnement ; Odin MARC, chargé de Recherche ; Carole HERMON, professeure ; Laurent HUSSON, directeur de recherches CNRS ; Clément CAPDEBOS, avocat ; Marie VINCENT, médecin au CHU Nantes ; Viviane BALADI, directrice de recherche CNRS (retraitée) ; Julian CARREY, enseignant-chercheur à l’INSA Toulouse ; Bruno LOCATELLI, chercheur ; Jean-Jacques MABILAT, président de Coquelicots de Paris ; Dorian GUINARD, porte-parole de Biodiversité Sous Nos Pieds ; Nicolas LAARMAN, délégué général de Pollinis ; Jérémie SUISSA, délégué général de Notre Affaire à Tous ; Kim VO DINH, co-président de Bio Consom’acteurs ; François VEILLERETTE, porte parole de Générations futures ; Sandy OLIVAR CALVO, chargée de campagne agriculture chez Greenpeace France ; Armelle de SAINT SAUVEUR, co présidente de Slow Food Paris Terroirs du Monde ; Frédéric CHASSAGNETTE, secrétaire général du Snetap-FSU ; Sébastien BAROT, chercheur à l’IRD ; Giovanni PRETE, maître de conférence en sociologie à l’Université Paris 13 ; Anne-Françoise TAISNE, déléguée générale du CFSI.

![[Tribune] “ Il est urgent de réformer les protocoles d’évaluation des pesticides par l’ANSES ”](https://preprod.notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2025/05/Screenshot-2025-05-05-at-10-36-22-Banniere-JPLV-1920-px-%C3%97-250-px-Canva.png)