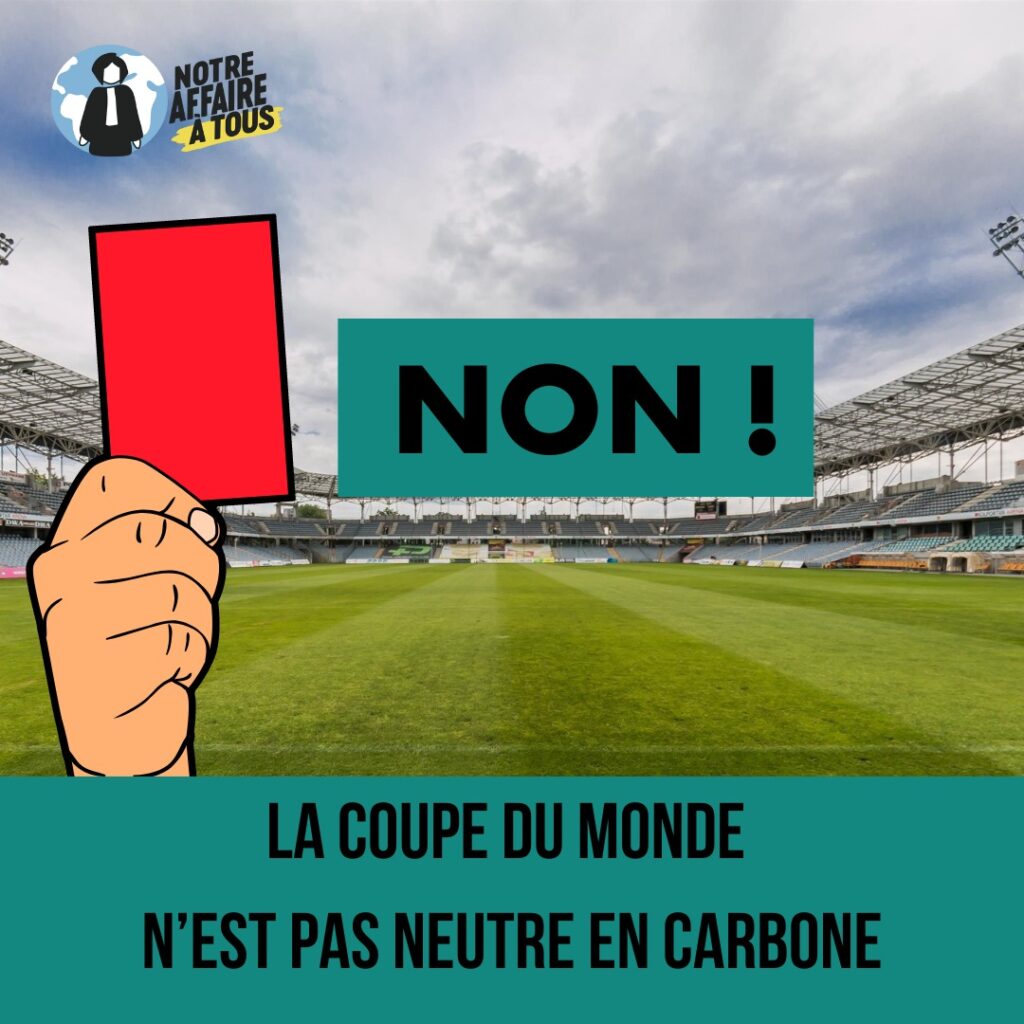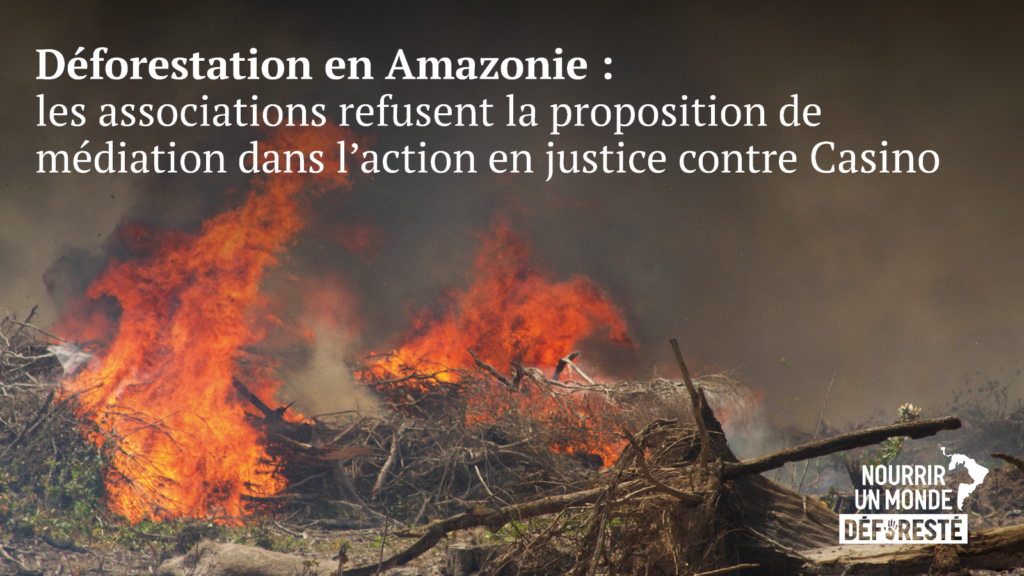Paris – le 24 janvier 2023. Plus d’un an après le lancement du recours « Justice pour le Vivant » contre l’État français pour son inaction face à l’effondrement de la biodiversité, POLLINIS, Notre Affaire à Tous, Biodiversité sous nos pieds, Anper-Tos et l’ASPAS, ont déposé leur mémoire en réplique auprès du tribunal administratif de Paris. Les 5 ONG à l’origine de ce procès historique démontrent que l’État a bien la capacité d’agir pour enrayer la sixième extinction de masse.

Attaqué en justice en janvier 2022 par cinq associations de protection de l’environnement pour sa défaillance dans la mise en œuvre de procédures d’évaluation et de mise sur le marché des pesticides réellement protectrices de la biodiversité, l’État français a choisi une ligne de défense qui méconnaît le droit et la science.
Dans son mémoire en défense déposé le 19 décembre 2022, l’État justifie son inaction par l’absence de marge de manœuvre laissée aux États membres par la réglementation européenne, qui l’empêcherait de prendre des mesures ambitieuses et adaptées à l’effondrement de la biodiversité sur la question de la régulation des pesticides. Cette réponse est juridiquement infondée, mais aussi politiquement irresponsable.
« Le jour même où le gouvernement français a soutenu l’accord international de la COP 15 de la biodiversité pour tenter d’inverser l’effondrement du vivant, il s’est dédouané de toute responsabilité quant à ce même effondrement face aux preuves accumulées dans le recours Justice pour le Vivant », déplorent les associations requérantes. »
Comme le démontre le mémoire en réplique déposé par les associations, les États membres de l’Union européenne disposent bel et bien d’une marge de manœuvre leur permettant de mettre en place des procédures d’évaluation plus protectrices de l’environnement avant toute autorisation de mise sur le marché des pesticides. Le droit de l’UE leur confie expressément la compétence pour évaluer et autoriser (ou refuser) les produits phytopharmaceutiques, au regard des dernières connaissances scientifiques et dans le respect du principe de précaution.
En matière d’évaluation des risques des pesticides pour les abeilles, d’autres États ont par exemple choisi d’appliquer un schéma plus protecteur que le cadre européen en vigueur. Ce choix a été motivé par le fait que le schéma d’évaluation pour les abeilles n’a pas évolué depuis le début des années 2000, et présente des lacunes majeures identifiées par l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) depuis 2012.
- C’est le cas, par exemple, de la Belgique, qui a adopté une procédure d’évaluation au niveau national plus protectrice, rappelant que « d’un point de vue scientifique, il n’est pas acceptable d’ignorer des données de toxicité solides disponibles sur les espèces non ciblées vulnérables sous prétexte qu’il n’existe pas de procédure d’évaluation des risques généralement acceptée »[1].
- L’EFSA elle-même, lors du réexamen des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, s’est écartée du schéma d’évaluation en vigueur et a exigé des tests complémentaires qui ont permis de démontrer la toxicité réelle pour les abeilles de ces insecticides et mené à leur interdiction au niveau européen.
- L’Anses, quant à elle, s’était autosaisie en 2019 en vue de renforcer le cadre de l’évaluation des risques pour les abeilles, mais n’a jamais mis en œuvre ses propres recommandations.
A titre subsidiaire, les associations ont par ailleurs demandé au tribunal administratif de saisir la Cour de justice de l’Union européenne en cas de doutes quant à la marge de manœuvre réelle de l’État au regard du droit de l’UE.
Enfin, l’État ne conteste ni l’effondrement alarmant de la biodiversité ni le préjudice écologique qui en découle, mais minimise le rôle joué par les pesticides dans ce déclin. Ce lien de causalité a pourtant été démontré par de nombreuses recherches scientifiques, notamment le dernier rapport INRAE/Ifremer publié en 2022, qui confirme l’omniprésence des pesticides et leurs effets majeurs, directs et indirects, sur la biodiversité, en particulier sur les invertébrés terrestres et les oiseaux.
De même, l’État ne conteste pas n’avoir pas respecté les objectifs nationaux de réduction de l’utilisation des pesticides fixés notamment par les plans Ecophyto et la loi Grenelle 1, mais soutient qu’ils ne sont pas contraignants. C’est pourtant l’État qui a inscrit ces objectifs dans la loi. Une telle ligne d’argumentation est politiquement irresponsable, alors que les représentants de l’État affirment dans les médias et auprès des citoyens et citoyennes, que ces engagements ne sont pas que des promesses.
À la suite de la production du mémoire en réplique, le tribunal a rouvert l’instruction jusqu’au 10 février, l’État a donc trois semaines pour répondre aux arguments des associations de Justice pour le Vivant.
CITATIONS :
Nicolas Laarman, POLLINIS : « Alors que le gouvernement français se targue de la conclusion d’un accord ambitieux pour la biodiversité à la COP15, il refuse de prendre ses responsabilités sur son propre territoire et de revoir les processus défaillants d’évaluation des risques posés par les pesticides qui permettent la mise sur le marché de produits particulièrement toxiques pour la biodiversité. Ces substances chimiques sont les principales responsables de la chute des populations d’insectes pollinisateurs en France et de toute la biodiversité qui en dépend. Elle doivent absolument être réévaluées et retirées du marché pour enrayer l’effondrement de la biodiversité dans notre pays »
Jérémie Suissa, Notre Affaire À Tous : « Au lieu de chercher par tous les moyens à justifier son inaction, l’État ferait mieux de se mobiliser massivement pour accompagner la transition vers une agriculture sans pesticides. La biodiversité n’a pas besoin d’excuses, elle a besoin de solutions » Jérémie Suissa, délégué général de notre Affaire À Tous
John Philipot, ANPER-TOS : « S’agissant de la pollution des eaux par les pesticides, l’État se défend d’avoir une réponse «progressive et adaptée». Nous interpellons l’État : adaptée, mais à quoi ? À l’urgence climatique ? À l’effondrement de la biodiversité ? L’État doit arrêter de se cacher derrière des coûts financiers ou des prétendues difficultés techniques pour déroger, reporter, et manipuler les objectifs fixés par le droit européen dans sa directive-cadre sur l’eau. Nous voulons la reconnaissance de l’atteinte massive des fonctions écologiques de l’eau causée par les pesticides, à laquelle l’État doit être tenu de mettre un terme et de réparer. »
Dorian Guinard, Biodiversité sous nos pieds : « Alors qu’il y a urgence à agir pour enrayer le déclin de la biodiversité à l’œuvre, il est navrant de constater l’apathie de l’État français devant la contamination généralisée de l’ensemble des milieux naturels par les pesticides. Les sols et la biodiversité qu’ils renferment sont notre atout principal pour faire face aux deux plus grands défis environnementaux du 21ème siècle. L’État doit cesser de privilégier un système qui altère leur fonctionnement, inhibant ainsi leur contribution au maintien du vivant, et traduire en actes ses engagements pour la pérennité des sols qui ne souffrent aucun délai. »
Marc Giraud, ASPAS : “Cette inaction des responsables politiques montre un manque de culture inquiétant sur les enjeux fondamentaux de l’écologie. Faire passer les intérêts économiques avant les impératifs du Vivant, c’est se rendre coupable d’écocide”
___________
Historique du recours :
- 8 septembre 2021 : POLLINIS et Notre Affaire à Tous déposent une demande préalable auprès du gouvernement pour obtenir la réparation du préjudice écologique causé par les carences et insuffisances de l’État en matière d’évaluation des risques et d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, de réexamen des autorisations et de protection de la biodiversité contre les effets de ces produits.
- 8 novembre 2021 : décision implicite de rejet de la part de l’État, à l’expiration du délai légal de deux mois.
- Le 10 janvier 2022 : dépôt par POLLINIS et NAAT, rejointes par trois nouvelles associations (ANPER-TOS, Biodiversité sous nos pieds, et ASPAS), d’un recours indemnitaire contre l’État français (requête sommaire) au tribunal administratif de Paris.
- 18 février 2022 : les cinq associations déposent, en complément de la requête sommaire, un mémoire complémentaire détaillant les moyens et arguments des associations à l’appui de leur recours.
- 19 décembre 2022 : l’État répond par un mémoire en défense.
- 19 janvier 2023 : les 5 associations produisent, en réponse au mémoire en défense de l’État, leur mémoire en réplique.
- 10 février 2023 : date de clôture de l’instruction.
[1] Data Requirements and risk assessment for bees. National approach for Belgium (2021), p. 5/24: “from a scientific point of view, it is not acceptable to ignore available robust toxicity data on vulnerable non-target species simply because there is no generally accepted risk assessment guideline.”
CONTACTS PRESSE :
POLLINIS : Cécile Barbiere, Directrice de la communication
cecileb@pollinis.org
Notre Affaire à Tous : Justine Ripoll, Responsable de campagnes. justine.ripoll@notreaffaireatous.org
ANPER-TOS : Elisabeth Laporte, Juriste.
juridique@anper-tos.fr,
Biodiversité Sous Nos Pieds : Dorian Guinard, membre du pôle juridique de BSNP
ASPAS : Cécilia Rinaudo, Responsable Développement
cecilia.rinaudo@aspas-nature.org
Lien de téléchargement du mémoire en réplique
Lien de téléchargement du dossier de presse mis à jour
| Photos d’illustrations disponibles : LES PHOTOS DU CONGRÈS DE L’UICN – SEPTEMBRE 2021 (CRÉDIT PHILIPPE BESNARD/POLLINIS) LES PHOTOS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS – JANVIER 2022 (CRÉDIT LESLIE FAUVEL/POLLINIS) |