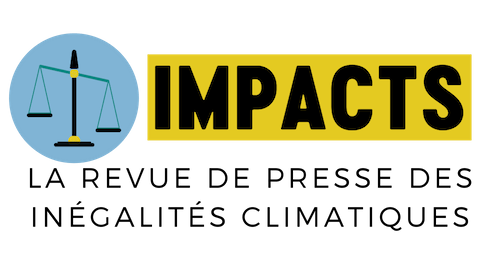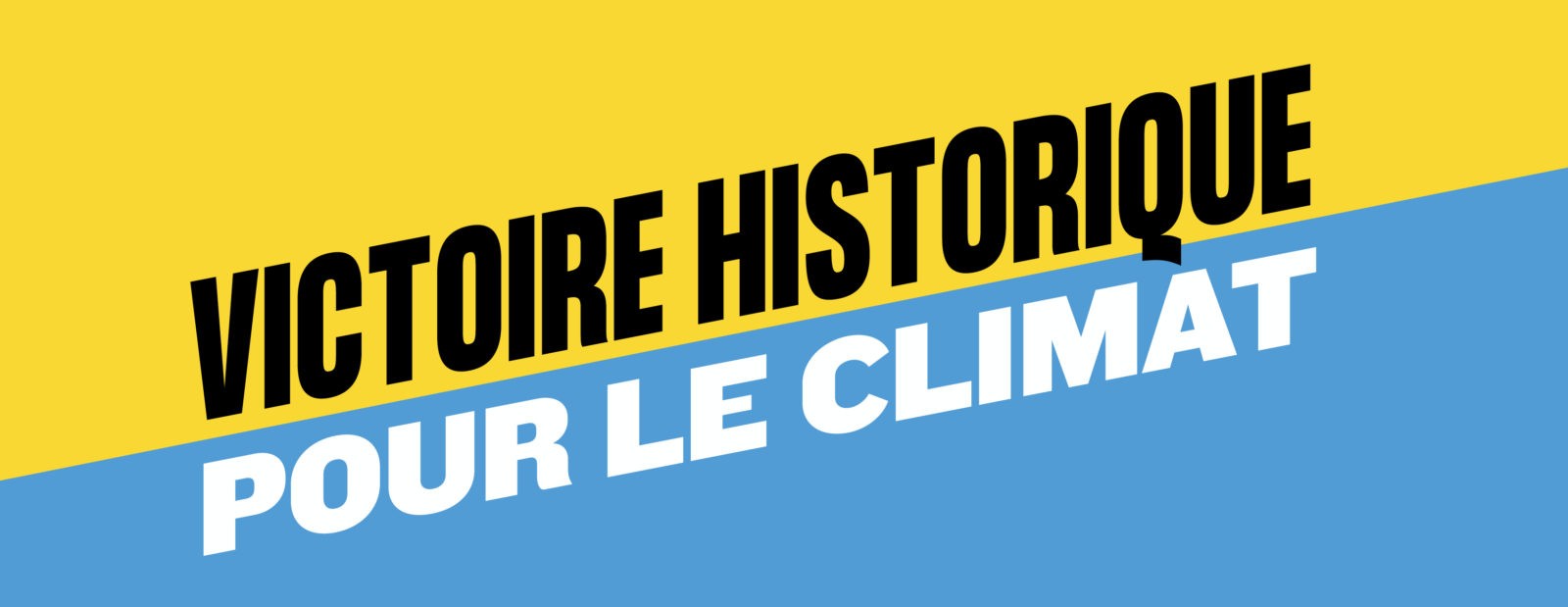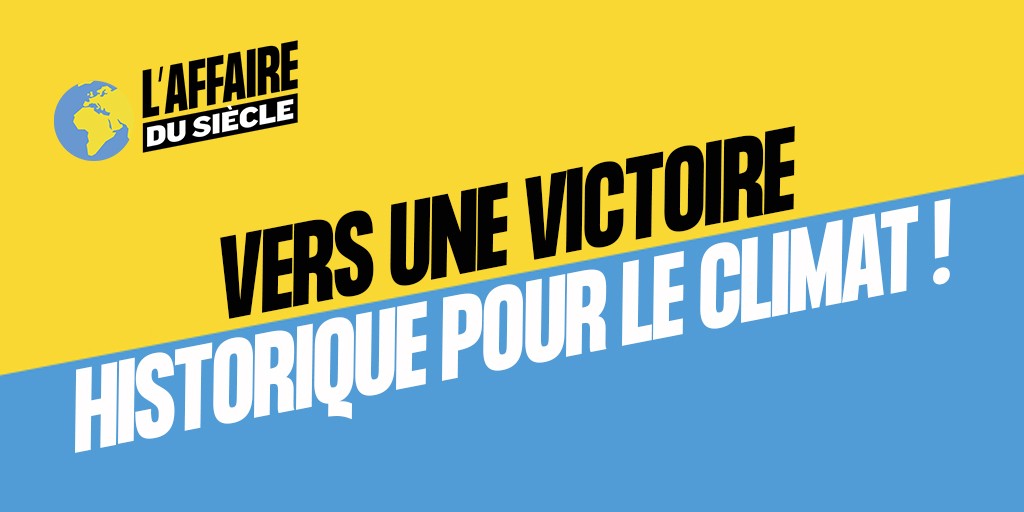Après quelques mois d’absence, “IMPACTS – La revue de presse des inégalités climatiques” revient ! En décembre 2020, Notre Affaire à Tous sortait le rapport “Un climat d’inégalités”, un dossier inédit sur les inégalités climatiques en France ! L’objectif : mettre en lumière un phénomène encore trop peu documenté, que nous nous efforçons de documenter depuis avril 2019 dans la revue de presse IMPACTS ! 5 ans après l’Accord de Paris, deux ans après l’Affaire du Siècle et la mobilisation des gilets jaunes, les actions ambitieuses en matière de lutte contre le dérèglement climatique se font toujours attendre et l’accélération du changement climatique pèse de manière inégale sur la population française. À travers ce rapport, nous avons documenté et analysé :
- Les populations les plus vulnérables,
- Les territoires les plus touchés,
- Les répercussions sociales,
- Les secteurs économiques menacés par les changements climatiques.
Pour préparer ce rapport, nous avons également rencontré et interrogé quatorze citoyen·ne·s qui ont témoigné des impacts directs du dérèglement climatique sur leurs conditions de vie.
Dans ce numéro de reprise de la revue de presse, nous vous faisons un récapitulatif des impacts climatiques de 2020.
2020 : année de tous les (mauvais) records
Notre rapport a été publié en 2020, une année de tous les (mauvais) records climatiques. 2020 est l’année la plus chaude jamais enregistrée après l’année 2018, et 9 des 10 années les plus chaudes appartiennent désormais au XXIᵉ siècle, la dernière décennie cumulant le top 7. Records de chaleur, records d’incendies, records d’intempéries… Tous ces indicateurs sont révélateurs de l’impact du dérèglement climatique qui ne cesse de s’intensifier. L’année 2020 n’a cependant pas été celle du record des émissions de CO2 en raison du ralentissement de l’activité humaine mondiale dans le cadre des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19.
- Incendies nombreux et dévastateurs
L’année 2020 a témoigné d’un nombre record d’incendies d’une intensité sans précédent à travers le monde. Dès janvier, l’Australie luttait déjà contre la pire saison de feux de forêts que le pays ait connu, avec un bilan tragique – plus de 11 millions d’hectares brûlés, 3 milliards d’animaux tués ou déplacés, et des millions de personnes impactées directement ou indirectement par les feux (déplacements, pollution de l’air, conséquences physiques et mentales, etc.).
En Sibérie arctique, des températures caniculaires ont déclenché des feux dont le bilan est estimé par certains à 20 millions d’hectares de forêt détruits, soit 20 fois plus qu’en Californie, rapporte France Info. Et pourtant, les incendies californiens ont marqué les esprits par leur ampleur inédite, avec une surface détruite de plus de 8,000 km², soit 100 fois la superficie de Paris.
Le Brésil, quant à lui, fait face à un nombre croissant d’incendies, notamment en Amazonie où une augmentation de 13% a été constatée au cours des neufs premiers mois de l’année 2020 – n’en déplaise au Président Jair Bolsonaro qui n’a cessé de nier l’origine et l’importance de ces feux. En effet, leur origine est cette fois essentiellement criminelle et résulte des incitations du gouvernement en place à procéder à des opérations de déforestation illégale destinées à installer des élevages illégaux de bétail. D’après Amnesty International, la déforestation a augmenté de 35% entre la période allant d’août 2019 à juillet 2020 et l’année précédente sur la même période.
La France a elle aussi connu des feux cet été. Ces derniers, causés par le réchauffement climatique ou d’origine criminelle, se sont déclarés en particulier dans la forêt de Chiberta et dans les Bouches-du-Rhône, à Vitrolles ou encore à Istres, comme l’évoque Reporterre.
Les catastrophes naturelles n’ont cessé de se multiplier : 2020 a été l’année des records pour de nombreux événements extrêmes (feux de forêts, tempêtes… ). Le nombre de catastrophes naturelles a doublé en 20 ans à l’échelle de la planète, selon un rapport des Nations Unies d’octobre 2020. Le principal risque pour ces prochaines années viendra majoritairement des vagues de chaleur, qui “ont augmenté de 232% depuis 1999”, alors que les catastrophes les plus importantes des dernières années étaient les tempêtes et inondations.
Face à ces événements extrêmes, les personnes les plus pauvres sont les plus touchées : dans les pays pauvres, “seulement 4 % des pertes économiques causées par les catastrophes sont assurées, contre 60 % dans les pays riches, selon une récente étude publiée dans The Lancet”.
Augmentation de la concentration de CO2 malgré la baisse des émissions
Si les émissions mondiales de CO2 ont baissé de 7% en 2020 par rapport à 2019 en raison des mesures adoptées mondialement pour lutter contre la pandémie, ce record de diminution des émissions n’a pas permis de mettre un frein à l’augmentation des concentrations de CO2 dans l’atmosphère, rapporte La Relève et la Peste. Cette diminution est également à relativiser car elle est temporaire et ne provient pas de changements structurels.
Cette baisse sans précédent des émissions mondiales s’explique avant tout par la réduction des émissions résultant des transports par rapport à 2019. Cette diminution est encore évaluée, en décembre 2020, à 10% pour le transport routier et à 40% pour le transport aérien.
Or, la réduction ne signifie pas la stabilisation des émissions. Ainsi, malgré cette baisse des émissions, la concentration de CO2 dans l’atmosphère a augmenté de 410 à 412 parties par million, ce qui la rapproche du seuil des 450 parties par million fixé par le GIEC pour limiter l’augmentation de la température moyenne de 2°C. Cette évolution s’explique également par un puits de carbone terrestre ayant moins absorbé de CO2, notamment en raison d’incendies et de sécheresses.
Zoom sur l’année 2020 en France
En France, l’année a été la plus chaude jamais enregistrée à l’échelle nationale et des records de chaleur ont été atteints sur une majorité du territoire, comme en Isère où “le climat s’emballe”, en Alsace, au Pays Basque…
D’une part, à ces grosses vagues de chaleurs de l’été s’est ajoutée une faible pluviométrie, avec un déficit de plus de 70% en moyenne sur la totalité du territoire. En août 2020, 75 départements étaient en restriction d’eau, impactant notamment les agriculteurs, victimes de la sécheresse. L’été 2020 a été le plus sec jamais enregistré, depuis 1959, battant pour la troisième année consécutive les records de sécheresse après les étés 2018 et 2019. Pour en savoir plus sur les impacts des sécheresses sur les agriculteurs, découvrez les témoignages de Maurice Feschet et de Raphaël Baltassat, deux des quatorze témoins du rapport « Un Climat d’inégalités ».
De nombreuses restrictions d’eau ont eu lieu durant l’été 2020. Au 25 septembre, 183 arrêtés préfectoraux de restriction de l’usage de l’eau et de l’irrigation étaient en vigueur, concernant 78 départements. 7 autres départements étaient en situation de vigilance. Face à l’augmentation des tensions autour des usages de l’eau, l’Assemblée nationale a publié un rapport d’information en juin 2020 sur la gestion des conflits d’usage en situation de pénurie d’eau.
D’autre part, à l’automne, de forts et dangereux épisodes méditerranéens se sont déclarés. Ces épisodes s’intensifient et se multiplient au fil des années, notamment dans le sud de la France. En octobre année, la tempête Alex a causé d’importants dégâts et a coûté la vie à 10 personnes. 9 personnes sont toujours portées disparues dans les Alpes-Maritimes. À l’occasion du reportage de Complément d’Enquête “Des catastrophes pas si naturelles”, Notre Affaire à Tous est d’ailleurs intervenue pour parler des impacts et des inégalités climatiques en France.
- Phénomène des maisons fissurées
Le phénomène de sécheresse-réhydratation des sols conduit à des mouvements de terrain et affectent les bâtiments (fissurations, décollements, affaissements…). Ces phénomènes sont peu dangereux pour les humains mais entraînent des sinistres très coûteux et des dégâts potentiellement importants pour les bâtiments. Selon la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA), entre 1989 et 2007, les sécheresses ont causé plus de 444 000 sinistres, pour un coût de 4,1 milliards d’euros.
Les habitant-es de ces maisons, les “oubliés de la canicule” s’organisent et se constituent en associations et collectifs. C’est le cas de l’Association Urgence Maisons Fissurées-Sarthe qui se bat pour la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et pour l’indemnisation suite aux dégâts. Dans la Sarthe en 2019, 70 communes étaient concernées. Ce phénomène s’aggrave d’année en année avec les sécheresses qui s’accumulent, touchent de nombreuses régions et menacent 4 millions de maisons, selon le Ministère de la Transition Écologique.
Impacts inégaux du dérèglement climatique en 2020
Les conséquences de ce climat record de l’année 2020 touchent de manière disproportionnée et inégalitaire l’ensemble de la population. Il y a eu plus de 1900 décès liés à la canicule pendant l’été 2020, selon Santé Publique France. Il s’agit de l’été le plus meurtrier dû à la canicule depuis 2004, avec une surmortalité de 18%.
- Les plus âgés et les plus pauvres : premiers touchés
D’après les autorités de santé, l’été 2020 est celui qui présente l’impact sanitaire « le plus important depuis la mise en place du plan national canicule en 2004, juste devant les étés 2015, 2018 et 2019 ». Les plus de 45 ans sont les principales victimes des canicules de 2020 qui ont fait au total 1 924 morts. Au-delà de la surmortalité, ces vagues de chaleur exacerbent les inégalités sociales. Ce sont les personnes âgées et les plus isolées socialement qui en souffrent le plus. De nombreuses études post-canicule de 2003 font ce constat. Cette année-là, un grand nombre de victimes vivaient dans des “logements exigus, sans aération, ou avec une seule fenêtre”, selon Richard Keller, qui a écrit l’étude “Fatal Isolation. The devastating Paris Heat Wave of 2003”. A Paris, en 2003, habiter sous les toits multipliait le risque de mortalité par quatre. Selon une étude parue dans le bulletin épidémiologique du ministère de la santé en 2019, les vulnérabilités sont exacerbées pour les personnes de nationalité étrangère, qui sont plus exposées aux particules fines, ont moins accès aux espaces verts, aux soins et appartiennent souvent à une catégorie sociale défavorisée.
- Agriculteurs et éleveurs en première ligne
L’agriculture a particulièrement souffert des conditions climatiques de cette année 2020, entraînant des baisses de rendements et des coûts importants pour les agriculteurs et éleveurs (irrigation des plantes, abreuvage des troupeaux, obligation d’achat de fourrage supplémentaire en raison de la sécheresse, etc.), allant jusqu’à menacer l’existence de certaines exploitations. Cela amène à financer et construire des solutions de captation et de stockage de l’eau, créant des tensions autour de l’usage de l’eau dans les territoires les plus touchés par les sécheresses. Pour en savoir plus, consultez le rapport de septembre 2020, “S’adapter au changement climatique” de l’ADEME qui décrit les conséquences du dérèglement climatique sur l’agriculture française. La sécheresse a également un impact sur le niveau des rivières et des cours d’eau, impactant les ressources piscicoles. Les poissons sont particulièrement victimes de la désoxygénation des eaux causée par la sécheresse et la chaleur. Ainsi la truite ne survit pas dans une eau à plus de 21°C. Près de 10 tonnes de poissons ont ainsi été retrouvés morts dans un lac du Val d’Oise.
Les travailleurs du BTP sont aussi plus exposés au stress thermique qui peut mener à des coups de chaleur pouvant aller jusqu’au décès. Les risques de malaises, de blessures (diminution de la vigilance), de déshydratation, et de fatigue physique et mentale sont aussi exacerbés. Au cours des deux épisodes caniculaires de l’été 2019, dix personnes sont décédées sur leur lieu de travail, dont une majorité d’hommes travaillant en extérieur. Leur métier les oblige à porter des vêtements épais et très souvent des équipements de protection qui augmentent la probabilité de stress thermique (plus faible évaporation de la sueur). La chaleur peut aussi être responsable d’une aggravation de maladies comme le diabète. Face à ces risques, la vulnérabilité des travailleurs est de plus en plus prise en compte dans les plans d’adaptation nationaux (PNACC) et par des organismes comme l’ANSES. Pourtant, il y a encore une méconnaissance des dangers liés aux coups de chaleur et à ses conséquences, à la fois pour les employeurs et les employés. Ces vulnérabilités posent des questions de justice sociale et de travail décent.
- Les habitant-es des villes :
Les conséquences sont aussi plus néfastes pour les populations urbaines : “à Paris et dans la petite couronne, le risque de mourir à cause d’une chaleur exceptionnelle est 18% plus élevé dans les communes les moins arborées que dans les plus arborées”. Les aménagements et la densité des infrastructures en ville laissent peu de place à la végétation. Cette artificialisation des sols rend la ville vulnérable aux vagues de chaleurs et aux inondations. Pour en savoir plus sur les populations et territoires les plus impactés par la crise climatique, consultez le rapport « Un Climat d’inégalités » et notre article sur le sujet.
Pour aller plus loin
Alors que la Convention Citoyenne pour le Climat est présentée en Conseil des Ministres cette semaine, plus de 100 associations, dont Notre Affaire à Tous, ont envoyé une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Alors que les propositions des citoyen-nes devaient être retranscrites dans la loi, force est de constater que le compte n’y est pas. L’étude d’impact accompagnant le projet de loi tiré de la Convention Citoyenne reconnaît ainsi que les mesures proposées ne permettront pas, en l’état, de tenir les objectifs de baisse d’émissions de 40 % à horizon 2030. Et ce, alors que cette cible est déjà en elle-même insuffisante compte tenu du nouvel objectif de -55 % adopté en décembre dernier à l’échelle de l’Europe. Les avis du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) et du Conseil National de la Transition Écologique (CNTE) confirment ces insuffisances et s’inquiètent de la faiblesse des dispositifs pour réduire les inégalités sociales.
Ce projet de loi climat insuffisant arrive en Conseil des ministres une semaine après que l’Etat français ait été condamné pour inaction climatique par le Tribunal Administratif de Paris dans l’Affaire du Siècle. Nous demandons plus d’ambition ! La revue de presse IMPACTS revient le mois prochain sur le changement climatique et les inégalités de genre.