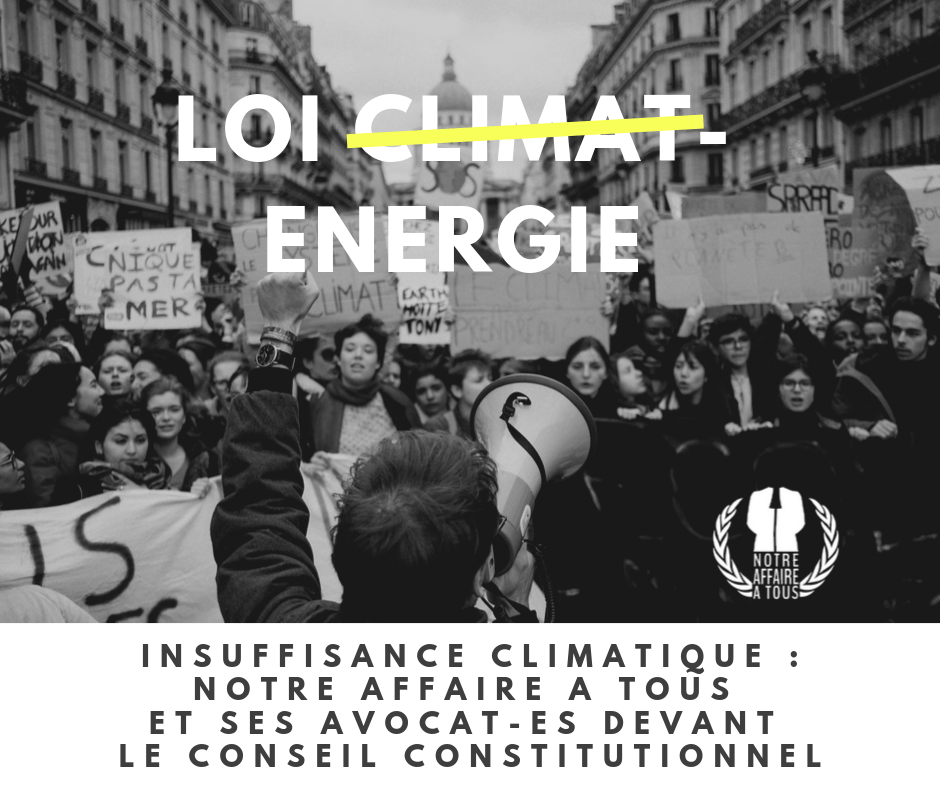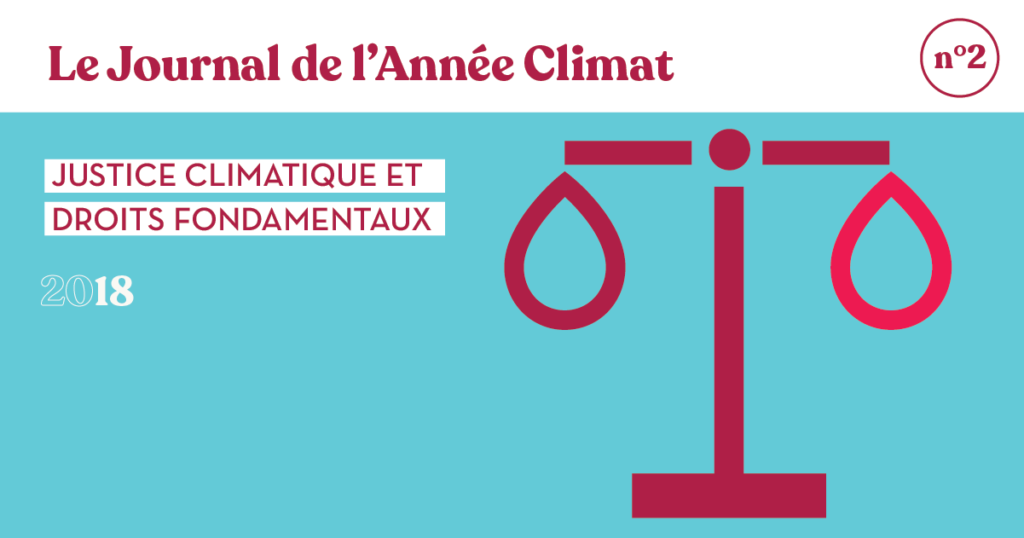En parallèle de la lutte frontale contre la politique climatique du gouvernement avec l’Affaire du Siècle, nous nous attaquons aux manifestations de cette politique : les projets imposés et polluants.
Février 2021

Ouest France, 18 février 2021
Zad du Carnet. Le recours d’une association écologiste
Jeudi 18 février, le Mouvement national de lutte pour l’environnement a déposé un recours au tribunal de Saint-Nazaire, soutenu par l’association Notre affaire à tous et des riverains du site. Ils évoquent, dans ce recours, « l’illégalité » des travaux prévus sur le site du Carnet. Ils s’interrogent notamment sur l’existence d’une déclaration de projet, pourtant obligatoire lorsqu’un aménagement affecte de manière notable l’environnement.

Reporterre, 18 février 2021
Un recours déposé contre les travaux d’extension du Grand Port maritime de Nantes-Saint-Nazaire
Jeudi 18 février, l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement 93 ainsi que des particuliers riverains soutenus par Notre Affaire à tous ont décidé de déposer un recours au tribunal de Saint-Nazaire contre les travaux d’extension du Grand Port maritime de Nantes-Saint-Nazaire sur une zone naturelle de l’estuaire de la Loire.

Reporterre, 18 février 2021
Près de Soissons, la bataille d’un maire contre une usine de laine de roche
Le maire de Courmelles, près de Soissons, a décidé de ne pas accorder de permis de construire à l’usine de laine de roche du groupe Rockwool, une position rare pour un élu local. Les opposants, réunis en collectif, craignent des dommages sur les terres et des rejets de substances néfastes pour la santé et les bâtiments historiques.

Challenges, 15 février 2021
Artificialisation des sols: quatre questions pour comprendre ce phénomène préoccupant
SERIE 1/3 – La Loi climat a été présentée mercredi 10 février en conseil des ministres. Tout un volet est consacré à la lutte contre l’artificialisation des sols, une ressource naturelle souvent oubliée. Définition de ce phénomène aux enjeux environnementaux, économiques, sociaux… et politiques.

La Croix, 11 février 2021
«Plus adapté aux enjeux actuels», le projet d’extension de l’aéroport de Roissy abandonné
Le gouvernement a abandonné jeudi le projet controversé d’extension de l’aéroport international de Roissy via la construction d’un quatrième terminal, jugeant qu’il n’était «plus adapté aux enjeux actuels», une annonce qui a néanmoins suscité la méfiance des opposants à ce chantier colossal désormais mort-né.

Le Huff Post, 11 février 2021
À l’aéroport de Roissy, le projet de nouveau terminal abandonné
Trois ans après l’arrêt de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), le projet d’extension de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, est lui aussi abandonné. Il est jugé “obsolète” à l’heure de la lutte contre le réchauffement climatique, a annoncé ce jeudi 11 février la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili au journal Le Monde.

L’Info Durable, 11 février 2021
Abandon du projet d’extension de l’aéroport de Roissy: les ONG dubitatives
Un collectif d’ONG opposées à la construction d’un quatrième terminal à l’aéroport de Roissy a réclamé jeudi des « garanties » au gouvernement après l’annonce de l’abandon du projet, s’inquiétant d’une augmentation possible malgré tout des capacités de l’aéroport.

La Gazette des Communes, 8 février 2021
Sur les projets d’aménagement, la contestation montre ses nouvelles facettes
Loin d’être enterrée par la pandémie, la fronde contre certains projets portés par les collectivités passe par des actions coups-de-poing. « Le travail des ONG a permis de mettre plus de visibilité sur les luttes et donc plus de personnes se sentent à même de contester des projets locaux », constate Chloé Gerbier.
Septembre 2020

Le Moniteur, 18 septembre 2020
Le dispositif sites industriels « clés en main » devant la justice
L’association « Notre affaire à tous » a déposé ce 17 septembre un recours en annulation devant le Conseil d’Etat contre l’annonce par l’exécutif en juillet dernier, des 66 nouveaux sites « clés en main ».

Actu Environnement, 17 septembre 2020
Sites clés en main : Notre Affaire à Tous dépose un recours devant le Conseil d’Etat
L’association Notre Affaire à Tous a annoncé ce jeudi 17 septembre le dépôt d’un recours devant le Conseil d’Etat contre les nouveaux sites « clés en main » dévoilés le 20 juillet par le Gouvernement.
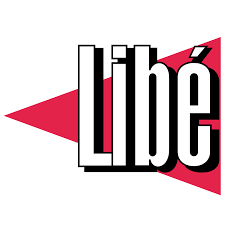
Libération, 16 septembre 2020
Tribune : Marchons pour réduire le trafic aérien
Devant l’urgence climatique, des personnalités civiles, scientifiques et militants se rassembleront, partout en France, le 3 octobre pour défendre une réduction du trafic aérien et un plan de reconversion du secteur pensé avec les salariés.
Juillet 2020

20 Minutes, 8 juillet 2020
Convention citoyenne : le gouvernement va-t-il faire machine arrière sur le moratoire des zones commerciales
Les défenseurs d’un gel des installations des grands centres commerciaux craignent que le chef de l’État ne fasse demi-tour concernant les entrepôts de e-commerce. A Rosny 2, un collectif se bat contre l’extension du deuxième centre commercial le plus rentable de France.

Reporterre, 6 juillet 2020
Des collectifs demandent un moratoire sur les projets de centres commerciaux et logistiques
Lundi 6 juillet, 68 collectifs locaux d’habitants de toute la France mobilisés contre des projets de zones commerciales ou entrepôts de e-commerce ont adressé une lettre ouverte au Président de la République. Une semaine après son allocution à la Convention citoyenne pour le climat au cours de laquelle il s’est déclaré favorable à un moratoire sur les équipements commerciaux, les citoyens exigent l’application «immédiate et sans restriction» de la promesse présidentielle.
Juin 2020

France 3 Auvergne Rhône-Alpes, 22 juin 2020
Projet Neyrpic à Saint-Martin-d’Hères : rejet du référé déposé par des opposants pour suspendre le chantier
C’est un nouveau rebondissement dans le feuilleton judiciaire qui entoure le projet Neyrpic à Saint-Martin-d’Hères (Isère). Le référé suspension déposé par des opposants contre l’exécution du permis de construire a été rejeté par le tribunal administratif de Grenoble, jeudi 18 juin.

Le Dauphiné Libéré, 22 juin 2020
Le référé suspension déposé par les opposants au projet rejeté
Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, le 18 juin, le référé suspension déposé à la fin mai par les opposants au projet Neyrpic – en l’occurrence l’association “Neyrpic Autrement” aidée par la structure de juristes pour le climat “Notre affaire à Tous” – qui réclamaient l’arrêt du chantier dans la commune de Saint-Martin-d’Hères.

Ouest France, 15 juin 2020
L’association contre l’allongement de la piste Caen-Carpiquet, dépose un recours contentieux
Après avoir déposé un recours gracieux le 19 décembre 2019 contre ce schéma d’aménagement, l’Association contre l’allongement de la Piste Caen-Carpiquet, soutenue juridiquement par l’association « Notre Affaire à tous », dépose un recours contentieux afin de demander l’annulation du Schéma de cohérence territorial de Caen-Métropole.

Reporterre, 12 juin 2020
Deux associations déposent un recours pour empêcher l’allongement de la piste de l’aéroport de Caen-Carpiquet
Vendredi 12 juin, l’association contre l’allongement de la piste Caen-Carpiquet (Acapacc), accompagnée par Notre affaire à tous, a déposé un recours en annulation du Schéma de cohérence territorial (SCoT) de Caen Métropole, qui définit les grandes lignes de l’utilisation des sols sur le territoire.

Sud Ouest, 6 juin 2020
Un droit de l’environnement assoupli pendant la crise : exceptions ou tendance de fond ?
Des ONG s’inquiètent de dérogations accordées ces dernières semaines, redoutant qu’elles ne s’inscrivent dans une tendance de fond. Coup de canif dans la protection de l’environnement, ou simples arrangements pendant la crise du coronavirus avant un retour à la normale ?
Mai 2020

L’info Durable, 27 mai 2020
Des ONG dénoncent un arrêté permettant de « contourner les règles environnementales »
Plusieurs ONG ont annoncé mercredi déposer un recours devant le Conseil d’Etat contre un récent décret permettant aux préfets de « déroger » à des normes notamment environnementales pour autoriser certains projets.

Reporterre, 27 mai 2020
Quatre associations attaquent le décret permettant de déroger aux normes environnementales
Pendant le confinement, Reporterre avait alerté des dangers que soulevait un récent décret pris par le gouvernement le 8 avril dernier : il permettait aux préfets de déroger à des normes réglementaires dans des champs d’application aussi vastes que la construction, l’aménagement du territoire, l’urbanisme ou l’environnement.

Le Figaro, 27 mai 2020
Des ONG dénoncent un arrêté permettant de «contourner les règles environnementales»
Plusieurs ONG ont annoncé mercredi déposer un recours devant le Conseil d’Etat contre un récent décret permettant aux préfets de «déroger» à des normes notamment environnementales pour autoriser certains projets.

La Relève et la Peste, 27 mai 2020
Quatre associations attaquent en justice le décret permettant aux préfets de déroger aux normes environnementale
Aujourd’hui les Amis de la Terre France, Notre Affaire à Tous, Wild Legal et Maiouri Nature Guyane déposent un recours devant le Conseil d’Etat afin d’obtenir l’annulation du décret du 8 avril 2020, qui généralise le droit des préfets à déroger à de nombreuses normes réglementaires, notamment en matière environnementale.

L’Humanité, 27 mai 2020
Le droit commun environnemental monte en défense devant le Conseil d’Etat
La crise du coronavirus va-t-elle sonner la fin du début d’un État de droit environnemental ? Quatre ONG s’en inquiètent, qui viennent de déposer un recours devant le Conseil d’État demandant l’annulation d’un décret gouvernemental pris pendant le confinement, dont la teneur le laisse entendre.

Environnement Magazine, 27 mai 2020
Décret de droit de dérogation des préfets : quatre ONG déposent un recours
Les quatre ONG, les Amis de la Terre, Notre affaire à tous, Wild Legal et Maiouri Nature Guyane, déposent un recours devant le Conseil d’Etat, pour obtenir l’annulation du décret du 8 avril 2020.

Mr Mondialisation, 27 mai 2020
Un décret contournant les normes environnementales attaqué en justice
Ce mercredi 27 mai, quatre associations attaquent en justice un décret permettant aux préfets de déroger aux normes environnementales. Ce décret, adopté pendant le confinement sous couvert d’intérêt général et de relance économique, ouvre la boîte de Pandore aux projets polluants et dévastateurs en termes écologiques. Ce qui n’est pas sans conséquence sur le droit de l’environnement français, pourtant déjà bien affaibli. Explications.

Actu Environnement, 27 mai 2020
Droit de dérogation préfectoral : quatre associations attaquent le décret devant le Conseil d’État
Faire annuler le décret du 8 avril 2020 qui généralise le droit des préfets à déroger à certaines normes, notamment dans le domaine de l’environnement. Tel est l’objet du recours déposé mercredi 27 mai devant le Conseil d’État par Les Amis de la Terre France, Notre Affaire à tous, Wild Legal et Maiouri Nature Guyane.

Les Echos, 18 mai 2020
Nouveau recours contre le projet de Terminal 4 à Roissy-CDG
Quinze associations ont déposé un recours en contentieux contre le Schéma de cohérence territoriale de Roissy-Pays-de-France. Elles demandent l’annulation du document d’urbanisme concernant l’aménagement du triangle de Gonesse et la création du Terminal 4, une extension de l’aéroport de Roissy-CDG.

Le Parisien, 14 mai 2020
Roissy : une nouvelle étape dans la contestation du terminal T4
Quinze associations réclament d’une même voix l’abandon du projet de terminal T4 et la protection des terres agricoles du Triangle de Gonesse. Elles viennent de déposer un recours en contentieux contre le Schéma de cohérence territoriale de Roissy-Pays-de-France (SCOT). Ce document d’urbanisme rend en effet possible, entre autres, la construction d’un nouveau terminal au sein de l’aéroport Charles-de-Gaulle et permet également de construire sur les parcelles actuellement cultivées du territoire.

Journal de l’Environnement, 14 mai 2020
Recours contentieux contre le T4 et le Triangle de Gonesse
Plusieurs associations ont déposé, mardi 13 mai, un recours contentieux pour obtenir l’annulation du Scot de Roissy-Pays de France qui définit l’aménagement de deux projets controversés : l’urbanisation du triangle de Gonesse et le futur Terminal T4 de l’aéroport de Paris Roissy-Charles de Gaulle.

Actu Environnement, 13 mai 2020
Extension de l’aéroport de Roissy : dépôt d’un recours contre les documents d’urbanisme
Le combat contre l’extension de l’aéroport de Roissy se poursuit : 15 associations déposent, mercredi 13 mai, un recours demandant l’annulation du document d’urbanisme définissant l’aménagement du territoire de Roissy Pays de France. Le recours vise le Schéma de Cohérence territoriale (Scot) qui s’appuie sur deux projets : l’urbanisation du triangle de Gonesse et le Terminal 4, extension de l’aéroport de Roissy CDG.
Mars 2020

Novethic, 2 mars 2020
Jugée non-conforme à l’Accord de Paris, l’extension de l’aéroport londonien d’Heathrow a été rejetée
La cour d’appel d’Angleterre a rejeté l’extension de l’aéroport londonien d’Heathrow et a motivé sa décision en s’appuyant sur l’Accord de Paris. « La décision britannique devrait faire jurisprudence », veut croire Chloé Gerbier, de Notre affaire à tous. L’association est actuellement engagée avec le collectif SuperLocal dans des batailles juridiques auprès de trois projets considérés comme polluants à Paris-Charles de Gaulle, à Caen et à Beauvais.
Février 2020

Usbek et Rica, 28 février 2020
Le projet d’extension de l’aéroport londonien d’Heathrow est rejeté au nom du climat
La justice britannique a estimé que l’extension contrevenait à l’Accord de Paris visant à limiter le réchauffement climatique. En France, 13 collectifs sont mobilisés contre plus d’une dizaine d’extensions d’aéroports prévues. Trois collectifs locaux ont monté des dossiers juridiques avec l’aide de l’ONG Notre Affaire à Tous, à Paris-Charles de Gaulle contre le projet de Terminal 4, à Caen et à Beauvais.

Journal de l’Environnement, 27 février 2020
La justice britannique s’oppose à l’agrandissement d’Heathrow
Dans un arrêt, rendu jeudi 27 février, la Cour d’appel d’Angleterre estime que le royaume a bafoué ses engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris. Une décision dont les ONG comptent bien se servir. En basant sa décision sur l’Accord de Paris le juge Keith Lindblom, «relie l’aviation à la neutralité carbone, ce qui n’était pas le cas dans l’Accord de Paris. Voilà ce qui change fondamentalement», estime Chloé Gerbier, juriste à Notre Affaire à Tous.

Reporterre, 20 février 2020
Contre l’extension de l’aéroport de Roissy, 15 associations déposent un recours
Mardi 18 février 2020, quinze associations ont déposé un recours demandant l’annulation du document d’urbanisme définissant l’aménagement du territoire de Roissy-Pays de France. Le Schéma de cohérence territoriale (Scot) de Roissy-Pays de France vise à organiser l’aménagement du territoire de la communauté d’agglomérations. Or ce document d’urbanisme pose actuellement comme acquis, deux projets : Europacity et le Terminal 4, extension de l’aéroport de Roissy CDG.

Actu Environnement, 18 février 2020
Triangle de Gonesse et terminal 4 de Roissy : des associations déposent un recours contre le SCoT
La ZAC du Triangle de Gonesse et le projet d’extension de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle comptent désormais une nouvelle procédure pour tenter de bloquer les concrétisations.

Le Parisien, 18 février 2020
Roissy : 15 associations s’unissent contre le projet de terminal 4 de l’aéroport
Une nouvelle action commune. Quinze associations opposées au projet de Terminal 4, qui doit permettre d’accueillir 40 millions de voyageurs en plus par an à Roissy-Charles-de-Gaulle d’ici à 2037, ont déposé ce mardi un recours gracieux contre le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de l’agglomération Roissy-Pays-de-France.
Décembre 2019

Reporterre, 20 décembre 2019
A Caen, un recours gracieux contre le projet d’allongement de la piste d’aéroport
Ce jeudi 19 décembre, les associations Notre affaire à tous et Acapacc (Association contre l’allongement de la piste Caen-Carpiquet) ont déposé un recours gracieux afin de demander l’annulation du schéma de cohérence territorial de Caen métropole. Celui-ci prévoit l’allongement de la piste de l’aéroport de Caen-Carpiquet, «alors même que ce projet n’a pas encore fait l’objet d’une étude d’impact aboutie et que les émissions ou nuisances qu’il entraînerait n’ont pas été mesurées», ont communiqué les deux associations.

Up Le Mag, 12 décembre 2019
SuperLocal : le combat pour le climat change d’échelle
L’objectif de ce projet ? Accompagner des collectifs locaux de citoyens mobilisés contre des projets qui menacent la biodiversité. Extensions d’aéroports, nouveaux centres commerciaux, fermes usines, nouvelles autoroutes, complexes touristiques, incinérateurs… Près de 200 sites polluants ont été recensés en France.

Le Figaro, 6 décembre 2019
Extension Roissy: des opposants veulent rencontrer Macron et Borne
Plusieurs associations ont demandé vendredi 6 décembre à rencontrer le président Macron et le gouvernement pour faire part de leur opposition au projet de Terminal 4 de l’aéroport de Roissy. Ce projet va selon elles à l’encontre des engagements de la France en matière de réchauffement climatique.

Les Echos, 4 décembre 2019
La grogne se poursuit contre l’extension de Roissy
17 associations de défense de l’environnement vont être reçues par le préfet d’Ile-de-France ce vendredi pour demander l’annulation du projet de terminal 4, extension de Roissy, au nom de l’urgence climatique.
Novembre 2019
En novembre 2019, Notre Affaire à Tous lançait, en partenariat avec d’autres collectif, l’action Super Local, aujourd’hui devenu « Recours Locaux » qui vise à l’accompagnement des citoyens et des associations en lutte contre les projets de construction imposés et polluants qui se développe près de chez eux ! Dans cette revue de presse, vous retrouverez tout les articles de presse relatif au lancement de notre belle initiative !

Reporterre, 27 novembre 2019
Tutos, aide juridique… SuperLocal veut soutenir 200 collectifs en lutte
La campagne SuperLocal souhaite aider les collectifs luttant contre les projets climaticides et injustes. Mais aussi inciter les citoyens à s’opposer aux sites polluants. La carte publiée par Reporterre compte maintenant plus de deux cents combats.

L’Info Durable, 27 novembre 2019
Le mouvement « SuperLocal » ancre la mobilisation pour le climat et la justice
Plusieurs groupes ont lancé mardi 26 novembre un mouvement baptisé SuperLocal visant à mettre en réseau les différents collectifs locaux mobilisés contre des projets ou sites jugés notamment mauvais pour l’environnement.

Positivr, 27 novembre 2019
SuperLocal recense 200 collectifs de lutte contre des projets polluants
A l’approche des municipales du mois de mars, ils n’ont qu’un seul mot d’ordre : occuper le terrain. Eux, ce sont les militants de Notre Affaire à Tous, Partager C’est Sympa, Le mouvement et Il est encore temps, des organisations qui ont beaucoup fait parler d’elles ces derniers mois pour leur combat pour le climat et la justice sociale.

Notre Temps, 26 novembre 2019
Environnement : un réseau « SuperLocal » pour les collectifs de « luttes »
Les ONG « Notre affaire à tous », partie prenante de l’action en justice contre l’Etat pour inaction face au réchauffement climatique, « Le Mouvement », spécialisée dans la mobilisation citoyenne, et la chaîne YouTube « Partager C’est Sympa », veulent accompagner les collectifs par des expertises en matière juridique, organisationnelle ou de levées de fonds par exemple.

We Demain, 8 novembre 2019
Europacity, Notre Dame des Landes… Cartographie des « grands projets inutiles »
Le média Reporterre, l’ONG Le Mouvement et le Youtubeur Partager C’est Sympa ont créé une carte collaborative des luttes contre les « grands projets inutiles et imposés » : extensions d’hypermarchés, de complexes touristiques ou de fermes intensives…

Techniques de l’Ingénieur, 29 novembre 2019
SuperLocal agit contre les projets polluants dans toute la France
Le Mouvement, Notre affaire à tous, et Partager C’est Sympa lancent un nouvel axe de mobilisation nommé SuperLocal. L’objectif : organiser des groupes de protestation contre des projets écocides ou estimés injustes dans toute la France. Pour rendre les actions efficaces, les instigateurs de la campagne veulent former des militants. Ils espèrent également interpeller l’attention des candidats aux municipales.