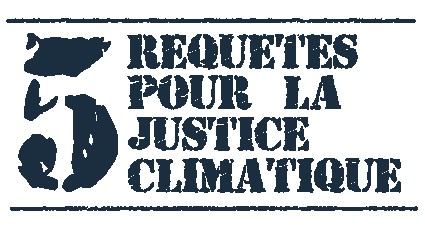La COP23 avait vocation à fixer le cadre dans lequel les Etats travailleront ensemble dans les années à venir. Notre Affaire à Tous regrette qu’au-delà des intentions, les chefs d’Etat, dont celui de la France, n’aient pas montré leur capacité à s’adapter à la donne climatique et à prendre les décisions qui s’imposent bien avant 2020.
La Chancelière Angela Merkel et le Président Emmanuel Macron se sont exprimés mercredi 15 novembre à la tribune de la COP23 à Bonn. Nous saluons leurs discours volontaristes dont deux éléments marquants : la reconnaissance par Emmanuel Macron de limites planétaires et du dépassement d’un seuil irréversible, et celle de la nécessité de mettre fin aux subventions aux énergies fossiles par Angela Merkel.
Mais si les deux chefs d’Etats s’accordent pour dire qu’il faut agir de toute urgence sans attendre un nouvel accord international, ils n’ont formulé aucune proposition concrète. Chefs de file auto-proclamés d’une Union Européenne qui s’engage pour la transition écologique, nos deux pays sont pourtant très en retard sur leurs objectifs climatiques.
L’Allemagne, qui produit encore près de 40% de son électricité à partir du charbon, est en passe de manquer ses objectifs de réduction d’émission de gaz à effet de serre d’ici 2020. A l’heure où l’énergéticien RWE est attaqué en justice par un villageois péruvien pour sa contribution au réchauffement, il est nécessaire que Mme Merkel s’engage pour une sortie rapide du charbon et pour réguler les multinationales ayant leur siège en Allemagne.
La France ne cesse de prendre du retard sur les objectifs déjà inscrits dans la loi de transition énergétique : le seuil des 50% de la part de l’énergie nucléaire prévu en 2025 vient d’être reporté, tandis que le pays prend du retard sur les objectifs actés de développement des renouvelables (15,7 plutôt que 18% en 2016). Ce retard est d’autant plus problématique que nos engagements sont en-deçà de ceux de l’Allemagne et de l’Union Européenne, et que la France fait son possible pour rendre moins contraignants les objectifs de développement des énergies renouvelables au sein des institutions.
Double discours ? Ce retard français est d’abord lié à la main-mise du nucléaire dans le mix énergétique français, et à la substitution des investissements destinés au développement des énergies renouvelables pour le parc vieillissant des centrales (70 milliards d’euros au moins). Le scénario Negawatt le montre : une sortie du nucléaire n’entraînera pas nécessairement un recours au fossile. En tant qu’association défendant les communs et les citoyen-nes, Notre Affaire à Tous rappelle que l’énergie nucléaire met en danger l’ensemble de la planète et les populations qui y vivent.
Par ailleurs, la proposition d’intégrer les questions écologiques aux futurs accords de libre échange est un peu surprenante, et tardive ! Rappelons que le CETA n’est pas climato-compatible et qu’Emmanuel Macron s’était engagé à le renégocier. Au lieu de cela, il s’apprête à le faire ratifier en bonne et due forme par le parlement français.
A la fin de la COP, nous le rappelons : Monsieur Macron il est urgent d’agir, au maximum de vos moyens, ainsi que vous y invite le droit international et vos obligations vis-à-vis des citoyen-nes français-es. Car comme vous l’avez si bien indiqué, le temps n’est plus uniquement aux discours mais aux actes. Et ces actes commencent par notre territoire, car si la France veut « make our planet great again », elle est pour le moment loin d’être irréprochable.
Au delà des discours, nous citoyen.ne.s et juristes, réclamons des actes. A cet effet, nous avons adressé il y a dix jours, cinq requêtes au Président pour faire de la France un pays leader du climat, rappelées ci-dessous. Nous ne manquerons pas de suivre avec attention leur application, et, en cas d’inaction, de recourir à la justice pour défendre le droit du climat et des habitant-e-s de cette planète :
- Inscrire le climat et les objectifs de l’Accord de Paris dans la Constitution ;
- Pénaliser les entreprises pollueuses, en reconnaissant le changement climatique comme un crime d’écocide. Rappelons qu’au niveau global 100 firmes multinationales, dont plusieurs françaises, sont responsables de 71% des émissions depuis 1988 ;
- Permettre aux citoyen-nes de défendre le climat en justice ;
- Réduire vraiment nos émissions, notamment nos émissions importées ;
- Réguler le secteur privé et sortir des énergies fossiles, à la fois dans le secteur privé et le secteur public : à titre d’exemples, la France dédouane d’impôts et subventionne Total, tandis que la Banque Publique d’Investissement (BPI) a soutenu des projets gaziers d’un montant total de 450 millions d’euros au premier semestre 2017.
Retrouvez notre campagne sur www.notreaffaireatous.org ainsi que dans cette tribune sur Libération.