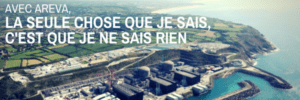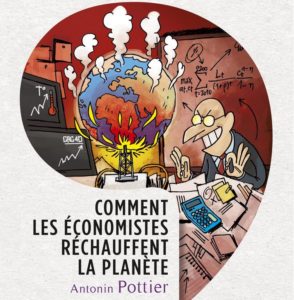Introduction
NAAT – Marie Toussaint, présidente fondatrice
NAAT a été fondée dans la suite du mouvement écocide, pour agir sur les questions juridiques de la responsabilité de l’être humain sur toutes les questions environnementales. En premier lieu, NAAT a voulu s’attaquer à la question du climat. Dans ce cadre, il est intéressant de recevoir des experts sur la question de la responsabilité de la France/des Etats dans le changement climatique. Remerciements à la maison des acteurs et à Leandro Varison, de la fondation France-libertés.
Léandro Varison – Fondation France liberté
La Fondation Danièle Mitterrand – France liberté a été créée il y a 30 ans pour défendre les droits humains, notamment le droit à l’eau et le droit des peuples et des minorités.
1er intervenant : Frédéric AMIEL – Responsable du Plaidoyer chez Emmaüs France
Emmaüs n’est pas un mouvement spécialisé dans la question climatique, mais est une association environnementale grâce à son traitement de la question du logement (fondation Abbé Pierre) et du réemploi. (premier acteur du réemploi en France, notamment pour les meubles)
Problème des « Passoires thermiques » et la question de l’impact d’une inaction en matière de rénovation des logements mal isolés : accueil et moyen de se réinsérer dans la société de personnes exclues et le devenir de ces personnes dans la pauvreté face à des événements climatiques extrêmes et l’accueil des réfugiés, qui ne se déplacent plus pour les mêmes raisons. Auparavant, on avait des réfugiés politiques ou des gens qui fuyaient des guerres ou des famines et aujourd’hui ces gens fuient des situations qui sont à la jonction des ces problématiques (guerres pour l’accès aux ressources).
Emmaüs n’a pas eu le temps de chiffrer l’impact carbone des « passoires thermiques » (cf. rapport annuel de la fondation ; mais Renovons et la Fondation Abbé Pierre ont fait ce travail). Mais sur la question de la rénovation thermique, il y a un bénéfice pour les personnes et pour le climat qui est flagrant. Si on engage un tel programme aujourd’hui, on ira dans le bon sens. Emmaüs préconise d’arrêter de traiter les problématiques en silo, séparément mais de travailler ensemble. Selon l’association, l’organisation de l’Etat et de l’Europe doit nécessairement s’adapter à un travail en coopération sur des enjeux transversaux.
Ce n’est pas juste une question sociale, écologique ou environnementale, ni un défi, c’est une problématique liée. Les acteurs associatifs se rendent compte que ces questions sont liées et qu’il y a un intérêt à travailler ensemble. Il faut que l’organisation de l’État ainsi que l’Europe, prennent conscience de la même chose, et qu’ils considèrent ces enjeux comme transversaux et non spécifiques.
7,5 millions de passoires thermiques. Problématiques du chauffage électrique, difficultés à construire des habitations à basse consommation. Programme d’investissement mixte. Les propriétaires qui ont les moyens rechignent à rénover (10% de propriétaires pauvres, les lobbys des propriétaires riches utilisent les propriétaires pauvres pour faire reculer des échéances de rénovation, qui les forceraient à investir dans la rénovation). Confrontation entre le droit de propriété et au droit à l’accès à un logement (droit de propriété indéboulonnable donc vrai chantier juridique sur cette question).
Sur la question du réemploi : récupération et revente. Par exemple : la question du recyclage du verre, alors qu’on avait une filière de consigne fonctionnelle.
3 grandes filières dans le réemploi: (remarque : paquet économie circulaire en discussion au niveau européen).
- Filière textile : la plus problématique, difficile de revaloriser les déchets textiles…le relais a développé des systèmes de laines d’isolation,
- Filière des déchets électroniques : niches, filière qui est en train de se mettre en place. En effet, les gens ont du mal à savoir où apporter leurs produits électroniques, les modes de consommation ont changé (renouvellement du matériel électronique plus fréquent) mais les gens continuent de garder leurs produits défectueux chez eux, car ils ne savent pas où les mettre et qu’ils n’ont pas pris l’habitude de les recycler. Il y a aussi le problème de l’obsolescence programmée (enjeu de la pérennisation des appareils électroniques.) Ex : ateliers du bocage… peu de visibilité de prospective (manque de connaissance sur la filière), Est-ce qu’on résiste à cette dynamique pour créer des produits plus facile à réparer et à utiliser ? Il y a un équilibre à trouver pour savoir quelle orientation prendre. On a besoin d’évaluations sur l’impact de l’extraction des ressources et sur les droits des personnes dans les pays de production : choisir entre soit un modèle de recyclage efficace, soit la pérennisation des produits électroniques. C’est un enjeu important sur lequel on n’a que peu de visibilité prospective.
- Filière des déchets d’ameublement : un meuble qui n’est plus utilisé peut souvent encore être utilisé et n’est pas forcément hors d’usage ( Ex : Meubles en bois). Comment éviter la concurrence avec la production d’énergie (réduction en plaquette pour les chaudières à bois)? à quel moment on décide qu’un meuble est un déchet ? c’est une vraie question de filière. Puis autre problème : la qualité des meubles : tendance à réaménager un appartement à chaque déménagement, avec des meubles dont la durée de vie est de plus en plus courte (quelques années). On met beaucoup de meubles sur le trottoir alors qu’ils sont toujours réutilisables. Bois de mauvaise qualité donc difficile à réparer etc. durabilité des objets. Travail à faire auprès des acteurs de la filière industrielle (type IKEA) pour remettre en cause les pratiques.
Et la question des acteurs des filières de réemploi (question plus politique). En effet, il se crée un « marché » du réemploi…pas forcément envie de voir arriver une forme de mercantilisation et de financiarisation de la filière du réemploi. Un des grands combat dans le cadre du paquet économie circulaire, c’est la place des acteurs (importance des acteurs de l’ESS) et les deux questions sont aujourd’hui traitée de deux manières (les acteurs de la filière de l’ESS et le réemploi). En France le rôle des acteurs solidaires est bien reconnu, on compte sur la France pour appuyer cela auprès de l’UE. Ajd la question de la réévalualisation solidaire et celle du réemploi sont traitées de façon distinctes alors qu’elles devraient l’être ensemble.
Quels sont les obstacles que rencontrent les acteurs comme Emmaüs ?
La rénovation énergétique n’est pas gagnante du point de vue du capital. En France, politique de la construction en neuf et pas dans la rénovation. Et question du rôle des financements privés. Parc social privé : il faut le pousser à investir dans la rénovation thermique, or ils n’y ont pas vraiment intérêt. Le problème est que ce sont les locataires qui gagnent à la rénovation thermique (le propriétaire exige souvent une participation pour les travaux qui contrevient au à l’obligation du clos et du couvert). Et idée : annexer les taux d’intérêts à la qualité de la rénovation. L’équipe de Renovons.org est particulièrement pointue sur ces sujets et devrait être questionnée dans le cadre du recours.
Quelle responsabilité de l’Etat ? Responsabilité de l’Etat sur le développement du chauffage électrique. La nature de la production électrique en France est un problème. Le bas cout de l’électricité à conduit à produire des logements mal isolés. Ensemble de conséquence en cascade (Le CLER). Edf est une entreprise publique (Etat actionnaire à 85%). Au moment du lancement du nucléaire en France, on ne s’est pas du tout posé la question de la ressource du nucléaire (aujourd’hui comptabilisé en énergie produite mais en matériau importé). cf. Pays qui ont interdit le chauffage électrique (Belgique, Danemark) au nom de inefficacité énergétique.
L’Effort porte sur la construction du bâti. Il faut construire. Incitation à l’acquisition dans le neuf (et pas forcément dans l’ancien rénové). Comment inciter les personnes à aller vers de l’ancien rénové ? Et pas du neuf? La prise de risque de l’Etat est certaine. L’effet démultiplicateur dans un Etat comme la France ne viendra qu’avec une politique de planification de l’Etat. L’efficacité énergétique requiert une planification de l’Etat (le développement des initiatives privés pourraient nuire à l’efficacité politique. La loi de transition énergétique est une première étape mais ce n’est pas suffisant. Renvoie à la responsabilité des acteurs notamment à EDF qui se comporte comme un agent autonome et qui ne va pas dans le sens de l’Etat.
Quid d’une loi pour imposer l’utilisation de bois dans les construction ? Lutte d’influence entre les cimentiers et les producteurs de bois français (pour écouler leurs produits). Mais en ce qui concerne le bois : il faut se poser la question de la disponibilité de la ressource bois. Aujourd’hui, le bois proviens principalement des forêts publiques… la demande conduit à exercer une trop forte Pression sur la foret publique.
Et ensuite, il faut se poser la question de la provenance du bois : utilisation de bois tropical et boréal.
Se poser la question de la ressource. La partie exploitable du bois doit être réfléchie, c’est à partir de là qu’il faut l’utiliser dans la construction. Il faut d’abord identifier de combien de bois on dispose pour ensuite fixer des objectifs, et non pas l’inverse. Aujourd’hui on fixe des objectifs sans se poser la question de la ressource !
En aire urbaine, la question des logements vides, problème de la spéculation immobilière. (pays bas etc.). augmentation du prix des loyers, empêche d’investir dans la rénovation.
Sur le réemploi, y a-t-il qqchose d’utilisable pour NAAT ?
Question de obsolescence programmée (question des garanties, des services après-vent incitent à créer des produits qui vont tomber en panne. La réglementation actuelle incite à une forme de surconsommation, de surproduction de biens, incite les producteurs à créer des produits qui vont tomber en panne. Vraie question réglementaire à adopter.
Etude du club de Rome montrant que l’économie circulaire permettrait de réduire de 60% les émissions de gaz à effet de serre.
2eme intervenant : Frederic Le Manach – Directeur scientifique chez Bloom
Lien entre océan et climat. Le petit guide pour éviter de dire de grosses bêtises. L’océan est le régulateur du climat de la planète. 98% de la biosphère. 97% de l’eau, produit 50% de l’oxygène de que l’on respire et absorbe 50% du CO2. Pour la première fois dans la COP21, on a inclut l’océan. Le niveau de l’océan. Depuis 1900, le niveau de l’océan a grimpé de plus de 20 cm et il va monter de 80 cm d’ici 2100. iles du pacifique rasées, les pays bas… en période de tempête, ça peut raser un paysage (exemples : xynthia, le Bangladesh…). Va créer des migrations importantes.
Sur les courants marins : l’océan est le tampon du climat de la terre car absorbe la chaleur et la rejette (gulfstream). Circulation thermohaline. En traversant l’Atlantique le courant va relâcher l’excès de chaleur. Le réchauffement climatique va influencer les précipitations, changer la salinité de l’eau, changer la température de l’eau, cela va influencer forcément les courants. Influence les précipitations, le réchauffement climatique va changer la température de l’eau.
Les phénomènes climatiques (el nino). Impact sur les coraux qui sont une zone de reproduction des poissons ou de nurserie. Mort des coraux dans la grande barrière de corail par le phénomène de blanchissement.
Acidification de l’océan… L’océan absorbe le CO2 au contact de l’air, cela fait diminuer le PH de l’eau, elle devient donc acide. Cela impacte aussi les coraux, le calcaire se forme de moins en moins bien (impact sur les coraux et les algues composé de calcaire). Ajd plus de 90 % de la grande barrière de corail est touchée. 50 % de la barrière est morte. Cette année on retrouve aussi un phénomène de blanchissement sans précédents. Les communautés locales du pacifique en dépendent. Remplacement d’espèces dans l’océan…
Certains poissons des bas fond de l’océan absorbent et stockent le carbone (le séquestre). Les communautés de poissons au fond de l’océan (-1500m), remontent pour se nourrir en période nocturne et absorbe le carbone. Quand ils redescendent au fond de l’océan, ils vont séquestrer le carbone qui était en surface (par leurs déjections, en se faisant manger, etc.). C’est le seul moyen de séquestrer le carbone Donc il faut laisser tranquille ses poissons en profondeur. Aux UK, ces poissons stockent autant de carbone que les usines de stockage à 1 milliard d’euros.
Les poissons migrent. Ils sont à la température de leur milieu ambiant ; (sang froid). Suivent les massent d’eau qui leur convienne le mieux. Des scientifiques ont montré que dans la ceinture tropicale, il allait y avoir 40 % de pertes de poissons qui allaient migrer en Europe. Plus on va vers les pôles, plus on va récupérer le poisson en provenance de l’équateur. Injustice climatique car les responsables du réchauffement vont récupérer les poissons qui migrent (alors qu’ils pêchent dans les zones tropicales depuis les 70s à cause de la surpêche).
En France, 2 zones majeures risquent de subir les effets de l’augmentation du niveau de l’océan : la Camargue, la Gironde, (développement de constructions sur le littoral). Il y a eu un développement des constructions sur des marécages sans penser à la montée des eaux.
En France d’autres impacts vont avoir lieu dans les DOM TOM, qui contiennent des récifs coralliens, notamment dans les Caraïbes. On voit déjà les migrations de poissons tropicaux qu’on ne voyait pas il y a 20 ans, idem en Bretagne.
Humidité ambiante qui pourrait se développer. Outre-mer : massif corallien (caraïbes). On peut voir des poissons tropicaux en méditerranée…
Il faut suivre les objectifs de développement durable fixés par l’ONU en 2015. Objectifs 14, qui touchent à l’océan montre qu’il y a plein de mesures détaillées sur les méthodes de pêche destructrices. La France ne respecte pas du tout ces objectifs.
Méthodes de pèches destructrices… on fait tout l’inverse. Technique de pêche électrique… interdite en Europe depuis 98… 10% de la flotte… équipé d’électrode… et la senne danoise (filet qui encercle les bancs de poissons.
Pêche électrique, un lobby néerlandais cherche à pousser l’UE à supprimer l’interdiction de cette pêche. Problème que cela consomme moins de carburant, cet argument est très utilisé pour favoriser cette technique de pêche.
Phénomène de la Senne Danoise (filet qui encercle les bancs de poissons), engin de pêche utilisé au fond de l’océan, deux câbles métalliques vibrent, phénomène d’attraction du poisson, non sélectif. Des millions d’euros de subvention sont accordés pour tester ces nouvelles méthodes.
La pêche artisanale, plus vertueuse, a, malheureusement, un bilan carbone plus mauvais que ces techniques industrielles.
3eme intervenant : Benoit Lebot – Association Negawatt
La transition énergique n’est plus une option. Il faut pour cela bien cerner pourquoi face à la lutte contre le changement climatique, la transition est nécessaire.
Ce qui nous sépare de la dernière glaciation (environ – 10 000 ans) se résument à quelques degrés (-5°C) par rapport à la moyenne des températures d’aujourd’hui. Avec -5°C notre planète avait un tout autre visage : la couche de glace du pole Nord s’entendait sur une grosse partie de l’Amérique du nord, de l’Europe et de l’Asie. Les océans étaient plus bas de 120m par rapport au niveau d’aujourd’hui, le Sahara était une forêt tropicale, etc…
La changement climatique en cours, généré par les activités humaines pourrait engager un réchauffement de quelques degrés en moins de un siècle, entrainant une nouvelle physionomie de la terre qu’il est difficile d’appréhender.
Ce changement climatique est la conséquence de renforcement de l’effet de serre, renforcement généré par une accélération des activités humaines depuis moins de deux siècles seulement. Les conséquences du changement climatique sont déjà perceptibles avec au moins trois paramètres qui changent : Augmentation du régime des précipitations, dilatation des océans, augmentation de la température moyenne à la surface de la terre.
Afin de limiter ce changement climatique, il convient de réduire drastiquement ses causes. L’amplification de l’effet de serre est dû à la fois par le recours massifs à des ressources d’énergie carbonée que sont le charbon minéral, le pétrole et le gaz, et d’autre part par à la déforestation et à l’usage des sols (agriculture et intrants pour la production agricole). Réduire le changement climatique impose de dé-carboner l’ensemble des secteurs économiques.
Il se trouve par ailleurs que les états les plus vulnérables aujourd’hui au changement climatique sont ceux qui y ont le moins contribué.
« Nous sommes la première génération à savoir, nous sommes la dernière génération à pouvoir ».
Décarboner le secteur de l’énergie est parfaitement possible et à notre portée. L’effort consiste à promouvoir la sobriété énergétique, augmenter l’efficacité énergétique, recourir aux énergies renouvelables, et encourager la séquestration (reboiser massivement).
L’Association négawatt propose une trajectoire pour on peut décarboner en 35 ans la France.
Le monde négawatt 2017-2050. Les bénéfices du scénario Negawatt vont bien au-delà de la réduction des gaz à effet de serre. La transition énergétique permet de réduire les pollutions locales – notamment de l’air dans les villes-, d’améliorer la productivité sur les chaines de production industrielle, d’assurer l’indépendance énergétique du pays, de contribuer à des créations d’emplois massif sur le long terme…
Benoit LEBOT Negawatt Notre Affaire à Tous 18 Mars 2017
4ème intervenant : Hervé Le Treut – Climatologue du GIEC
Retour très rapide sur l’historique du climat :
1957 : premières mesures du réchauffement climatique
1980 : premier programme de recherche pour le climat
1988 : GIEC
1992 : sommet de la Terre Rio suivie d’une augmentation brutale à partir des 90s venant de la Chine. Un plafonnement est ainsi institué car les pays en développement se sont mis à émettre.
Pendant 20 ans, le seul outil qui a permis de dire que le climat allait changer fut les modèles scientifiques d’évolution climatique. La plus grande difficulté qui s’est présentée aux scientifiques : les GES restent longtemps dans l’atmosphère, ayant un impact sur le climat de nombreuses années après avoir été émis. La moitié des émissions de GES reste ainsi un siècle dans l’atmosphère. Le réchauffement d’aujourd’hui est la conséquence des émissions d’il y a 10, 20, 30 ans…
Il y a environ 10 modèles climatiques et ils ne disent pas tous la même chose, bien qu’en 2007, il est désormais affirmé que le « réchauffement climatique est sans équivoque ». Les medias jouent un très grand rôle sur la manière dont ces modèles sont traités : ainsi, alors que le chiffre de +6°C a longtemps été évoqué par les scientifiques au vu de ces modèles, les medias demandant des chiffres ont écrété et diminué ce risque en reprenant un chiffre inférieur dans leurs articles.
Il est ainsi complexe de contraindre les Etats sur ces modèles et au niveau de °C : mieux vaut contraindre les Etats sur des trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Or, les contributions actuelles des Etats (exprimées notamment lors des COP21 et COP22) ne suffisent pas à rester sous le seuil des deux degrés…
Parmi les scénarii possibles pour juguler le dérèglement climatique, les plus ambitieux posent clairement la question sociale : combien d’emplois sommes-nous à même de détruire ou de convertir afin d’atteindre nos objectifs ? A quel point sommes-nous prêts à modifier nos manières de produire, de consommer, de détruire ? Parmi les scénarii les plus ambitieux, sur la base notamment du rapport de James Hansen de la NASA, il s’agit d’aller vers des émissions négatives dans les pays développés, grâce notamment à la captation du carbone (possible par certaines technologies mais aussi par la photosynthèse). Un objectif réaliste : supprimer d’ici la fin du siècle l’utilisation des énergies fossiles.
La difficulté est bel et bien politique : car la facilité et le court-terme permettent d’agir dans les secteurs où il est facile de réduire les émissions, là où l’urgence et la nécessité imposeraient plutôt de commencer par les secteurs les plus difficiles à faire évoluer.
Il convient ainsi de garder en tête que le cout de la non action va etre collossal, par rapport au cout de l’action !
LeTreut-Mars-2017