Le 23 juillet 2025, la Cour internationale de Justice (CIJ) rendra un avis consultatif très attendu sur les obligations juridiques des États en matière de changement climatique. Saisie par l’Assemblée générale des Nations Unies, la Cour devra répondre à deux questions déterminantes : quelles sont les obligations des États, en vertu du droit international, face à la crise climatique ? Quelles sont les conséquences juridiques en cas de manquement ?
Bien que non contraignant, cet avis consultatif constitue une interprétation faisant autorité du droit international. Intervenant après la publication de l’avis consultatif historique de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIADH) sur l’urgence climatique et les droits humains le 3 juillet dernier, il pourrait redéfinir les contours du régime international applicable au climat, notamment en matière de prévention des dommages, de droits humains, de responsabilité étatique, et de coopération.
Le processus de l’adoption de l’avis consultatif a déjà marqué l’histoire de la CIJ : 91 États ont déposé des mémoires écrits, et 97 ont pris part aux audiences orales. Ce rapport en synthétise les principales lignes de clivage et met en lumière les positions clefs portées par les États devant la Cour.
- Les obligations des États en vertu du droit international en matière climatique
Les contributions des États sur la question des obligations juridiques se structurent principalement autour de cinq grands axes : le droit applicable (A), les droits humains (B), le principe de prévention (C), le principe des responsabilités communes mais différenciées (D), et les obligations des États à l’égard des acteurs privés (E).
Quatre de ces thématiques ont concentré l’essentiel des développements : les droits humains ont fait l’objet du plus grand nombre d’arguments (87), suivis par les discussions sur le droit applicable (77), puis sur le principe de prévention et le principe des responsabilités communes mais différenciées (58). Cette hiérarchie reflète une dynamique argumentative forte en faveur d’une interprétation intégrée et interdisciplinaire du droit international applicable en matière climatique — croisant normes environnementales, obligations de prévention et droits fondamentaux.
Thématiques les plus évoquées dans les contributions étatiques s’agissant des obligations des États en matière climatique :
- Les normes applicables aux obligations des États en matière climatique
Un nombre très substantiel d’États (46) ont soutenu que les obligations climatiques des États s’ancrent dans un corpus juridique international bien plus large que le seul régime conventionnel (CCNUCC, Protocole de Kyoto, Accord de Paris). Selon eux, ces obligations trouvent également leur source dans le droit international coutumier, le droit international de l’environnement, le droit international des droits de l’homme, le droit de la mer, le droit des conflits armés, ou encore le droit international relatif aux catastrophes. Plusieurs États — Mexique, Micronésie, Gambie notamment — ont également soutenu que les obligations découlant des traités climatiques existent, ou doivent être interprétées comme existant, en harmonie avec d’autres sphères du droit international. D’autres — le Chili, le Costa Rica, la France, le Guatemala et la Gambie — ont explicitement réfuté l’idée que les instruments climatiques sont une lex specialis, affirmant que ceux-ci doivent être interprétés de manière compatible avec les engagements juridiques internationaux existants. De manière convergente, la Barbade, le Burkina Faso, les Palaos, la République démocratique du Congo, la Gambie, le Soudan et l’Uruguay ont affirmé que les traités climatiques ne sauraient supplanter ni écarter les autres normes internationales applicables.
Cette position majoritaire s’inscrit dans la continuité de l’avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIADH) du 3 juillet dernier, qui affirme non seulement l’unité du droit international applicable aux enjeux climatiques, mais surtout la reconnaissance de normes impératives (jus cogens) protégeant l’environnement, au fondement des obligations des États [1].
À l’inverse, un groupe minoritaire de 19 États a défendu une lecture étroite des obligations climatiques, cantonnées au régime conventionnel. L’Afrique du Sud, le Brésil, les États-Unis, la France, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan et Singapour ont ainsi soutenu que les obligations des États en matière de changement climatique relèvent essentiellement des traités climatiques existants. Certains États sont allés encore plus loin, en allant jusqu’à qualifier les traités climatiques existants de lex specialis, excluant par là même toute application parallèle d’autres normes juridiques internationales. C’est notamment la position de l’Arabie saoudite, de la Russie, de la Chine, de l’Inde, de l’Iran, du Koweït, du Japon et du Royaume-Uni. Enfin, d’autres États comme l’Allemagne, l’Australie, le Canada et la Corée du Sud ont présenté un argument distinct mais similaire, estimant que d’autres sources du droit international (par exemple, le droit international des droits de l’homme) doivent être interprétées à la lumière des obligations établies par le régime conventionnel climatique.
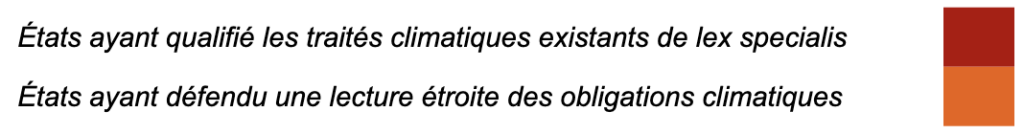
- La protection des droits humains
La question de la protection des droits humains face à la crise climatique a occupé une place centrale dans de nombreuses contributions étatiques et est un enjeu majeur de l’avis à venir de la CIJ, dont le rôle premier n’est pas la protection des droits humains. Dix États l’ont ainsi appelée à reconnaître la pertinence du droit à un environnement sain, la Slovénie estimant que ce droit constitue une condition préalable à la jouissance des autres droits humains – comme l’a d’ailleurs rappelé la CIADH le 3 juillet dernier. La CIADH a en outre consacré le droit autonome à un climat sain, découlant du droit à un environnement sain [2].
Les États n’ont toutefois pas été unanimes dans leurs contributions : l’Arabie saoudite a jugé le droit à un environnement sain “non pertinent”, tandis que les États-Unis et la Russie ont soutenu qu’il n’est actuellement pas consacré par le droit international.
En outre, certains petits États insulaires en développement (PEID), tels que le Vanuatu, les Fidji et Tuvalu, ont souligné l’importance de protéger leur droit à l’autodétermination face à une élévation extrême du niveau de la mer. La Roumanie est allée plus loin, affirmant que ces PEID ont non seulement le droit, mais aussi l’obligation positive, d’agir pour préserver leur existence en tant qu’États.
Le Vanuatu et les Îles Cook ont quant à eux estimé que les interdictions de discrimination raciale et de genre sont applicables dans le contexte du changement climatique. L’Albanie a adopté une approche plus large, demandant à la Cour de déterminer les obligations des États à travers cette perspective intersectionnelle.
Dix États ont estimé que les obligations des États en matière de droits humains dans le contexte du changement climatique s’appliquent extraterritorialement, tandis que cinq États (dont la Corée du Sud, les États-Unis et la Russie), ont considéré que ces obligations ne s’étendent qu’aux individus se trouvant sur le territoire de l’État ou relevant de sa juridiction. D’autres États ont tenté de définir des critères d’applicabilité extraterritoriale. L’Albanie a soutenu que l’application extraterritoriale ne peut avoir lieu que sous deux conditions : (i) il doit exister un lien de causalité clair entre la violation alléguée et l’acte ou l’omission de l’État, et (ii) la conduite en cause a eu un impact direct et prévisible sur les droits humains d’un individu. Certains ont également argumenté que les droits humains ne peuvent s’appliquer extraterritorialement que dans des circonstances exceptionnelles, telles que s’agissant du jus cogens (le Canada), en matière de discrimination raciale (les Îles Cook), pour le droit à l’autodétermination (la Micronésie) ou encore pour le droit à l’eau (la Namibie).
Enfin, seize États ont soutenu que les droits des générations futures doivent être reconnus et protégés au moyen d’obligations incombant aux États, notamment au titre de l’Accord de Paris. Le Pérou a ainsi estimé que le respect de l’équité intergénérationnelle exige que les États entreprennent des mesures d’adaptation et d’atténuation tandis que la France a plaidé pour la prise en compte de ce principe dans la détermination des contributions déterminées au niveau national (CDN).
Comme souligné par la CIADH dans son avis consultatif du 3 juillet [3], le principe d’équité intergénérationnelle est déjà pris en compte par diverses institutions et tribunaux internationaux, dont la Cour internationale de justice [4], le Tribunal international du droit de la mer [5], la Cour européenne des droits de l’homme [6], en sus des tribunaux nationaux. À ce titre, la CIADH a précisé que le droit à un climat sain doit bénéficier aux générations futures [7].
La protection des générations futures ne semble néanmoins toujours pas faire consensus, l’Allemagne et la Russie ayant affirmé que les actes ou omissions commis à l’encontre de « personnes abstraites » futures ne pouvaient constituer des violations des traités relatifs aux droits humains applicables.
- Le principe de prévention et les obligations de due diligence
Trois axes de débat principaux se sont dégagés quant à la portée et à la nature juridique du principe de prévention qui impose aux États l’obligation d’éviter de causer des dommages environnementaux. Ce principe est reconnu comme l’une des pierres angulaires du droit international de l’environnement.
Premièrement, la question de l’extension du principe aux dommages transfrontières causés par les émissions anthropiques de gaz à effet de serre (GES) — c’est-à-dire au-delà des seuls États voisins — a suscité des positions contrastées. Vingt-deux États ont plaidé en faveur d’une interprétation élargie, incluant les effets globaux des émissions, indépendamment de la proximité géographique entre États. À l’inverse, certains États — notamment l’Arabie saoudite, l’Australie, le Canada, les pays nordiques et le Royaume-Uni — ont soutenu que le principe de prévention ne saurait s’appliquer aux émissions de GES ni, plus largement, à la problématique du changement climatique. Une telle approche s’inscrit en porte-à-faux avec l’avis rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme le 3 juillet 2025 : elle a en effet considéré que, bien que le principe de prévention ait été historiquement formulé dans le cadre des relations interétatiques, les obligations qu’il implique sont analogues à celles découlant du devoir général de prévenir les violations des droits de l’homme. Dès lors, un État est tenu d’adopter des mesures préventives tant à l’égard des activités susceptibles de porter atteinte aux droits humains que de celles comportant un risque environnemental au-delà de son territoire [8].
Deuxièmement, plusieurs divergences sont apparues quant à l’applicabilité temporelle du principe de prévention. La Micronésie et Nauru ont plaidé pour une application du principe aux émissions historiques de GES, considérant qu’il ne saurait être limité aux seules émissions récentes. La France, pour sa part, a proposé une approche plus nuancée, invitant la Cour à déterminer à partir de quelle date une obligation juridique de prévention est apparue. Selon elle, une telle analyse implique : (i) d’identifier le moment où le droit international a évolué d’un devoir de prévention circonscrit aux dommages transfrontières entre États voisins vers une obligation à portée globale ; et (ii) de déterminer la période à partir de laquelle les États ont eu une connaissance suffisante du caractère dommageable des émissions de GES.
Troisièmement, la nature de l’obligation découlant du principe de prévention a été discutée. Alors que la Barbade a défendu l’existence d’une obligation de résultat, les Émirats arabes unis et le Japon ont, au contraire, soutenu qu’il s’agissait d’une obligation de comportement de moyens.
S’est également posée la question du niveau de “due diligence” requise dans la mise en œuvre de cette obligation de prévention. Trois États — les Bahamas, le Costa Rica et les Philippines — ont soutenu que les États doivent faire preuve de diligence raisonnable dans la réduction de leurs émissions de GES, par l’adoption de mesures proactives proportionnées à leurs capacités et fondées sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles, notamment celles du GIEC. Le Mexique a précisé cette analyse en identifiant quatre critères interdépendants permettant d’apprécier le respect de cette diligence : (i) l’élaboration et la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national (CDN) ; (ii) la prise en compte des pertes et préjudices ; (iii) l’allocation de ressources financières ; et (iv) le transfert de technologies ainsi que le renforcement des capacités. Les Seychelles ont, pour leur part, souligné qu’une diligence suffisante implique une mise en œuvre effective des CDN avec une ambition croissante, tandis que la Gambie a mis l’accent sur la nécessité de réaliser des évaluations d’impact environnemental.
Enfin, sept États — dont la France — ont plaidé pour une due diligence renforcée. Antigua-et-Barbuda a proposé que des exigences de diligence accrues soient imposées aux grands émetteurs historiques, tandis que la Suisse a limité une telle exigence renforcée aux principaux émetteurs actuels. Cette approche a été critiquée par les États-Unis, qui ont contesté toute base juridique permettant d’imposer des obligations différenciées en matière de diligence entre États.
- Le principe des responsabilités communes mais différenciées
Conformément au principe des responsabilités communes mais différenciées (common but differentiated responsibilities – CBDR), lié à l’équité intergénérationnelle, il est attendu des États qu’ils assurent une répartition équitable des charges liées à l’action climatique et aux impacts climatiques, en tenant compte de leur contribution historique aux causes du changement climatique et de leurs capacités respectives [9].
Ce principe a été au cœur de débats, tout comme il l’avait été en amont de la publication de l’avis consultatif de la CIADH, aussi bien s’agissant de sa définition que de sa portée. Seize États ont affirmé que les États développés — ceux disposant de ressources plus importantes et portant historiquement une responsabilité disproportionnée dans les émissions mondiales de GES — sont tenus de prendre l’initiative dans la lutte contre le changement climatique, notamment par le biais du renforcement des capacités, de l’assistance financière et/ou du transfert de technologies. Certains États, comme la Roumanie, ont toutefois considéré que la responsabilité historique ne devait pas être prise en compte pour définir les obligations juridiques des États au titre du principe CBDR. De même, la distinction entre État développé et État en développement a été débattu, la République démocratique du Congo, les Bahamas et les Émirats arabes unis estimant que la Cour devait prendre en compte les capacités évolutives des économies émergentes, bien que classées à ce jour comme « États en développement ». Nauru a en outre demandé à la CIJ de tenir compte des vulnérabilités géographiques des pays enclavés et montagneux.
L’appréciation de la portée du principe CBDR n’a pas fait l’unanimité : alors que l’Équateur a soutenu qu’il impose une obligation de diligence aux États, les contraignant à prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les émissions de GES de manière proportionnée à leurs contributions historiques, le Canada a affirmé que le CBDR ne crée pas d’obligations juridiques pour les États. Des divergences d’opinion peuvent également être notées quant aux obligations concernées par le principe : certains ont pu avancer qu’il devait éclairer l’interprétation des obligations liées au climat en général tandis que d’autres ont cherché à le cantonner à l’Accord de Paris, voire à minimiser son importance au sein de l’Accord (il ne constituerait pas un principe global selon les États-Unis).
Les États étaient également divisés sur l’existence d’une obligation de financement en vertu du droit international. Alors que le Costa Rica et le Kenya ont soutenu que les États ont une obligation juridique de fournir une compensation pour les pertes et préjudices liés au changement climatique, l’Allemagne a affirmé que cette compensation devrait rester purement volontaire.
- La responsabilité des acteurs privés
Plusieurs contributions ont porté sur les obligations des États à l’égard des acteurs privés dans la lutte contre le changement climatique. Comme l’a rappelé la CIADH le 3 juillet dernier, “il ne fait aucun doute que les entreprises sont appelées à jouer un rôle fondamental dans la lutte contre l’urgence climatique” et sont tenues de le faire [10]. Les instances internationales sont unanimes à ce propos : ce ne sont pas seulement les États, sujets de droit naturels du droit international public, mais également les entreprises qui ont des “obligations et responsabilités en ce qui concerne le changement climatique et ses impacts […] sur les droits humains” [11].
Onze États ont ainsi affirmé leur obligation de réglementer la conduite des acteurs privés relevant de leur juridiction afin de prévenir les dommages, certains mentionnant plus spécifiquement une obligation de réglementer la conduite des acteurs privés générant des émissions de GES ou portant atteinte aux droits humains.
Des arguments ont également été avancés concernant l’importance de prévoir des cadres juridiques contraignants dans le contexte de la régulation des activités des acteurs privés opérant sur le territoire d’un État (Serbie), ainsi que la nécessité de garantir l’exercice d’une diligence raisonnable — en particulier concernant les impacts environnementaux négatifs — tout au long des chaînes d’approvisionnement des acteurs privés (Namibie).
- Les conséquences juridiques
La seconde question posée à la CIJ concernant les conséquences juridiques en cas de manquement aux obligations a suscité de nombreuses discussions sur le cadre juridique de applicable, avec pas moins de 54 contributions sur le sujet (A), ainsi que sur les enjeux de causalité, d’attribution et de responsabilité historique et collective, sur lesquels 29 argumentaires ont été formulés (B), suivies par l’enjeu de la réparation des dommages climatiques (21) (C), et, enfin, de la cessation et de la non-répétition des manquements (3) (D).
Thématiques les plus évoquées dans les contributions étatiques s’agissant des conséquences juridiques en cas de manquement aux obligations :
- Le cadre juridique applicable
Les États ont été divisés sur le cadre juridique de référence applicable pour déterminer les conséquences juridiques d’une violation de leurs obligations climatiques.
De nombreux États (43) ont affirmé que le droit international général de la responsabilité des États s’applique en cas de manquement. L’Arabie saoudite, le Canada, la Chine, la France, le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont au contraire soutenu que les conséquences juridiques doivent être plus strictement déduites des mécanismes de conformité prévus par le régime conventionnel climatique. Enfin, l’Afrique du Sud et l’Espagne ont plaidé pour un examen au cas par cas de la question des conséquences juridiques.
- Les enjeux de causalité, d’attribution et de responsabilité historique et collective
Les enjeux de la causalité se sont avérés aussi centraux que controversés. L’Australie, l’Espagne, les États-Unis, le Koweït et le Timor-Leste ont affirmé que la réparation des préjudices liés au changement climatique nécessite l’établissement d’un lien de causalité clair entre les émissions de GES et le dommage en question, tandis que la France a soutenu que les critères de causalité doivent être définis au cas par cas. Les pays nordiques sont allés plus loin, affirmant que la causalité ne peut être traitée de manière abstraite. En réponse, l’Albanie, Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, le Belize, le Guatemala et la Zambie ont soutenu que l’engagement de la responsabilité pour obtenir réparation ne devait pas être exclu par les difficultés à établir la causalité. Leur position s’inscrit dans la lignée de l’avis de la CIADH du 3 juillet, qui a souligné la possibilité de présumer un lien de causalité entre les émissions de GES et la dégradation du système climatique, ainsi que celui existant entre cette dégradation et les risques qu’elle engendre sur les systèmes naturels et les populations [12].
La question de l’attribution d’un dommage climatique à un ou plusieurs États a également fait l’objet de débats. Si la Russie a soutenu que cela est impossible, le Chili, le Costa Rica, le Ghana et les Samoa ont affirmé qu’une telle attribution peut être établie sur la base d’un consensus scientifique reconnu.
Enfin, des divergences de positionnement peuvent être constatées s’agissant du caractère individuel ou collectif de la responsabilité étatique. Six États (Micronésie, République démocratique du Congo, Samoa, Comores, Vietnam et Zambie) ont affirmé que le droit international coutumier fournit un cadre pour traiter à la fois la responsabilité collective et individuelle. Allant dans ce sens, Nauru et le Népal ont suggéré que la nature composite de la responsabilité des États en matière climatique signifie que les États développés ont un devoir collectif de compenser les dommages causés par leurs émissions historiques.
La Russie et le Japon se sont opposés à ce point de vue, soutenant qu’il ne fallait accorder qu’une considération limitée — voire aucune — aux émissions historiques dans la détermination de la responsabilité étatique. L’Australie a quant à elle soutenu que le droit de la responsabilité des États ne reconnaît pas de responsabilité collective pour les dommages climatiques.
- La réparation des dommages climatiques
Dix États ont avancé que la réparation des dommages climatiques peut notamment être assurée en contribuant aux fonds de lutte contre le changement climatique, en offrant des ressources financières pour soutenir les efforts d’adaptation, d’atténuation et de relocalisation, en soutenant la recherche scientifique régionale, en garantissant le maintien du statut d’État pour les États touchés, en procédant à des transferts technologiques et en utilisant des mécanismes de réparation innovants tels que l’allègement et l’annulation de la dette, ainsi que les échanges dette-climat.
L’Égypte, l’Équateur, la Jamaïque et Sainte-Lucie ont quant à eux soutenu que le caractère discrétionnaire des mécanismes de pertes et dommages (Loss and Damage) dans le cadre de la CCNUCC ne peut se substituer à une réparation intégrale, y compris à une indemnisation, en vertu du droit international. Cette position fait échos à celle de la CIADH qui a, d’une part, affirmé que la responsabilité internationale engendrée par la violation du droit à un climat sain entraîne l’obligation de réparer intégralement le dommage causé [13], et, d’autre part, a averti que, compte tenu de l’ampleur des impacts prévus, le Fonds Loss and Damage mis en place dans le contexte de la COP27 nécessiterait “des ressources extraordinairement élevées pour remplir sa fonction” [14].
Enfin, les Fidji et la Micronésie se sont déclarées favorables à une différenciation des réparations entre les réparations dues aux États, en particulier aux PEID, les réparations dues aux peuples, y compris les peuples autochtones, et les réparations dues aux individus, y compris les détenteurs de droits des générations actuelles et futures.
- La cessation et la non-répétition des manquements
Trois États ont élaboré sur les obligations de cessation et de non-répétition s’inscrivant dans le cadre du droit de la responsabilité des États. Les Fidji ont estimé que la cessation exige une réduction immédiate des émissions de GES ainsi que le démantèlement des structures systémiques alimentant de telles émissions, tandis que le Ghana a soutenu que les États doivent cesser et s’abstenir d’adopter des lois, politiques et pratiques qui soutiennent les émissions de GES, en particulier la production d’énergies fossiles. Afin de garantir la non-répétition, le Vanuatu a affirmé que les États doivent engager des réformes politiques, réglementaires et législatives et empêcher les acteurs non étatiques relevant de leur juridiction, y compris les entreprises, de causer de nouveaux dommages climatiques.
La CIADH a rappelé à ce titre qu’il est “du devoir de l’État de surveiller et de contrôler, au minimum, la prospection, l’extraction, le transport et le traitement des combustibles fossiles, la fabrication de ciment, les activités agro-industrielles” [15].
Notes et références :
[1] CIADH, Urgence climatique et droits humains, avis consultatif OC-23/17, 3 juillet 2025, § 290 et 291 et suiv. sur le caractère jus cogens de l’obligation de ne pas causer des dommages irréversibles au climat et à l’environnement.
[2] CIADH, avis consultatif OC-23/17, 3 juillet 2025, § 300 et suiv. La Cour affiche la volonté de “doter l’ordre juridique interaméricain d’un fondement propre, qui permette de délimiter clairement les obligations spécifiques des États face à la crise climatique et d’exiger leur respect de manière autonome par rapport aux autres devoirs liés à la protection de l’environnement”.
[3] CIADH, avis consultatif OC-23/17, 3 juillet 2025, § 305.
[4] CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Avis consultatif du 8 juillet 1996, § 29.
[5] TIDM, Changement climatique et droit international, Avis consultatif du 21 mai 2024, § 166.
[6] CEDH, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20, 9 avril 2024, § 410-420.
[7] CIADH, avis consultatif OC-23/17, 3 juillet 2025, § 311 : “bien que le droit international des droits humains reconnaisse à toute personne des droits inaliénables, son fondement éthique et normatif transcende les habitants de la planète dans le présent et s’étend également à l’humanité en tant que communauté morale et juridique qui perdure dans le temps”.
[8] CIADH, avis consultatif OC-23/17, 3 juillet 2025, § 276.
[9] CIADH, avis consultatif OC-23/17, 3 juillet 2025, § 310.
[10] CIADH, avis consultatif OC-23/17, 3 juillet 2025, § 345.
[11] CIADH, avis consultatif OC-23/17, 3 juillet 2025, § 346 ; Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, « Information Note on Climate Change and the Guiding Principles on Business and Human Rights, 2023 », p. 5.
[12] CIADH, avis consultatif OC-23/17, 3 juillet 2025, § 553.
[13] CIADH, avis consultatif OC-23/17, 3 juillet 2025, § 303.
[14] CIADH, avis consultatif OC-23/17, 3 juillet 2025, § 201.
[15] CIADH, avis consultatif OC-23/17, 3 juillet 2025, § 353.








