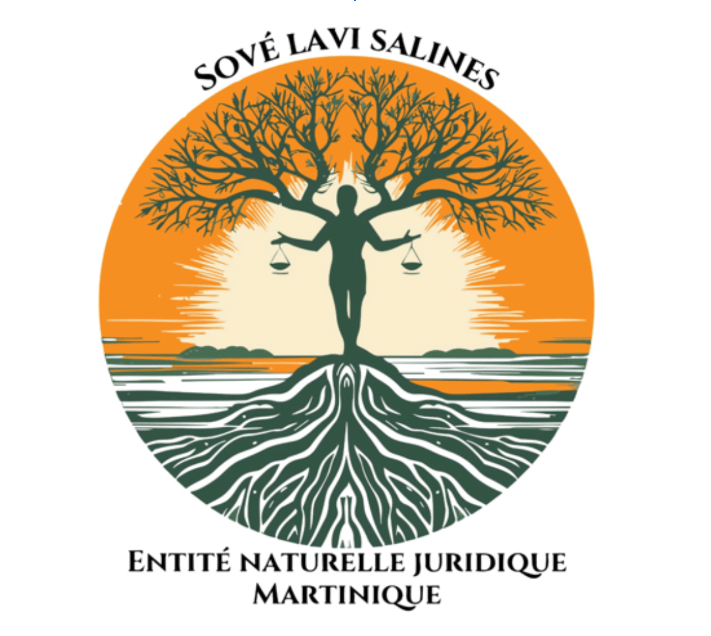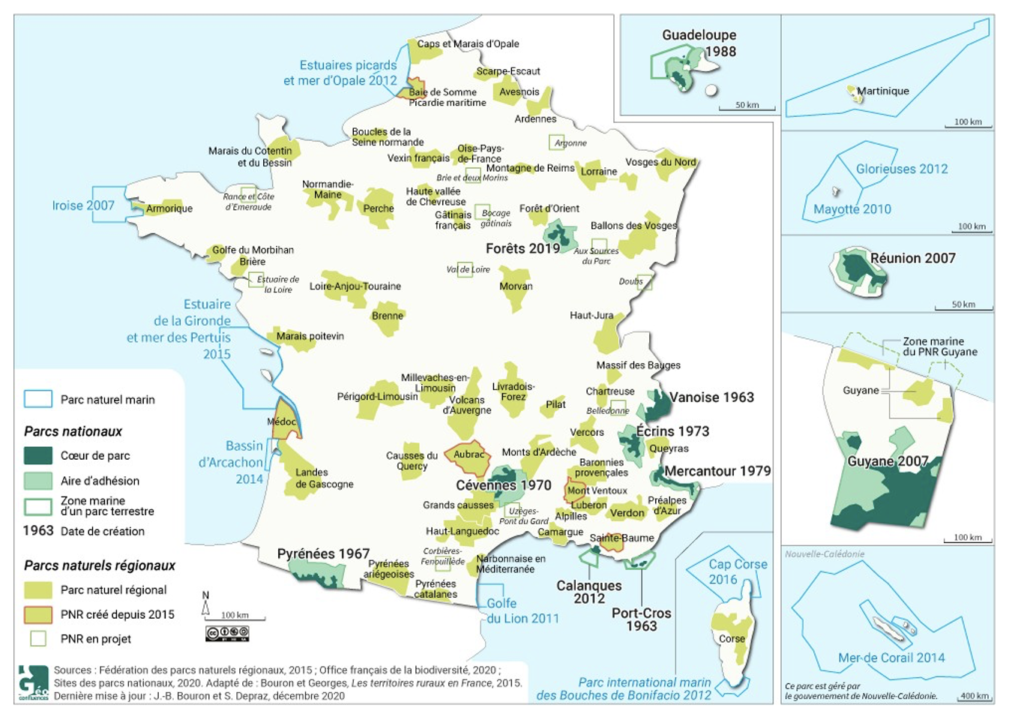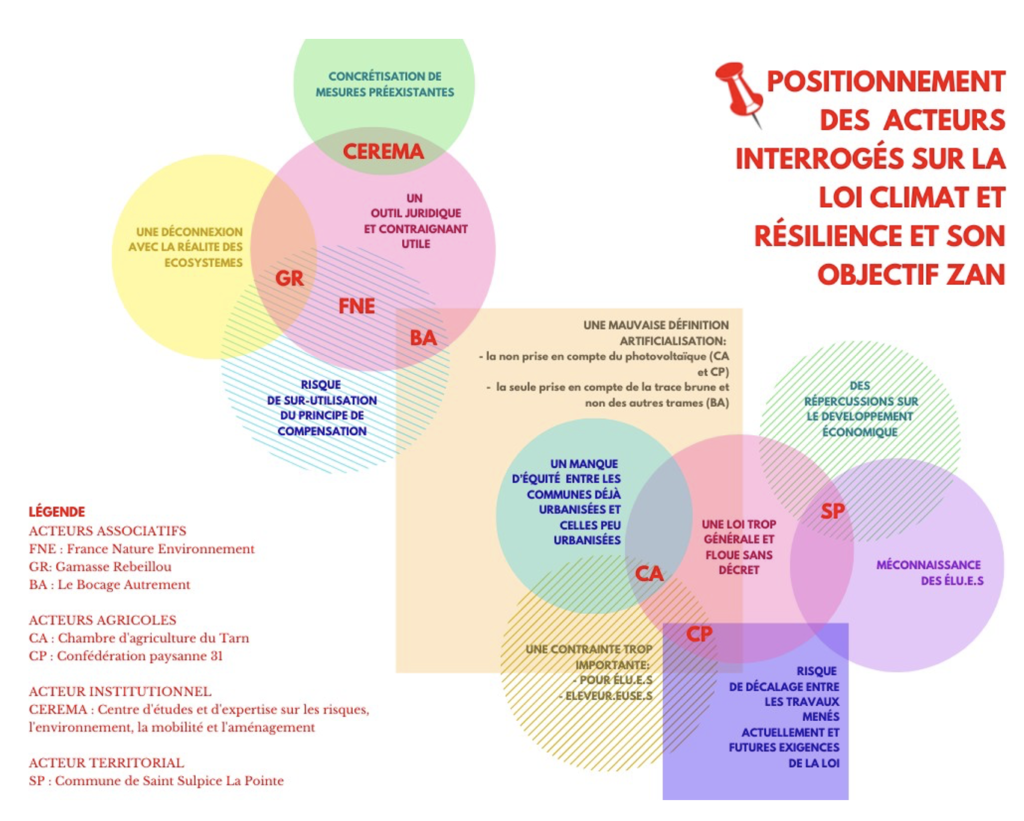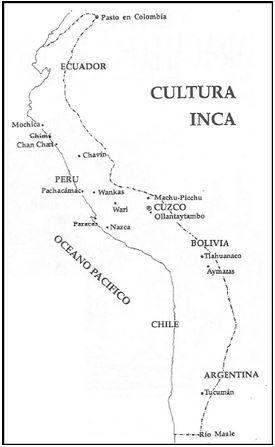Article écrit par Julia Thibord, avocate au Barreau de Paris et membre de Notre Affaire à Tous
« Le temps est dépassé où la recherche d’un équilibre entre la croissance économique et la défense écologique posait problème : les populations ont pris conscience qu’il est indispensable, pour la survie des espèces, de ménager l’espace et les matières premières essentielles c’est-à-dire le sol, l’eau, l’air. (…) La législation existante doit être complétée afin que le non-respect des règles protectrices de l’environnement soit considéré comme un comportement social dangereux. Du point de vue pénal, nous avons une mosaïque de textes hétéroclites dont la mise en œuvre est relativement complexe. Il importe donc de dégager un texte de portée générale – à insérer dans le Code pénal – qui protège l’équilibre du milieu naturel, la santé de l’homme, des animaux et des plantes contre les actes directs et indirects de pollution, quels qu’en soient les motifs et les moyens. De même que le droit pénal, en punissant le meurtre ou le vol, affirme le droit à la vie ou à la propriété, de même il doit proclamer la valeur du milieu naturel, en punissant toutes les pollutions » (1).
Ces propos, d’une brûlante actualité, ont été prononcés au Sénat il y a plus de 40 ans. Le constat, aujourd’hui, reste le même : le droit pénal de l’environnement, morcelé, inappliqué, n’est pas dissuasif. Plus que jamais, il importe de repenser ce droit, alors qu’il est crucial et urgent de préserver notre environnement et la sûreté de la planète. Dans cette perspective, la reconnaissance du crime d’écocide, au plan national comme au plan international, permettrait de « s’engager sur une voie responsable pour protéger les grands écosystèmes de la planète » (2) et d’envoyer un signal fort à tous ceux qui, le plus souvent pour des raisons économiques, obèrent notre avenir et celui de de la Terre dans une quasi-impunité.
Au niveau international, la réflexion sur l’écocide est née lors de la guerre du Vietnam, en lien avec l’utilisation délibérée et massive par l’armée américaine de défoliants extrêmement toxiques, dont le tristement célèbre « agent orange », en vue de détruire la végétation et neutraliser les groupes armés du Vietcong (3). La criminalisation des atteintes graves à l’environnement fut un temps envisagée puis finalement écartée, pour des raisons politiques, lors de la création de la Cour pénale internationale (4). Seules les atteintes à l’environnement commises en tant que crime de guerre (et seulement lorsqu’il s’agit d’un conflit armé international) y figurent (5).
Lors de la dix-huitième session de l’Assemblée des États parties au Statut de Rome, en 2019, les Maldives et le Vanuatu – dont la survie est directement menacée par le réchauffement climatique – ont plaidé pour l’insertion du crime d’écocide dans le statut de la Cour, estimant que la justice pénale internationale a un rôle à jouer pour prévenir la catastrophe environnementale qui nous attend (6). Cette demande a été rejointe par la Belgique en décembre 2020 (7). Cette année, le Parlement européen a voté divers textes appelant à la reconnaissance du crime d’écocide dans le Statut de la Cour pénale internationale (8).
Enfin, le 22 juin dernier, un panel international d’experts institué par la Fondation Stop Ecocide, composé de douze juristes de différents pays, reconnus pour leur expertise en droit pénal, en droit de l’environnement et/ou en droit international, a rendu publique une proposition d’amendement au Statut de la Cour pénale internationale pour y intégrer le crime d’écocide (9). Cette proposition, qui fait suite à six mois de travaux, montre qu’une définition de l’écocide à la fois réaliste, ambitieuse et juridiquement solide est possible.
Au niveau national, une résolution adoptée par l’Union Interparlementaire au mois de mai invite les parlements nationaux à « renforcer le droit pénal pour prévenir et punir les dommages étendus, durables et graves causés à l’environnement » et à « examiner la possibilité de reconnaître le crime d’écocide afin de prévenir les menaces et les conflits résultant des catastrophes liées au climat et à leurs conséquences » (10).
En France, deux propositions de loi portant reconnaissance du crime d’écocide ont été successivement examinées et rejetées par le Sénat puis l’Assemblée nationale en 2019 (11). Parmi les 149 propositions figurant dans son rapport, la convention citoyenne pour le climat appelait à l’adoption d’une loi qui pénalise le crime d’écocide, afin de « sauvegarder les écosystèmes » (12).
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (ci-après la « loi climat »), censée traduire dans l’ordre juridique les propositions de la convention citoyenne pour le climat, aurait pu être l’occasion d’une réflexion ambitieuse sur la notion d’écocide et d’un premier pas, au sein de l’Union européenne, pour la reconnaissance de ce crime.
Malheureusement, le nouvel article L. 231-3 du code de l’environnement consacrant un délit d’écocide n’est pas, de loin, à la hauteur des attentes.
En faisant de l’écocide un simple délit, la France a manqué l’occasion de montrer la voie en Europe et à l’international et contribue à une banalisation dangereuse de l’écocide (1). De plus, le délit d’écocide est défini par renvoi à d’autres infractions, ce qui nuit à sa clarté et à sa lisibilité, ajoutant à la complexité du droit pénal de l’environnement (2). Enfin, le législateur a manqué d’ambition en retenant une définition restrictive et inadaptée de l’écocide, qui devrait limiter fortement son application (3).
1. L’occasion manquée de l’exemplarité : le refus de faire de l’écocide un crime
Alors que la convention citoyenne demandait la création d’un crime d’écocide, la loi climat n’institue qu’un simple délit. Aucun des arguments invoqués, à savoir privilégier une telle reconnaissance au niveau international (13), ou le respect du principe de proportionnalité (14), ne justifie ce refus.
1.1. L’absence de reconnaissance du crime d’écocide en droit international n’exclut pas et au contraire justifie sa reconnaissance en droit national
Il est vrai que, dans la littérature juridique, l’écocide renvoie plutôt à un crime reconnu à l’échelle internationale (15). Comme le souligne la juriste Valérie Cabanes (16), dès lors qu’il s’agit de protéger des communs naturels dont nous dépendons tous, comme l’Amazonie, les océans, le climat, le droit international pénal paraît la meilleure manière de reconnaître le crime d’écocide – voire même la seule efficace. Les difficultés rencontrées, malgré des décennies de procès, pour engager la responsabilité du géant pétrolier Chevron Texaco dans la destruction de l’environnement et l’empoisonnement consécutif de dizaines de milliers de personnes en Equateur (17), ou la fin de non-recevoir opposée à la plainte déposée contre 26 laboratoires pharmaceutiques américains pour leur rôle dans l’utilisation de l’agent orange pendant la guerre du Vietnam (18) l’illustrent : sans règles à l’échelle internationale, de tels crimes ne pourront pas être jugés comme il se doit.
Pour autant, la reconnaissance de l’écocide en droit international n’est pas exclusive de sa reconnaissance dans le droit national ; au contraire, l’un et l’autre sont complémentaires. Rien n’empêche le droit interne – et la France en particulier – de prendre les devants.
Tout d’abord, si l’écocide en tant que crime de droit international doit être réservé aux atteintes environnementales les plus graves, portées aux communs naturels ou mettant en péril les conditions d’existence de populations entières, la reconnaissance du crime d’écocide au niveau national permettrait de poursuivre les atteintes particulièrement graves à l’environnement mais qui n’ont pas forcément de portée trans- ou internationale. Cela pourrait d’ailleurs justifier une définition de l’écocide potentiellement plus large qu’au niveau international.
Une telle reconnaissance dans notre droit pénal est d’autant plus justifiée que la France n’est pas à l’abri d’un écocide. Marées noires, exposition à l’amiante, pollution de l’air, des sols, de l’eau, accidents industriels, déchets radioactifs, réchauffement climatique : les exemples et risques d’atteintes graves portées à l’environnement ou à la santé humaine, en conséquence du non-respect de la réglementation environnementale, de négligences et/ou de prises de risques inconsidérées ne manquent pas. Sans compter les dommages causés par des sociétés françaises et leurs filiales à l’étranger. La juste reconnaissance de l’écocide en droit interne permettrait de punir à la hauteur de leur gravité les atteintes les plus graves susceptibles d’être portées, en connaissance de cause, à l’environnement sur le territoire français et/ou par des dirigeants et entreprises français (et de dissuader la commission de telles atteintes).
Ensuite, le droit international se crée grâce aux précédents du droit interne. Certains États, d’ailleurs, comme le Vietnam ou des pays de l’ancien bloc soviétique ont déjà incriminé l’écocide dans leur droit pénal (19). Aucune initiative à l’échelon européen ou international n’ayant, à ce jour, abouti, ce sont précisément « aux États les plus diligents de prendre le relais à l’échelon national » (20) et de montrer l’exemple. « La multiplication des incriminations de l’écocide au niveau national, en particulier parmi les États membres de l’Union européenne, constituerait en effet la voie la plus rapide pour la construction d’un consensus ou, a minima, d’une tendance notable qui, à terme, s’imposera d’autant plus facilement en droit international et européen » (21).
En reconnaissant le crime d’écocide, la France aurait pu participer de ce mouvement et se positionner en pionnière sur le sujet, entraînant dans son sillage le reste de l’Europe et de la communauté internationale (22).
1.2. L’écocide, un crime disproportionné ?
Le crime d’écocide souhaité par la Convention citoyenne n’a pas été retenu pour des raisons notamment de « proportionnalité [risquant] de rendre le processus inconstitutionnel », a justifié Barbara Pompili (23).
On peine à comprendre une telle justification. L’écocide est, de par son étymologie – la destruction (caedere, tuer) de notre maison (oikos), nos écosystèmes, notre terre –, un crime d’une gravité extrême. D’une certaine manière, il est même le « crime premier » (24), le plus grave d’entre tous, puisqu’il met en péril les conditions de vie sur terre.
La catastrophe de Bhopal en 1984, qui a exposé des centaines de milliers de personnes à des produits chimiques toxiques à la suite de l’explosion de l’usine de fabrication de pesticides d’Union Carbide (aujourd’hui Dow Chemicals) a provoqué, officiellement, près de 7 500 décès (20 000 selon les associations de victimes) (25). Dans l’affaire du Probo Koala, les déchets hautement toxiques déchargés en toute illégalité dans le port d’Abidjan ont provoqué la mort de 17 personnes (plus selon les associations) et l’intoxication de dizaines de milliers de personnes, sans compter les impacts sur l’environnement (26). En Équateur, entre 1965 et 1992, les activités pétrolières de Chevron-Texaco ont dévasté les territoires indigènes et empoisonné plus de 30 000 de ses habitants, qui vivent désormais dans la zone au taux de cancer le plus élevé d’Amérique latine (27). L’explosion de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon, en 2010, a eu pour conséquence la mort de onze personnes et une marée noire exceptionnelle (780 millions de litres de pétrole), entraînant un désastre écologique sans précédent (28). Quant à Monsanto, « l’écocide persistant, réitéré » (29), l’avis consultatif rendu par le tribunal international citoyen Monsanto en 2016 a conclu que l’entreprise américaine avait causé, via notamment la production, l’utilisation et la commercialisation à l’échelle mondiale de produits hautement toxiques comme le Roundup, le PCB ou le 2,4,5 T (l’un des composants de l’agent orange), des « dommages importants et durables à la biodiversité et aux écosystèmes » et affecté la vie et la santé de populations humaines entières (30). En mars 2019, deux cyclones très rapprochés ont ravagé la côte de l’océan Indien d’Afrique australe, provoquant plus de 600 décès et des centaines de milliers de sans-abri et faisant de Beira, la deuxième ville du Mozambique, la « première ville au monde détruite par les changements climatiques » (31). Le dernier rapport du GIEC, rendu en août 2021, montre que les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines ont élevé les températures d’environ 1,1 °C depuis la période 1850-1900 (32). Or les quelques 25 multinationales des énergies fossiles qui ont, en toute connaissance de cause, poursuivi et développé leurs activités charbonnières, gazières et pétrolières, seraient à l’origine de 51 % des émissions de gaz à effet de serre entre 1988 et 2015 (33).
Plus près de nous, en France, la pollution de l’air serait responsable de près de 100 000 décès par an (34). Lors du naufrage de l’Erika, 20 000 tonnes de fioul lourd se sont retrouvées dans l’océan, souillant les côtes françaises sur près de 400 km, tuant entre 150 000 et 300 000 oiseaux et rejetant près de 250 000 tonnes de déchets – sans compter un préjudice économique estimé à un milliard d’euros (35). La société Total, affréteur du navire n’a été condamnée, au pénal, qu’à une amende de 375 000 euros, dérisoire au regard à la fois de l’étendue du désastre et du chiffre d’affaires du groupe. Aux Antilles, le chlordécone, cet insecticide utilisé pendant plus de vingt ans dans les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique, a, selon certains experts, empoisonné les sols, les rivières et la mer pour des siècles, sans compter les conséquences sanitaires sur la population dont les scientifiques commencent peu à peu à mesurer la gravité, plus de 90 % des adultes en Martinique et en Guadeloupe étant contaminés (36). Malgré cela, la plainte déposée en 2006 pour empoisonnement et mise en danger de la vie d’autrui devrait déboucher sur un non-lieu pour des questions de prescription (37). En matière de réchauffement climatique, le tribunal administratif de Paris a récemment jugé, dans l’Affaire du siècle, qu’ « en France, l’augmentation de la température moyenne, qui s’élève pour la décennie 2000-2009, à 1,14°C par rapport à la période 1960-1990, provoque notamment l’accélération de la perte de masse des glaciers, en particulier depuis 2003, l’aggravation de l’érosion côtière, qui affecte un quart des côtes françaises, et des risques de submersion, fait peser de graves menaces sur la biodiversité des glaciers et du littoral, entraîne l’augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, tels que les canicules, les sécheresses, les incendies de forêts, les précipitations extrêmes, les inondations et les ouragans, risques auxquels sont exposés de manière forte 62 % de la population française, et contribue à l’augmentation de la pollution à l’ozone et à l’expansion des insectes vecteurs d’agents infectieux tels que ceux de la dengue ou du chikungunya » (38).
Si disproportion il y a, elle résulte de l’impunité qui règne en la matière et, quand il y a condamnation, de la faiblesse des peines prononcées.
La qualification de crime, au-delà de sa dimension symbolique et des peines qui s’y attachent, a aussi des conséquences procédurales non-négligeables, en termes de pouvoirs d’enquête, de prescription (vingt ans minimum pour les crimes vs six ans pour les délits), et de règles de compétence, de poursuites, d’instruction et de jugement, adaptées à la gravité de l’infraction.
La criminalisation de l’écocide apparaît, dès lors, nécessaire pour assurer le respect de droits fondamentaux comme le droit à la vie ou le droit à un environnement sain. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle ainsi qu’incombe à l’État « le devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations » (39).
A tous ces égards, la reconnaissance d’un simple « délit d’écocide » est un contresens, une expression « théoriquement contradictoire et pratiquement inappropriée » (40). En réalité, comme l’a relevé à juste titre la commission des lois du Sénat, « l’écocide sembl[e] avoir été mentionné uniquement à des fins politiques, pour donner l’impression que le projet de loi répondait à la demande formulée par la Convention citoyenne à ce sujet » (41).
Une nécessaire hiérarchie
Il ne fait pas de doute, en revanche, et en vertu notamment du principe de proportionnalité, que le crime d’écocide doit être réservé aux infractions les plus graves. Mais c’est précisément la définition des éléments de l’écocide, et notamment la délimitation du seuil de gravité permettant de distinguer un délit de pollution d’un écocide, qui doit assurer cela.
Une hiérarchie est nécessaire, une échelle de gravité entre les différentes infractions environnementales. La juriste Coralie Courtaigne-Deslandes identifiait en 2015 trois échelons dans la commission des atteintes à l’environnement : la « délinquance occasionnelle et opportuniste » (délits de chasse, abandons de déchets ou petites pollutions agricoles) ; la « stratégie d’entreprise », « planifiée et récurrente », s’inscrivant dans le cadre d’activités autorisées ; et la criminalité organisée, souvent transfrontalière, liée au trafic de déchets ou d’espèces protégées (42). A l’évidence, seuls les deux derniers échelons devraient être (potentiellement) concernés par l’écocide. Le but de l’écocide est de « viser les personnes ayant du pouvoir, une influence sur le cours des événements telles que les multinationales qui agissent en connaissance des conséquences de leurs activités, décisions et choix d’investissements » (43). Le rapport remis à la garde des sceaux le 11 février 2015 proposait, quant à lui, une classification des infractions environnementales, en distinguant les infractions administratives, les « écocrimes » et l’écocide (44), en fonction notamment de la gravité de l’atteinte, des valeurs protégées et du type de faute.
Les nouvelles incriminations ne permettent pas une telle rationalisation. Au contraire, en refusant de faire de l’écocide un crime, la loi climat crée une confusion dangereuse, qui tend à mettre l’écocide au même rang que la délinquance environnementale et à banaliser celui-ci. Confusion renforcée par la présentation qui en a été faite par le gouvernement dans la presse, insistant sur le « banditisme » environnemental, affirmant que le délit d’écocide viserait tout le monde y compris les particuliers, et passant complètement sous silence, en revanche, la question du dérèglement climatique (45).
***
En refusant de reconnaître l’écocide, le législateur français a manqué l’occasion de donner l’exemple et d’ouvrir la voie vers une reconnaissance universelle de ce crime. Relégué au rang de simple délit, banalisé, l’écocide est, de surcroît, fragilisé par une définition complexe, inadaptée et indûment restrictive.
2. L’occasion manquée de la clarté : une incrimination de l’écocide par renvoi à d’autres textes, qui nuit à sa lisibilité
Les propositions de loi de 2019 ainsi que la proposition de la convention citoyenne pour le climat relatives au crime d’écocide, ont été écartées au motif principalement de l’imprécision des définitions proposées et du risque de contrariété au principe de légalité des crimes et des délits (46). Ce principe, qui a valeur législative, conventionnelle et constitutionnelle (47), impose au législateur de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de « définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire » (48).
A cet égard, la définition du délit d’écocide, technique, complexe, renvoyant successivement à de nombreux textes, paraît contestable. Pour bien comprendre le délit d’écocide, il convient de revenir à la fois sur le droit existant et sur les nouveaux délits de pollution prévus par la loi climat (2.1), le délit d’écocide n’étant qu’une forme aggravée de ces derniers, définie par renvois successifs à différents textes (2.2).
2.1. Le contexte : les infractions existantes et les nouveaux délits de pollution créés par la loi climat
Le droit existant
Le droit pénal de l’environnement – entendu comme l’ensemble des infractions relatives à la protection de la nature, des ressources naturelles, des sites et paysages ainsi que celles relatives à la lutte contre les pollutions et les nuisances –, se compose de quelques 2000 infractions en vigueur, disséminées au travers de dispositions éparses du code pénal, du code de l’environnement, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier et du code minier (49). Cet éclatement du droit pénal de l’environnement et le recours fréquent à l’incrimination par renvoi participent de l’« inefficacité chronique » (50) du droit pénal de l’environnement, régulièrement décriée (51).
Parmi les infractions existantes, on trouve notamment :
- un délit général de pollution des eaux, puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (52) ;
- des délits de pollution maritime (53), dont un certain nombre sont définis par renvoi à des conventions internationales. Parmi les plus graves, on trouve le rejet volontaire d’hydrocarbures par les pétroliers (dix ans d’emprisonnement et 15 millions d’euros) (54) et le rejet de substances chimiques en colis (sept ans d’emprisonnement et 1 million d’euros) (55) ;
- des dispositions sanctionnant l’exploitation, sans l’autorisation requise ou en violation des prescriptions applicables, d’une activité réglementée (ex : installations classées pour la protection de l’environnement, activités à l’intérieur de réserves naturelles, dérogations en matière d’atteintes aux espèces protégées). Ces infractions sont punies d’un à deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € à 100 000 € d’amende en fonction des activités et faits en cause (56). En cas d’atteinte grave à la santé ou la sécurité ou de dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les peines encourues peuvent aller jusqu’à trois ans de prison et 150 000 € d’amende et, pour certaines activités, jusqu’à cinq ans et 300 000 € d’amende (57) ;
- le non-respect, après cessation d’activité d’une installation, des obligations de remise en état, puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (58) ;
- Le non-respect de la réglementation applicable aux déchets, puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (59) ;
- en matière d’émissions atmosphériques, le non-respect des prescriptions du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ainsi que le non-respect d’une mise en demeure en matière d’émissions polluantes, sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (60).
On mentionnera, enfin, puisque c’est l’infraction environnementale la plus grave du droit français – et la seule élevée au rang de crime –, le terrorisme écologique, puni de vingt ans de réclusion et de 350 000 € d’amende (61).
Les nouveaux délits de la loi climat en matière de pollution
La loi climat créé deux nouveaux délits de pollution :
- un délit de pollution de l’air et de l’eau, défini comme « le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune […] ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau » (nouvel article L. 231-1 du code de l’environnement). L’alinéa 2 précise que cette définition ne s’applique, s’agissant des émissions ou rejets autorisés, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission ou de non-respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente. Ce nouveau délit est puni de 5 ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende.
- un délit de pollution liée au non-respect de la réglementation sur les déchets, défini comme « le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu’ils provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau » (nouvel article L. 231-2 du code de l’environnement). Ce nouveau délit est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.
L’écocide
L’écocide est prévu par le nouvel article L. 231-3 du code de l’environnement. En vertu de ces dispositions, constituent un écocide :
- l’infraction prévue à l’article L. 231-1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle ;
- les infractions prévues à l’article L. 231-2, « commises de façon intentionnelle, lorsqu’elles entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau ».
L’écocide est puni de dix ans d’emprisonnement et de 4,5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
2.2. Une infraction définie par renvois successifs
Sous le terme d’écocide, la loi climat institue non pas un délit autonome mais plutôt une forme aggravée des délits de pollution prévus par les nouveaux articles L. 231-1 et L. 231-2 du code de l’environnement. L’écocide est défini par renvoi à ces délits, qui sont eux-mêmes définis par renvoi à d’autres dispositions.
Pour ce qui est du délit de l’article L.231-1, celui-ci est caractérisé par (notamment) la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Cela suppose (i) d’identifier le texte légal ou réglementaire source de l’obligation particulière de prudence ou de sécurité et (ii) d’établir que cette obligation présente un caractère particulier et non général, ce qui dépend du contenu précis du texte qui l’édicte (62).
Par ailleurs, l’article L.231-1 exclut expressément les pollutions « autorisées », c’est à dire les émissions ou rejets réalisés dans le respect des prescriptions et seuils fixés par l’autorité administrative compétente (63). La caractérisation de l’infraction dépendra donc des seuils et normes fixés par l’autorité administrative, ce qui revient à conférer aux prescriptions préfectorales un rôle central dans la caractérisation de l’élément légal de l’infraction (64).
Enfin, l’article L.231-1 exclut de son application les « dommages mentionnés aux articles L. 218-73 et L. 432-2 », réprimant respectivement le rejet dans les eaux salées, de substances ou organismes nuisibles pour la faune ou la flore marine (puni de 22 500 € d’amende), et les pollutions qui affectent les poissons en eaux douces (deux ans de prison et 18 000 € d’amende ). Cette exclusion, directement inspirée de l’article L.216-6 réprimant la pollution des eaux, crée une confusion inopportune. En effet, si les dommages visés remplissent les conditions propres à l’article L.231-1 (ou au délit d’écocide), en termes de gravité notamment, rien ne justifie de les exclure des nouvelles incriminations (65).
Quant au délit prévu à l’article L.231-2, celui-ci nécessite une méconnaissance des dispositions applicables en matière de déchets et plus précisément :
- un manquement aux dispositions relatives à l’abandon ou au dépôt de déchets prévues « au chapitre I du titre IV du livre V du code de l’environnement » soit plus de 130 articles (sans compter le renvoi à des dispositions réglementaires), aux contenus divers, en lien ou pas avec l’abandon ou le dépôt de déchets, et à la rédaction plus ou moins précise ;
- des faits de gestion de déchets (tels que définis à l’article L.541-1-1 du code de l’environnement) en méconnaissance des « prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22 » du code de l’environnement.
Le renvoi à ces multiples dispositions du code de l’environnement brouille d’autant plus la lisibilité que celles-ci peuvent être modifiées, supprimées ou complétées au fil du temps et des évolutions législatives et réglementaires.
Outre une « dépossession par le législateur de sa propre compétence au moyen d’un transfert plus ou moins maîtrisé du pouvoir d’écriture pénale à d’autres autorités » (66), l’incrimination de l’écocide ressort fragilisée de ces renvois successifs. Il faut consulter plusieurs textes pour comprendre le contenu du délit, et la rédaction même de ces différents textes ne permet pas toujours de satisfaire à l’exigence de clarté et de précision attendue de la norme pénale. Tout cela nuit à la lisibilité et à l’accessibilité du délit d’écocide.
***
« Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires » (Montesquieu). La reconnaissance de l’écocide aurait pu être l’occasion d’une simplification et d’une clarification du droit pénal de l’environnement, à travers notamment la création tant attendue d’infractions claires, génériques et autonomes. Au lieu de cela, la loi climat superpose aux multiples infractions existantes de nouveaux délits, eux-mêmes définis par renvois successifs à d’autres textes de rang variable dans la hiérarchie des normes.
A cela s’ajoute une définition restrictive, inadaptée et lacunaire de l’écocide, qui ne rend pas compte de la spécificité de celui-ci et qui rend son application peu probable.
3. L’occasion manquée de l’effectivité : une définition inadaptée et restrictive de l’écocide, qui limite fortement son application
« L’objectif du crime d’écocide doit être de répondre à la crise écologique et climatique en cours en permettant de poser un cadre normatif de ce qui est tolérable pour préserver un écosystème terrestre habitable pour le plus grand nombre » (67). Force est de constater que la définition retenue par le législateur ne répond pas à ces enjeux.
3.1. Une définition inadaptée et restrictive
Une définition parcellaire et lacunaire
Tout d’abord, la définition par renvoi à d’autres infractions (elles-mêmes inspirées d’infractions anciennes), en faisant de l’écocide une forme aggravée d’autres délits « communs » de pollution, contribue à sa banalisation.
Ensuite, cette définition reste parcellaire, segmentée, aussi bien quant à la réglementation dont il faut prouver la violation (obligation particulière de prudence ou de sécurité ou règle issue de certaines dispositions du code de l’environnement relatives aux déchets) que quant à la liste des éléments protégés (santé, flore, faune et alimentation en eau pour l’écocide au titre de l’article L.231-1 ; flore, faune et qualité de l’air, du sol ou de l’eau pour l’écocide au titre de l’article L.231-2).
De fait, toutes les atteintes graves et durables à l’environnement ne sont pas couvertes par le délit d’écocide. Sont notamment exclues les pollutions des sols autres que celles résultant d’une violation du droit des déchets. Cela est d’autant plus regrettable que, depuis la transposition de la directive cadre sur les déchets, les sols non excavés ne sont plus considérés comme des déchets (68).
Plus généralement, cette manière de procéder, et la terminologie utilisée, échouent à rendre compte de la spécificité et de la gravité de l’écocide. Il manque une « approche écosystémique » (69), similaire à celle qu’on retrouve dans la formulation du préjudice écologique de l’article 1247 du code civil. On peut déplorer, notamment, l’absence de référence aux écosystèmes ou au climat. Sur ce point, le législateur aurait gagné à s’inspirer de la définition adoptée par le groupe d’experts international qui réprime les atteintes à l’environnement entendu comme « la Terre, sa biosphère, sa cryosphère, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère [et] l’espace extra-atmosphérique ».
La condition de l’illicéité, critère indispensable ?
Le délit d’écocide est caractérisé par un manquement à la loi ou à la réglementation, donc une pollution illicite.
Ce critère, en soi, n’apparaît pas déraisonnable. La création d’une infraction autonome, protégeant l’environnement pour lui-même, sans référence au respect de la réglementation, pourrait faire « peser sur les acteurs économiques un risque pénal pour une activité qui était autorisée au moment des faits » (70). C’était d’ailleurs l’une des critiques adressées à la définition de l’écocide proposée par la convention citoyenne.
Pour autant, la condition de l’illicéité perd de son sens dès lors que sont en jeu les atteintes les plus graves à l’environnement, voire à la sûreté de la planète elle-même. Ce d’autant plus que les entreprises (et leurs dirigeants) dont les activités sont susceptibles de provoquer des pollutions graves sont le plus souvent bien entourées et bien conseillées ; elles savent les risques qu’elles prennent (quand elles ne cherchent pas délibérément à profiter des zones grises ou des failles de la réglementation applicable, ou du « dumping » environnemental). Elles font délibérément le choix de privilégier la recherche du profit sur la préservation de l’environnement et de la santé. C’est précisément ce mépris pour l’environnement et la vie humaine que l’écocide devrait pouvoir sanctionner. C’est pourquoi certains auteurs plaident pour « un abandon de l’exigence d’illicéité en cas d’atteinte à la santé humaine ou à la sûreté de la planète » (71).
Le groupe d’experts international a choisi de conserver ce critère de l’illicéité, mais en l’atténuant quelque peu puisque sont exigés des actes « illicites ou arbitraires », soit une définition sensiblement plus ouverte à cet égard. Le terme « arbitraire » est entendu comme « de manière imprudente et sans faire cas des dommages qui seraient manifestement excessifs par rapport aux avantages sociaux et économiques attendus ».
Au demeurant, la référence, plus générale, dans la définition proposée, à toute atteinte « illicite » permet de couvrir tout manquement à la législation ou à la réglementation, notamment environnementale. Ce qui n’est pas le cas de la définition française, qui exige spécifiquement la violation soit d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement soit de la réglementation déchets.
L’exigence d’atteintes graves à l’environnement susceptibles de durer au moins sept ans, un critère indûment restrictif
Pour caractériser l’écocide, les atteintes à l’environnement doivent être à la fois graves et durables. Cette double exigence n’apparaît pas, en soi, déraisonnable. On retrouve d’ailleurs les mêmes critères, sous des formulations plus ou moins similaires, dans la plupart des définitions proposées, au plan international ou national (72). La définition retenue par le groupe d’experts international, quant à elle, requiert des dommages « graves qui soient étendus ou durables » (soit un double critère un peu moins exigeant, puisque l’atteinte doit être grave et durable ou grave et étendue) (73).
Là où la loi française s’avère indûment restrictive, c’est qu’elle définit comme « durables » les effets nuisibles « susceptibles de durer au moins sept ans ».
Fixé à dix ans dans la version initiale du projet de loi, ce seuil a été abaissé à sept ans par le Sénat, prenant acte de « la complexité de démontrer, y compris au terme d’une expertise poussée, que la prise d’un risque peut potentiellement causer des atteintes susceptibles de durer sur une telle période » (74).
Même abaissée à sept ans, il sera difficile de caractériser une atteinte grave et durable à l’environnement sur une telle durée. L’évolution des connaissances scientifiques sur le fonctionnement des écosystèmes, le caractère plus ou moins sensible du milieu récepteur, les différences de réaction des diverses composantes d’un même milieu, la conjonction des risques pour l’environnement et pour la santé rendent une telle démonstration – et son appréciation par le juge – particulièrement complexe (75). Cette exigence, disproportionnée, fait peser sur les autorités de poursuite (et sur les associations de protection de l’environnement) une preuve qui pourrait s’avérer impossible (76). Et risque de rendre inapplicable le délit d’écocide.
A titre de comparaison, la proposition d’amendement du groupe d’experts international définit comme « durables » les dommages « irréversibles » ou qui « ne peuvent être corrigés par régénération naturelle dans un délai raisonnable ». La définition proposée au niveau international paraît donc, à cet égard également, sensiblement moins rigide que la définition française, laissant le soin aux juges d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, ce qui constitue une atteinte durable.
3.2. Des incertitudes quant à l’intention exigée
L’élément moral en droit pénal de l’environnement
« [L]e droit pénal de l’environnement est le siège de la réflexion juridique la plus poussée et de la jurisprudence la plus compliquée qui soient sur l’élément moral de l’infraction » (77). Depuis la réforme du code pénal de 1994, les crimes et délits sont, par principe, intentionnels. Aux termes de l’article 121-3 du code pénal, il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, « en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ».
En droit pénal de l’environnement, toutefois, la distinction entre délit intentionnel et délit non-intentionnel n’est pas toujours évidente en pratique. Certains délits environnementaux, comme celui de pollution de l’eau (article L.216-6 du code de l’environnement) ou celui de rejets polluants en mer (article L. 218-19) sont des infractions d’imprudence. Pour le reste, la plupart sont des délits intentionnels. Or la chambre criminelle de la Cour de cassation recourt fréquemment, pour déterminer l’intention, à la formule selon laquelle « la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal » (78). Avec la conséquence qu’il peut s’avérer plus aisé de caractériser l’intention, celle-ci étant déduite du constat de la violation de la règle en cause et de la qualité de professionnel du prévenu, que l’imprudence ou la négligence, qui oblige à décrire le comportement du prévenu, à le comparer à ce qu’aurait fait un homme normalement prudent et avisé et à démontrer que cette imprudence ou négligence a causé la situation délictuelle (79).
L’écocide, un délit intentionnel
Le caractère intentionnel du délit d’écocide est expressément précisé dans le texte de l’article L. 231-3 (à deux reprises, y compris pour l’écocide défini en référence à l’article L. 231-2, qui est pourtant déjà une infraction intentionnelle).
En soi, l’exigence d’une intention n’apparaît pas excessive et semble faire consensus (80). Tout dépendra de l’intention (et de sa preuve) qui sera exigée. L’élément matériel de l’écocide étant défini à la fois par des faits (des rejets ou émissions en méconnaissance des prescriptions applicables) et par un résultat (une atteinte grave et durable à l’environnement), l’intention devrait porter à la fois sur les actes et sur le résultat. Cela ne signifie pas pour autant une intention de nuire, mais plutôt la commission desdits faits en connaissance de cause, c’est à dire en ayant conscience de violer la réglementation mais aussi du risque d’atteinte grave et durable à l’environnement (81).
L’intention ainsi entendue rejoint la définition proposée par la convention citoyenne pour le climat (« en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées ») (82). Dans le même sens, l’amendement au statut de la CPI proposé par le groupe d’experts international précise que les actes d’écocide doivent être commis « en connaissance de la réelle probabilité que ces actes causent à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables ».
Néanmoins, la définition restrictive du terme durable pourrait rejaillir sur l’intention exigée – s’il devait être prouvé plus spécifiquement que l’auteur des faits avait conscience que l’atteinte à l’environnement était susceptible de durer plus de sept ans.
Par ailleurs, le délit d’écocide étant défini, au titre du premier alinéa de l’article L. 231-3, en tant que forme aggravée du délit « non-intentionnel » de pollution de l’article L.231-1, l’articulation entre les deux délits n’est pas sans soulever certaines interrogations quant à l’intention exigée.
Intention vs violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité
La notion de « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » se situe à mi-chemin entre l’intention et l’imprudence. Elle requiert, une violation « manifestement délibérée » de l’obligation en cause, c’est-à-dire commise volontairement, avec la conscience de méconnaître la règle en cause. « L’infraction reste cependant non intentionnelle parce que le résultat consécutif aux actes de l’agent n’est pas voulu ni même envisagé et parce que l’attitude de l’agent se limite à la violation en connaissance de cause d’une règle de sécurité ou de prudence sans qu’existe chez lui une véritable conscience de commettre une infraction » (83).
Cette notion est notamment utilisée pour caractériser le délit de mise en danger d’autrui ou ceux d’atteintes involontaires à l’intégrité ou la vie humaine (84) . Il existe des précédents dans lesquels une telle violation a été reconnue du fait du non-respect de la réglementation ICPE (85).
On peut néanmoins douter de l’opportunité d’utiliser cette notion en matière environnementale. En effet, compte tenu de la finalité de la réglementation environnementale, toute méconnaissance emporte, par voie de conséquence, un risque pour l’environnement. Et comme sont généralement en cause des professionnels, censés connaître – et respecter – la réglementation applicable, le non-respect de celle-ci est généralement fait en connaissance de cause du risque pour l’environnement. Finalement, « la preuve d’une faute délibérée est rendue plus facile dans un domaine technique comme le droit de l’environnement en raison de l’abondance des réglementations techniques très précises que le professionnel est présumé connaître » (86). Et la frontière avec l’intention paraît alors bien mince.
Selon le rapport de la commission de l’aménagement du territoire du Sénat sur le projet de loi, « [u]ne atteinte est considérée comme intentionnelle si elle résulte de la violation d’une réglementation environnementale. Elle est non-intentionnelle si elle résulte par exemple du non-respect de règles générales de sécurité aboutissant à des rejets dans l’environnement » (87). Une telle distinction, toutefois, qui fait dépendre l’intention de l’objet de la règle méconnue, paraît artificielle et ne permet pas d’expliquer la différence de peines entre les deux délits.
On peine, dès lors, à discerner ce qui permettra de différencier, concrètement, le délit non-intentionnel de l’article L. 231-1 de l’écocide.
Si ce qui les distingue est la conscience de l’atteinte grave et durable à l’environnement, le délit de l’article L.231-1 devrait viser les cas de violation d’une obligation de prudence ou de sécurité, quelle qu’elle soit, sans la conscience du risque pour l’environnement (par exemple quand l’auteur est un non-professionnel, ou quand le lien de causalité entre la règle ou l’obligation violée et le risque pour l’environnement n’est pas évident).
Le risque est que, pour mieux la distinguer de la violation manifestement délibérée, il soit exigé une intention particulière pour caractériser l’écocide, qui pourrait aboutir à restreindre encore davantage le champ d’application de celui-ci.
Au final, et de manière pour le moins surprenante, la définition française du délit d’écocide apparaît, à plus d’un égard, davantage restrictive que la définition du crime d’écocide que le groupe d’experts international propose d’insérer dans le statut de la Cour pénale internationale. Outre l’incohérence d’une telle situation, le risque est élevé que l’écocide soit, en raison d’une définition inadaptée et indûment restrictive, peu ou mal (voire pas du tout) appliqué. Et que, malgré des peines significatives, la création du délit d’écocide ne s’avère aucunement dissuasive.
***
« Le génocide et le crime contre l’humanité ont marqué le XXe siècle. L’écocide est le combat du XXIe siècle » (88). Le 29 juin 2020, le président de la République, recevant la Convention citoyenne pour le climat, s’est engagé à porter le combat, au nom de la France, pour inscrire le crime d’écocide dans le droit international (89). Les occasions ne devraient pas manquer dans les prochains mois : Assemblée générale des Nations-Unies en septembre dédiée notamment à la reconnaissance du droit universel à un environnement sain, Sommet mondial pour la biodiversité à Kunming en octobre, Sommet climat en novembre à Glasgow, Assemblée des États parties au statut de la Cour pénale internationale en décembre (90).
Le traitement réservé à l’écocide dans la loi climat permet, toutefois, de douter des intentions françaises. En refusant de reconnaître le crime d’écocide dans son droit pénal, la France a manqué l’occasion d’être force motrice d’un mouvement qui finira par s’imposer comme inéluctable. Pire, en réduisant l’écocide à un délit obscur et inadapté, elle crée un précédent qui pourrait niveler par le bas les futures discussions au sein de l’Union européenne et à l’international.
Face à l’urgence environnementale, l’indolence française rend d’autant plus indispensables et salutaires le rôle des organismes internationaux et de la société civile, ainsi que des initiatives telles que la proposition de résolution du groupe Ecolo-Groen, au Parlement belge, visant à inclure le crime d’écocide à la fois dans le droit pénal belge et dans le statut de la Cour pénale internationale (91).
En attendant, les nouveaux délits créés par la loi climat, pour décevants qu’ils soient, ont le mérite d’exister. Il importe, à la société civile notamment, de s’en emparer, de les éprouver, d’utiliser cette arme puissante qu’est le système judiciaire pour en explorer les failles et les limites, les exploiter, les faire évoluer. Au pire, cela permettra de gagner en expertise, de mieux identifier les obstacles et d’être à même de faire des propositions crédibles de transformation du droit. Au mieux, qui sait, grâce à une démonstration rigoureuse mais néanmoins ambitieuse, de premières condamnations pourraient être obtenues (92).
Julia Thibord
Avocate au Barreau de Paris
Cabinet Vigo
Notes
- Proposition de loi instituant le délit de pollution, Sénat, n° 292, seconde session ordinaire de 1977-1978, annexe au procès verbal de la séance du 6 avril 1978, exposé des motifs, pp. 2-3.
- Valérie Cabanes, citée in Communiqué de Presse de la Fondation Stop Ecocide, 23 novembre 2020, « Le gouvernement français trahit les demandes de la Convention Citoyenne pour le Climat en utilisant faiblement le terme ‘écocide’ ».
- Cf. notamment sur le sujet le podcast de l’émission C’est pas du vent, « Agent orange au Vietnam: un écocide en quête de reconnaissance », France Inter, 28 janvier 2021.
- Cf. les travaux de la commission du droit international et notamment les versions du Projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de 1986 et 1991 : Annuaires de la Commission du droit international 1986 (volume 2, première partie, doc. A/CN.4/398, p.61) et 1991 (volume 2, deuxième partie, doc. A/46/10, p.111). Cf. aussi A. Gauger, M.P. Rabatel-Fernel, L. Kulbicki, D. Short & Polly Higgins, « Ecocide is the fifth missing crime », Human Rights Consortium, Université de Londres, 2012 (mis à jour en 2013), §§8-12.
- Article 8.2(b)(iv) du statut de la Cour pénale internationale.
- https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/GD.MDV.3.12.pdf; https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/GD.VAN.2.12.pdf
- https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/GD.BEL.14.12.pdf
- Résolution du Parlement européen du 20 janvier 2021 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l’Union européenne en la matière – rapport annuel 2019 (2020/2208(INI)) ; Résolution du Parlement européen du 19 mai 2021 sur les effets du changement climatique sur les droits de l’homme et le rôle des défenseurs de l’environnement en la matière (2020/2134(INI)) ; Recommandation du Parlement européen du 9 juin 2021 à l’intention du Conseil concernant les 75e et 76e sessions de l’Assemblée générale des Nations unies (2020/2128(INI)).
- Stop Ecocide Foundation, Groupe d’experts indépendants pour la définition juridique de l’écocide, Commentaire de la définition, juin 2021, disponible sur le site Internet de la fondation : https://www.stopecocide.earth/legal-definition. Le crime d’écocide y est défini comme « des actes illicites ou arbitraires commis en connaissance de la réelle probabilité que ces actes causent à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables ».
- « Stratégies parlementaires pour renforcer la paix et la sécurité face aux menaces et aux conflits résultant des catastrophes liées au climat et à leurs conséquences », Résolution adoptée le 27 mai 2021, disponible sur le site de l’UIP : https://www.ipu.org/fr/event/142e-assemblee-de-luip#event-sub-page-23958/
- Rapport fait au nom de la commission des lois du Sénat sur la proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide, n°446, 10 avril 2019 ; Rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide (n° 2353), 27 novembre 2019.
- https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Convention/ccc-rapport-final.pdf
- « Convention citoyenne pour le climat : la réponse de l’Elysée », Actu Editions législatives, 2 juillet 2020 ; Avis de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi climat, 26 mai 2021, p.85 ; interview de Barbara Pompili sur France TV info, 23 novembre 2020, « Délit d’écocide: « Le glaive de la justice va s’abattre enfin sur les bandits de l’environnement » ».
- Étude d’impact du projet de loi climat, 10 février 2021, p.639. Cf. aussi l’interview de Barbara Pompili et Eric Dupont-Moretti, Journal du Dimanche, 21 novembre 2020 et l’interview de Barbara Pompili sur France TV info du 23 novembre 2020, « Délit d’écocide: « Le glaive de la justice va s’abattre enfin sur les bandits de l’environnement ».
- Avis de la Commission des lois du Sénat sur le projet de loi climat, 26 mai 2021, p. 85.
- Podcast « Réfléchir l’écocide avec Valérie Cabanes », France Inter, 15 juillet 2020.
- https://preprod.notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2019/11/Chevron-c.-Equateur.pdf. Cf. aussi Marie Toussaint, « L’écocide : vers une reconnaissance internationale », Les Possibles, n° 25, Automne 2020, p.6
- Le nombre des défendeurs a ultérieurement été réduit à 13. Cf. Bernard Haftel, « Affaire de « l’agent orange » : les juges français peuvent-ils juger des sociétés commerciales étrangères pour écocide de guerre ? » Recueil Dalloz 2021 p. 1549.
- Cf.https://ecocidelaw.com/existing-ecocide-laws/. Sur l’écocide en droit russe, cf. Nadine Marie-Schwartzenberg in Antonio Cassese et al., Juridictions nationales et crimes internationaux, PUF, 2002, chapitre 8, p.267.
- Edouard Delattre, « Il faut reconnaître le crime d’écocide », Tribune, Libération, 29 juin 2020.
- Marie Toussaint, « L’écocide : vers une reconnaissance internationale », Les Possibles, n° 25, Automne 2020, p.6.
- https://preprod.notreaffaireatous.org/decryptage-sur-lecocide-et-la-reforme-de-la-constitution-portees-par-la-convention-citoyenne-pour-le-climat/
- Interview sur France TV info, 23 novembre 2020.
- Valérie Cabanes, citant le philosophe Dominique Bourg, in Podcast « Réfléchir l’écocide avec Valérie Cabanes », France Inter, 15 juillet 2020.
- « Vivre et mourir avec le risque industriel. Bhopal, l’infinie catastrophe », Le Monde diplomatique, décembre 2004.
- Amnesty International, « Une vérité toxique. A propos de Trafigura, du Probo Koala et du déversement de déchets toxiques en Côte d’Ivoire, AFR 31/002/2012, Septembre 2012.
- https://www.rtbf.be/tendance/green/detail_le-combat-de-l-avocat-pablo-fajardo-contre-une-compagnie-petroliere-d-equateur?id=10187906, cité in M. Toussaint, op.cit.
- Chambre des représentants de Belgique, proposition de résolution visant à inclure le crime d’écocide dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et le droit pénal belge, n° 1429/001, 8 juillet 2020, p.6.
- Marie Toussaint, « L’écocide : vers une reconnaissance internationale », Les Possibles, n° 25, Automne 2020, p.3.
- https://fr.monsantotribunal.org/upload/asset_cache/180671266.pdf
- https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/03/28/au-mozambique-beira-premiere-ville-au-monde-detruite-par-les-changements-climatiques_5442723_3212.html
- Communiqué de presse du 9 août 2021, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/08/IPCC_WGI-AR6-Press-Release_fr.pdf
- Marie Toussaint, « L’écocide : vers une reconnaissance internationale », Les Possibles, n° 25, Automne 2020, p.3.
- https://www.lefigaro.fr/sciences/la-pollution-de-l-air-provoquerait-pres-de-100-000-morts-prematurees-par-an-en-france-20210209
- https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/12/12/il-y-a-vingt-ans-le-naufrage-du-petrolier-erika-provoquait-la-catastrophe_6022671_3244.html
- https://la1ere.francetvinfo.fr/chlordecone-scandale-etat-grand-dossier-836440.html
- « Le scandale du chlordécone n’est pas un accident, c’est un crime hors norme », Le Monde, 28 mars 2021.
- TA Paris, 3 février 2021, requêtes n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1.
- CEDH, Mahmut Kaya c. Turquie, Requête n° 22535/93, 28 mars 2000, §85.
- « Délit d’écocide : les faux-semblants de la pénalisation du « banditisme environnemental » Tribune, Le Monde, 2 décembre 2020.
- Avis de la Commission des lois du Sénat sur le projet de loi climat, 26 mai 2021, p.10. Le terme d’écocide, supprimé par le Sénat en première lecture, a été réintroduit lors de l’examen en commission mixte paritaire.
- Citée in Sébastien Mabile & Emmanuel Tordjman, « Le droit pénal de l’environnement à la croisée des chemins », La Semaine du droit – Edition générale, n° 47, 16 novembre 2020, p. 1293.
- https://preprod.notreaffaireatous.org/decryptage-sur-lecocide-et-la-reforme-de-la-constitution-portees-par-la-convention-citoyenne-pour-le-climat/
- « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », op.cit., pp. 26 et s.
- Interview de Barbara Pompili sur France TV info, le 23 novembre 2020. Cf. aussi l’interview de Barbara Pompili et Eric Dupont-Moretti, Journal du Dimanche, 21 novembre 2020.
- Cf. Rapport fait au nom de la commission des lois du Sénat sur la proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide, n°446, 10 avril 2019, p.15 ; Interview de Barbara Pompili et Eric Dupont-Moretti, Journal du Dimanche, 21 novembre 2020 ; Étude d’impact du projet de loi climat, 10 février 2021, p.639.
- Articles 111-2 et 111-3 du code pénal ; article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme ; article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et article 34 de la Constitution.
- Décision n°80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, §7. Pour une application récente : Décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, Loi pour une sécurité globale préservant les libertés, §163 (censurant, pour manque de précision, le délit de provocation à l’identification d’un agent de police).
- Cf. Étude d’impact du projet de loi climat, pp. 625 et s. ; Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi climat, n° 3995, 19 mars 2021, pp. 465-468 ; Rapport fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire du Sénat, n° 666, 2 juin 2021, pp. 249-253.
- D. Chilstein, « L’efficacité du droit pénal de l’environnement », in L’efficacité du droit de l’environnement, Paris, Dalloz, 2010, p. 72, cité in Isabelle Fouchard & Laurent Neyret, « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », Rapport remis à la garde des sceaux le 11 février 2015, p.14.
- Marie-Odile Bertella-Geffroy, « L’ineffectivité du droit pénal dans les domaines de la sécurité sanitaire et des atteintes à l’environnement », Environnement n° 11, Novembre 2002, chron. 19 ; « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », op.cit., pp.14 et s. ; Juliette Tricot, « Les infractions environnementales face au renouvellement des stratégies et techniques d’incrimination », Revue Energie Environnement Infrastructures n°12, décembre 2017 ; Sébastien Mabile & Emmanuel Tordjman, « Le droit pénal de l’environnement à la croisée des chemins », La Semaine du droit – Edition générale, n° 47, 16 novembre 2020.
- Code de l’environnement, article L. 216-6.
- Code de l’environnement, articles L.218-10 à L.218-25 (rejets polluants des navires), L.218-34 (pollution due aux opérations d’exploration ou d’exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol), L.218-48 (pollution par immersion de déchets) et L. 218-64 (pollution par incinération en mer).
- Code de l’environnement, articles L. 218-12 et L. 218-13.
- Code de l’environnement, article L. 218-14.
- Code de l’environnement, articles L. 173-1, I et II et L. 173-2 .
- Code de l’environnement, article L.173-3.
- Code de l’environnement, article L.173-1, III.
- Code de l’environnement, article L. 541-46.
- Code de l’environnement, articles L. 521-21,9° et L.226-9.
- Code pénal, articles 421-2 et 421-4.
- Jean-Yves Maréchal, « Elément moral de l’infraction », JurisClasseur Pénal Code, art.121-3, fasc.20, §71 et §86.
- Code de l’environnement, article L. 231-1, deuxième alinéa : « Le premier alinéa du présent article ne s’applique : 1° S’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par décision de l’autorité administrative compétente ; 2° S’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente. »
- V. sur cette question Jean-Nicolas Citti & Manuel Pennaforte, « Les délits environnementaux prévus par le projet de loi Climat », Actu Editions législatives, 26 avril 2021.
- La Cour de cassation a récemment jugé que les incriminations des articles L.216-6 et L.432-2 n’étaient pas exclusives l’une de l’autre, la seconde tendant à la protection spécifique du poisson exclue par la première : Cass. crim., 16 avr. 2019, n° 18-84.073. Commentaire de Jacques-Henri Robert, Droit pénal n° 6, Juin 2019, comm. 109.
- Juliette Tricot, « Les infractions environnementales face au renouvellement des stratégies et techniques d’incrimination », Revue Energie Environnement Infrastructures n°12, décembre 2017, 31, p. 3.
- https://preprod.notreaffaireatous.org/decryptage-sur-lecocide-et-la-reforme-de-la-constitution-portees-par-la-convention-citoyenne-pour-le-climat/
- Code de l’environnement, article L. 541-4-1.
- Notre Affaire à Tous, « Analyse des dispositions du titre VI du projet de loi climat et résilience », https://preprod.notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2021/04/PJL-LOI-CLIMAT-De%CC%81cryptage-e%CC%81cocide-V4.docx-1-1-1.pdf
- Étude d’impact du projet de loi climat, p. 640.
- Cf. par ex. Isabelle Foucard & Laurent Neyret, « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », 2015, p.35.
- Cf. le site de la fondation Stop Ecocide pour un panorama des différentes propositions de définitions https://ecocidelaw.com/selected-previous-drafts/. V. également les propositions de loi précitées examinées par l’Assemblée nationale (« dommages étendus, irréversibles et irréparables ») et le Sénat (« atteinte grave et durable ») en 2019 ainsi que le rapport remis à la garde des sceaux en 2015, qui préconise de subordonner l’écocide à un dommage « particulièrement grave », c’est-à-dire « soit à la réalisation d’une dégradation étendue, durable et grave des équilibres écologiques, soit à la mort, des infirmités graves ou des maladies incurables graves à une population, soit à la dépossession durable de certaines populations de leurs territoires ou ressources » (« 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement »,op.cit, p.31). Enfin, pour un panorama des définitions existantes en droit interne : https://ecocidelaw.com/existing-ecocide-laws/
- Le texte précise : par « étendu », on entend que les dommages s’étendent au-delà d’une zone géographique limitée, qu’ils traversent des frontières nationales, ou qu’ils touchent un écosystème entier ou une espèce entière ou un nombre important d’êtres humains ; par « durable », on entend que les dommages sont irréversibles ou qu’ils ne peuvent être corrigés par régénération naturelle dans un délai raisonnable.
- Rapport fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire du Sénat, n° 666, 2 juin 2021, p. 255.
- Ibid.
- Corinne Lepage, « Le délit d’écocide : une « avancée » qui ne répond que très partiellement au droit européen », Dalloz Actualité, 17 février 2021 (sur la durée de 10 ans exigée par le projet de loi initial).
- Propos de l’ancien conseiller à la Cour de cassation Thierry Fossier cités in Sébastien Mabile & Emmanuel Tordjman, « Le droit pénal de l’environnement à la croisée des chemins », La Semaine du droit – Edition générale, n° 47, 16 novembre 2020, §33.
- Jean-Yves Maréchal, « Elément moral de l’infraction », JurisClasseur Pénal Code, art.121-3, fasc.20, §34. Cf. aussi Patricia Savin, « Contentieux répressif des installations classées », JurisClasseur Environnement et Développement durable, fasc. unique, §§160 et s. Pour des illustrations en matière environnementale : Cass.crim., 2 oct. 2007, n° 07-81.194 et Cass. crim., 16 juin 2009, n° 08-87.911 (infractions à la législation ICPE); Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84.949 et Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84.950 (article L.173-1 du code de l’environnement).
- Jacques-Henri Robert, « L’élément moral des infractions contre l’environnement », RSC 1995, p.356.
- Cf. notamment l’analyse d’Isabelle Foucard et Laurent Neyret, qui préconisent de limiter le crime d’écocide aux seuls actes intentionnels in « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », op.cit., p.40. Voir a contrario, Valérie Cabanes, « Reconnaître le crime d’écocide », C.E.R.A.S., Revue projet, 2016/4, n°° 353, p.72 : « lever l’exigence d’une intention pour qualifier ce type de crime permettrait d’imposer par le droit pénal le principe de précaution énoncé à l’article 15 de la Déclaration de Rio, avec une obligation de vigilance environnementale et sanitaire à l’échelle globale ».
- Dans sa version initiale, le projet de loi précisait d’ailleurs que l’écocide était commis « en ayant connaissance du caractère grave et durable des dommages (…) susceptibles d’être induits par les faits » (Article 68 du projet de loi déposé le 21 février 2021). Mais la rédaction de l’ensemble du texte, qui aboutissait à des peines différentes pour des faits identiques, a été critiquée par le Conseil d’État comme contraire au principe d’égalité, et modifiée par le Sénat en première lecture, supprimant notamment cette précision concernant l’intention. Le Conseil d’État a, à cette occasion, rappelé que « la connaissance du risque d’atteinte à l’environnement à raison du non-respect de cette réglementation est déjà incluse dans les éléments constitutifs de ces infractions, au titre du dol général » : Avis sur un projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et ses effets, 10 février 2021, §77.
- Cf. aussi « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », op.cit., p.40, préconisant « une définition adaptée de l’intention, qui serait caractérisée lorsque l’auteur savait ou aurait dû savoir qu’il existait une haute probabilité que [ses actes] portent atteinte à la sûreté de la planète ».
- Jean-Yves Maréchal, « Elément moral de l’infraction », Jurisclasseur pénal code, art.121-3, fasc.20, §86.
- Articles 221-6 (homicide involontaire), 222-19 et s. (violences involontaires) et 223-1 (mise en danger de la vie d’autrui) du code pénal. Cf. aussi article 121-4 du code pénal en matière de responsabilité indirecte.
- Cass. Crim., 22 Novembre 2005, n° 05-80.282 (homicide involontaire résultant de la violation d’un arrêté de mise en demeure) ; Cass. Crim., 16 Octobre 2012, n° 11-87.369 (mise en danger d’autrui résultant du défaut de déclaration d’une ICPE, en violation de l’article L. 512-8 du Code de l’environnement et de l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 20 août 2000) ; Cass crim., 11 juill. 2017, n° 11-83.864, 14-86.985, Sté Noroxo et M.X (non-respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation) ; CA Paris, 11 oct. 2019, n°18-04919, incinérateur de Vaux le Pénil (mise en danger d’autrui résultant du non-respect des taux de rejets dans l’atmosphère, en violation de mises en demeure), commenté in Corinne Lepage, Benoit Denis & Valérie Saintaman, « Condamnation pénale pour mise en danger des populations exposées aux dioxines d’un incinérateur », Énergie – Environnement – Infrastructures n° 12, Décembre 2019, comm. 60.
- « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », op.cit., p. 38.
- Rapport fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire du Sénat, n° 666, 2 juin 2021, p.269.
- Christophe Bouillon, rapporteur et auteur de la proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide, Rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide (n° 2353), 27 novembre 2019, p.37.
- « Le gouvernement transforme l’écocide en délit environnemental », Le Monde, 24 novembre 2020. Cf. aussi Emmanuel Macron sur Twitter 29 juin 2020.
- Cecilia Rinaudo, « Définition internationale de l’écocide : une proposition solide qui impose à la France d’agir », communiqué de presse Notre Affaire à Tous, 22 juin 2021.
- Chambre des représentants de Belgique, Proposition de résolution visant à inclure le crime d’écocide dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et le droit pénal belge, n° 1429/001, 8 juillet 2020.
- Sur l’utilisation du système judiciaire pour faire évoluer le droit, cf. Frédéric Amiel et Marie-Laure Guislain, « Le néo-libéralisme va-t-il mourir ? », Les Editions de l’Atelier, 2020.