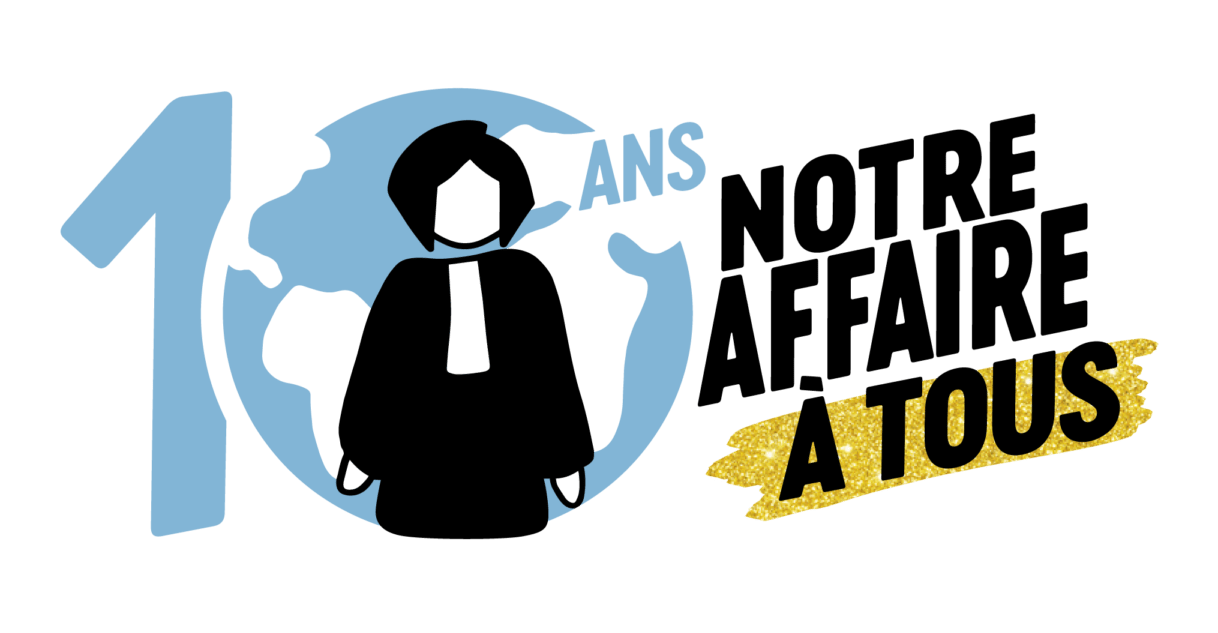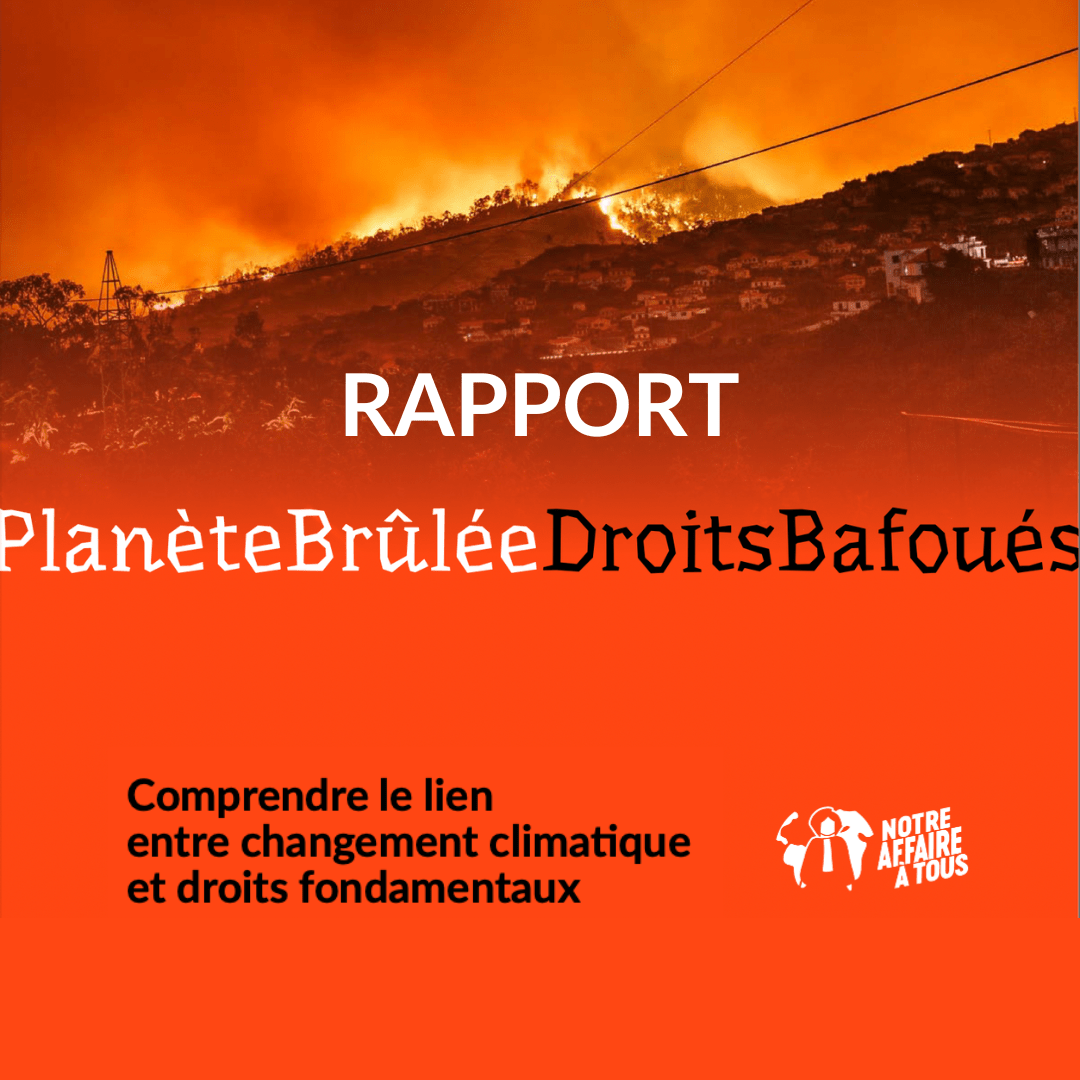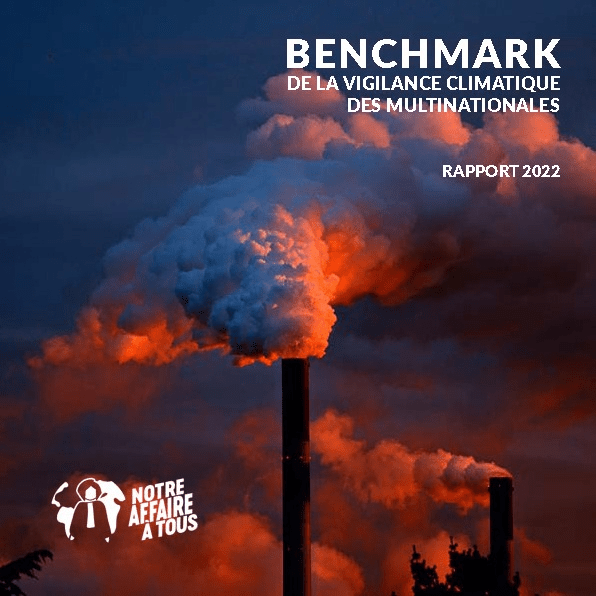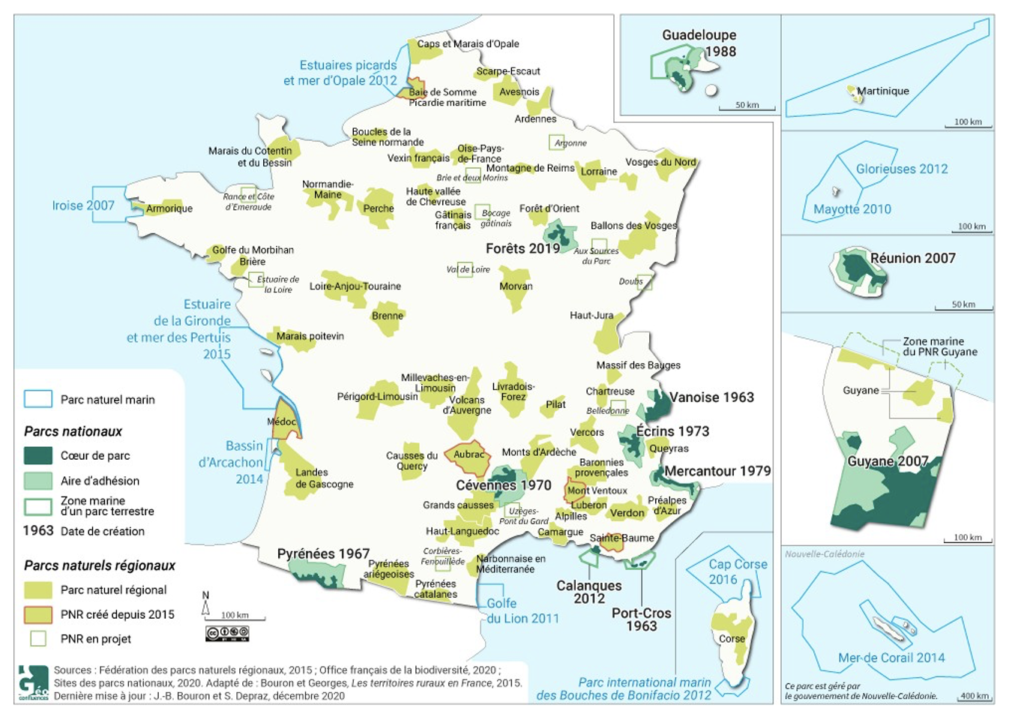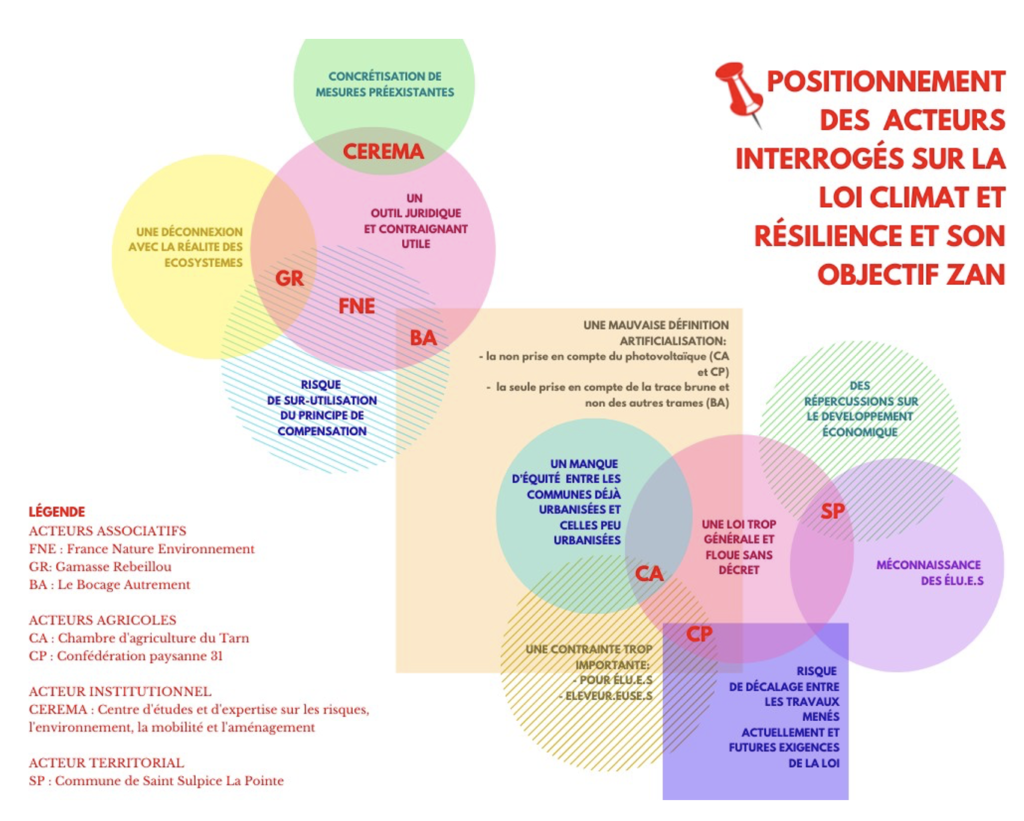Sommaire
Introduction : Quelles promesses offre le droit à l’alimentation dans la lutte contre les inégalités climatiques ?
I : Le droit à l’alimentation, une notion encore floue?
Quelques éléments de définition
Délimiter le droit à l’alimentation
Une apparition progressive du droit à l’alimentation dans les sources normatives
II : Vers l’applicabilité du droit à l’alimentation
De rares mobilisations du droit à l’alimentation par des cours étrangères
Les prises de position non contraignantes des Comités onusiens
Une protection indirecte du droit à l’alimentation par la CEDH
Des procès à portée symbolique dans certains cadres nationaux
III : Comment mobiliser le droit à l’alimentation aujourd’hui ?
Par la mobilisation/ le truchement de notions adjacentes
Quelques recommandations des instances des Nations Unies
Politiques publiques : la proposition du Collectif Sécurité sociale de l’alimentation
Conclusion
Bibliographie
Table des abréviations
CADHP : Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples
CCPR : Comité des droits de l’Homme
CEDAW : Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
CEDH : Cour européenne des droits de l’Homme
CESDH : Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
CODESC : Comité des droits économiques, sociaux et culturels
CRC : Comité des droits de l’enfant
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques
ONU : Organisation des Nations Unies
PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et politiques
PIDESC : Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Introduction : Quelle promesse offre le droit à l’alimentation dans la lutte contre les inégalités climatiques ?
Le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté a laissé entendre que nous nous dirigions vers un « scénario d’apartheid climatique dans lequel les nantis paient pour échapper à la chaleur excessive, à la faim et aux conflits, tandis que le reste du monde est laissé à sa souffrance » (A/HRC/41/39, par. 51).
Les récentes sécheresses et inondations dans la Corne de l’Afrique, en Afrique australe, en Amérique centrale, en Asie, dans les Caraïbes et dans le Pacifique illustrent l’impact de la crise climatique sur les cultures des pays du Sud, annonçant une crise alimentaire croissante. Si la situation des réfugiés climatiques est maintenant plus connue, celle des personnes souffrant d’insécurité alimentaire reste encore confidentielle. Pourtant, cela concernait en 2016 le sort de 31,1 millions de personnes dans la Corne de l’Afrique. Avec la multiplication des événements météorologiques extrêmes, la faim et la malnutrition se présentent comme des enjeux primordiaux, d’autant plus qu’ils rendent explicites les inégalités climatiques qui frappent les pays défavorisés.
A l’échelle mondiale, la crise sanitaire du Covid-19 a été pour une partie de la population une crise alimentaire et de subsistance. Les effets économiques causés par la pandémie et l’insuffisance de dispositifs de protection sociale ont engendré une perte soudaine de leur seule source de revenus pour des millions de personnes. Les discriminations et les inégalités de richesse se sont accentuées de manière frappante pendant la première année de la pandémie. Selon le rapport de 2021 sur l’état du droit à l’alimentation et à la nutrition, “le nombre de personnes souffrant de faim a augmenté de 161 millions en seulement un an”. Plus que jamais la question du droit à l’alimentation se pose de manière cruciale, dans un contexte d’enrichissement illimité des grandes fortunes et des multinationales.
Malheureusement, le droit à l’alimentation ne fait pas consensus. Selon les ordres juridiques, il est plus ou moins défini, reconnu ou contraignant. De manière générale, ce droit reste faiblement mobilisé, voire totalement inexistant. Pourtant, l’arsenal juridique se renforce progressivement, et ce à tous les niveaux, et les organes juridictionnels ou quasi-juridictionnels font évoluer leur jurisprudence.
Ainsi, il faut se demander quelle promesse offre le droit à l’alimentation dans la lutte contre le changement climatique ?
Encore confidentielle, la notion même du droit à l’alimentation demeure floue (I). Cela complique les moyens d’appliquer ce droit devant les juridictions des différents ordres juridiques (II). Il devient donc urgent, aujourd’hui, de savoir s’il est possible de mobiliser le droit à l’alimentation, et par quels moyens (III).
- Le droit à l’alimentation, une notion encore confidentielle
Il n’existe pas de définition unique du droit à l’alimentation, mais les travaux de l’Organisation des Nations unies (ONU) permettent d’en tracer les contours.
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (ci-après “CODESC”), chargé du suivi de la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ci-après “PIDESC”) par les États parties, précise les éléments fondamentaux qui constituent le droit à l’alimentation. Ce sont ces critères, repris par les Conventions internationales ou autres institutions internationales, qui participent à concrétiser une potentielle application de ce droit.
Le Rapporteur spécial de l’ONU synthétise ce premier essai de définition dans un rapport sur le droit à l’alimentation datant de 2001 :
“Le droit à l’alimentation est le droit d’avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit aux moyens d’achats monétaires, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie psychique et physique, individuelle et collective, libre d’angoisse, satisfaisante et digne”.
Le Rapporteur spécial revient sur celle-ci dans un nouveau rapport publié le 22 juillet 2020, où il souligne le rôle de l’alimentation dans la vie en communauté et dans le lien que des populations nouent avec leurs terres :
“Le droit à l’alimentation ne se cantonne pas au droit de vivre à l’abri de la faim. Il correspond au droit de tout un chacun de célébrer la vie au moyen de repas partagés en communion avec autrui. Une communauté se définit notamment par la question de savoir ce qu’elle mange, comment, quand et avec qui. Ainsi, les communautés se créent grâce au partage de fêtes, de souvenirs, de recettes, de saveurs et de pratiques alimentaires. Les peuples édifient leurs institutions sociales et politiques sur la base de ces pratiques”.
Contours et contenu du droit à l’alimentation
Le CODESC, dans son observation générale n° 12, définit le droit à l’alimentation comme le droit pour chacun (homme, femme et enfant, seul ou en communauté) de toujours bénéficier d’une nourriture suffisante, disponible et accessible physiquement et économiquement à tout moment.
Cette définition permet de dégager plusieurs critères cumulatifs pour constituer le droit à l’alimentation :
- L’accessibilité physique et économique : l’accessibilité économique signifie qu’une personne ou un ménage doit pouvoir acheter des denrées alimentaires sans que cette dépense ne porte atteinte aux dépenses liées aux autres besoins élémentaires. L’accessibilité physique, quant à elle, signifie que toute personne, y compris celles qui sont physiquement vulnérables, doit avoir accès à une nourriture suffisante.
- La disponibilité de la nourriture : pour cela, cette dernière peut, soit « être tirée directement de la terre ou d’autres ressources naturelles », soit être acheminée du lieu de production jusqu’à l’individu grâce à des systèmes de distribution, de traitement et de marchés opérants.
- La suffisance et l’adéquation de la nourriture : celle-ci doit être adaptée à la personne qui la consomme, et fournie en quantité suffisante. Elle doit satisfaire aux besoins alimentaires des personnes, compte tenu de leur âge, de leurs conditions de vie, de leur état de santé, de leur profession, de leur sexe etc.
- L’exclusion des substances nocives : les gouvernements doivent adopter des normes et mesures de sécurité pour la protection des aliments, que les personnes privées doivent ensuite respecter. Les mesures s’étendent à toutes les étapes de la chaîne alimentaire.
- L’acceptation de la nourriture sur le plan culturel ou pour le consommateur : il ne s’agit ici non pas de critère lié à la qualité nutritive des produits, mais au respect de la culture alimentaire (traditions culinaires, religions…) propre à chacun.
- La durabilité : les sources des aliments doivent être disponibles pour les générations actuelles, mais aussi futures.
Ces six critères permettent de mieux cerner le droit à l’alimentation, et permettent d’harmoniser les divergences de définitions.
Une apparition progressive du droit à l’alimentation dans les sources normatives
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le droit à l’alimentation fait timidement son apparition dans les sources de droit international visant à protéger les droits fondamentaux.
C’est d’abord la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, au paragraphe 1 de son article 25, qui fait du droit à l’alimentation un élément constitutif d’un niveau de vie suffisant, au même titre que les soins médicaux, le logement, ou encore l’habillement. Les composantes de ce droit visent le bien-être et la santé de toute personne, et des membres de sa famille.
En 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dote le droit à l’alimentation d’une définition plus précise au paragraphe 2 de son article 11 en reconnaissant “le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture |…] suffisant[e]». En ratifiant le Protocole facultatif au Pacte, adopté en 2008, les Etats reconnaissent la compétence du CODESC en matière de communications individuelles. Cela signifie que les individus peuvent saisir le Comité en cas de violation, par leur État, de leur droit à l’alimentation.
Le CODESC lui consacre en 1999 une place importante dans son Observation générale n°12 (précitée), dont la précision de la définition permet de guider l’effectivité du droit à l’alimentation. La Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale, inspirée des réflexions menées lors du Sommet mondial de l’alimentation de 1996 réaffirme le droit de chaque être humain d’avoir accès à une alimentation saine et nutritive conformément au droit à une nourriture adéquate et au droit fondamental de chacun d’être à l’abri de la faim » dans son premier paragraphe.
Le droit à l’alimentation est théorisé et défendu par de nombreuses organisations, l’ONU en première ligne. Cette mobilisation se retrouve au niveau régional dans le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’Homme (Protocole de San Salvador), dont l’article 12 consacre explicitement le droit à une alimentation adéquate. Certaines constitutions nationales, notamment celle de l’Afrique du Sud, protègent aussi ce droit. Cependant, ces cas de reconnaissance dans des instruments contraignants restent relativement rares.
Également bien reconnu et protégé au niveau international, le droit à l’alimentation ne retrouve pas cet arsenal juridique en droit français et en droit européen. Cela rend l’application de ce droit particulièrement difficile, voire hasardeuse.
- A la recherche d’une applicabilité du droit à l’alimentation
Au niveau international et européen, l’applicabilité par le juge du droit à l’alimentation demeure rare. Certaines cours nationales étrangères reconnaissent ce droit, notamment la Cour constitutionnelle colombienne. Au niveau international, les Comités onusiens reconnaissent le droit à l’alimentation de manière directe ou indirecte. Des procès fictifs, menés par la société civile, cherchent à mettre en lumière l’importance de l’alimentation. Au niveau régional, la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après “CEDH”) ne semble pas disposée à reconnaître pleinement le droit à l’alimentation, contrairement à la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (ci-après “CADHP”).
De rares mobilisations du droit à l’alimentation par des cours étrangères existent, comme l’illustre la décision de la Cour constitutionnelle de Colombie du 22 janvier 2004, “Acción de tutela instaurada por Abel Antonio Jaramillo y otros, T-025/04, § 9.4”. Dans son interprétation de la Constitution, la Cour s’est notamment inspiré des travaux du CODESC pour reconnaître un droit à un minimum de subsistance, comprenant la fourniture des aliments essentiels, qui doit être accordé en toutes circonstances aux personnes déplacées sur leur territoire.
Si ces affaires se révèlent intéressantes pour entrevoir une application du droit à l’alimentation dans des situations de crises, elles restent éminemment spécifiques et peu transposables à d’autres législations nationales.
L’inapplication en droit interne de nombreuses conventions internationales
Une des plus grandes difficultés vient du fait que de nombreuses conventions ne sont pas d’application directe en droit interne, soit en totalité, soit partiellement. Cela signifie que le juge interne ne peut pas rendre une décision sur le fondement de cette norme, il ne peut pas l’appliquer au niveau national. En droit français, pour qu’une norme soit applicable directement par le juge, il faut qu’elle soit suffisamment claire et précise, et qu’elle s’adresse aux personnes privées. Or, la plupart des articles du PIDESC, notamment l’article 11 dont découle le droit à l’alimentation, ne remplissent pas ces conditions. Il faut alors passer par d’autres fondements juridiques tels que la torture qui, eux, sont d’application directe et/ou inclus dans les droits nationaux d’une manière ou d’une autre. Cela permet de contourner le problème et de protéger indirectement le droit à l’alimentation. passage sans doute peu clair pour les non initiés.
Les prises de position non contraignantes des Comités onusiens
Les Comités onusiens prévoient une procédure pour connaître des plaintes individuelles des personnes physiques concernant la violation de leurs droits (seulement si l’État de nationalité du plaignant a ratifié le protocole correspondant). Bien que ces procédures ressemblent fortement aux procès tenus par des cours, les décisions prononcées par les Comités ne sont pas contraignantes. L’Etat n’est pas tenu de les appliquer dans son droit interne, contrairement aux décisions des cours de justice. Ainsi, les Comités onusiens sont qualifiés par la doctrine d’institutions quasi-juridictionnelles.
Certains Comités, instaurés par les Conventions onusiennes de protection des droits de l’Homme, reconnaissent et protègent le droit à l’alimentation de manière directe. C’est le cas du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après “CEDAW”). Dans deux décisions rendues le 24 février 2020, le Comité condamne la Macédoine du Nord pour violation de l’article 12 de la Convention. Les faits, similaires dans les deux affaires, concernaient la destruction d’un campement rom par le gouvernement. Les habitants sont expulsés et ne sont pas relogés dans des conditions convenables. Plusieurs femmes enceintes et mères de jeunes enfants saisissent le CEDAW pour violation de leurs droits. Dans les deux affaires, le Comité conclut à une violation de l’article 12 de la Convention, qui oblige l’Etat à fournir aux femmes une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement.
La reconnaissance directe du droit à l’alimentation demeure rare. Dans la plupart des cas, les Comités onusiens utilisent d’autres droits pour le défendre, de manière indirecte.
Le Comité des droits de l’Homme (CCPR) mobilise différents fondements juridiques pour protéger le droit à l’alimentation. Le 15 juillet 2019, dans une affaire concernant un enfant népalais arrêté et torturé par les autorités lors de sa détention, le Comité s’est fondé sur l’article 7 du PIDCP, lequel prévoit l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’enfant ne mangeait qu’un jour sur deux, et la nourriture était insalubre. Cela était un élément justifiant la condamnation du Népal.
Dans une autre affaire, le Comité s’est fondé sur l’article 17 du PIDCP (protection de la vie privée) pour condamner le Paraguay. En l’espèce, une petite communauté d’agriculteurs vivait à côté de grandes exploitations agricoles, lesquelles utilisaient des pesticides interdits par la loi paraguayenne. De nombreux membres de cette communauté sont tombés malades, et l’un d’eux est décédé. Le Comité déclare que
“l’Etat partie n’a pas procédé à des contrôles adéquats des activités illégales qui étaient source de pollution. [C]e manquement […] a permis la poursuite des fumigations massives et contraires à la réglementation interne […] qui ont provoqué non seulement la contamination de l’eau du puits du domicile des auteurs, […] mais aussi la mort des poissons et des animaux d’élevage et la perte de cultures et des arbres fruitiers sur les terres sur lesquelles les auteurs vivent et qu’ils cultivent, qui sont des éléments constitutifs de leur vie privée et familiale et de leur domicile”.
Ainsi, le manque de surveillance de l’État du respect des normes environnementales constitue une immixtion arbitraire dans la vie privée des agriculteurs. Le Paraguay a violé l’article 17 du PIDCP.
Le Comité des droits de l’enfant (CRC) se fonde principalement sur l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour reconnaitre le droit à l’alimentation. C’est le cas dans une décision de 2019. Dans cette affaire, un enfant avait tenté de franchir la frontière de l’enclave espagnole de Melilla. Il a été arrêté par les autorités espagnoles et renvoyé directement au Maroc. Le CRC déclare qu’avant de refouler un enfant, l’Etat à l’obligation d’évaluer s’il peut subir un dommage irréparable et doit tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment les conséquences qu’une alimentation insuffisante dans le pays de destination pourrait avoir sur lui. L’Espagne a été condamnée sur le fondement de l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant, pour avoir manqué à cette obligation.
Invocation des décisions des comités onusiens de protection des DH devant les juridictions internes :
Les décisions des Comités onusiens ne sont pas contraignantes. Elles ont tout de même une certaine valeur. De plus, les Etats parties ont une obligation générale de coopérer avec les Comités, dont découle une obligation de prêter attention et de réagir aux décisions.
Il serait donc envisageable que devant les juridictions internes, les personnes privées invoquent les décisions des Comités pour inciter les Etats à réagir.
En France, les juridictions prennent en considération les décisions mais ne leur donnent pas d’effet contraignant. (exemple : Conseil d’Etat, 1er avril 2019, n° 417652, Cour de cassation, Ass. plén., 28 juin 2019, no. 19-17.330, 19- 17.342, affaire Vincent Lambert).
Cependant, certains Etats, tels que l’Espagne, considèrent que les décisions des Comités sont contraignantes. Le Tribunal Suprême espagnol avait conclu, en 2018, que les décisions et les mesures provisoires ordonnées par le CEDAW ont un caractère obligatoire en Espagne. C’est une décision progressiste, qui pourrait peut-être inciter les juridictions françaises à faire de même.
Dans tous les cas, les prononcés peuvent être invoqués devant les juridictions internes pour faire pression, même si les Cours ne sont pas obligées de s’y conformer.
Finalement, les Comités onusiens reconnaissent assez largement le droit à l’alimentation, que ce soit de manière directe ou indirecte. Le problème est que leurs décisions ne sont pas contraignantes devant les juridictions internes françaises.
Ici, il convient d’expliquer que le caractère contraignant de la décision fait référence au contenant, à l’instrument qui contient le raisonnement du Comité. Il se distingue du caractère obligatoire de la décision, qui se rapporte au contenu, au fond. Il est possible que le contenu dispose d’un tel rayonnement, d’une telle valeur, qu’il en devient obligatoire pour l’Etat, même si l’instrument qui le contient n’est, lui, pas contraignant.
Cette distinction peut aussi s’appliquer aux décisions des Comités. Les Etats, en ratifiant les protocoles additionnels aux Conventions onusiennes prévoyant les mécanismes de communications individuelles, ne s’engagent pourtant pas à respecter les décisions des Comités. Celles-ci n’ont pas de caractère contraignant. Or, il est possible de relever un certain caractère obligatoire. Si les Etats acceptent la procédure de communication individuelle, c’est probablement l’illustration d’une certaine volonté à respecter et suivre les décisions des Comités. La décision serait alors non contraignante et obligatoire.
La limite au caractère obligatoire est que l’Etat peut décider de ne pas respecter une décision : il serait alors dans son droit, du fait de l’absence de caractère contraignant. Ainsi, la portée des décisions des Comités reste limitée.
Une protection indirecte du droit à l’alimentation par la CEDH
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après “CESDH”) ne garantit pas le droit à l’alimentation. Il n’y a donc pas de fondements juridiques sur lesquels la CEDH puisse protéger directement ce droit. Elle est obligée de recourir à la méthode de protection par ricochet, indirecte, en utilisant un autre droit reconnu par la CESDH.
Ainsi, la Cour s’est fondée sur l’article 3 de la CESDH interdisant les traitements inhumains et dégradants, ainsi que la torture pour protéger le droit à l’alimentation. Elle s’est aussi fondée sur l’article 8 qui protège la vie privée. Dans ces deux cas, le droit à l’alimentation n’est pas explicitement mentionné, et il semble qu’il n’est pas ce que la Cour cherche à protéger en premier lieu. En effet, la Cour n’invoque les carences de nourritures que pour aider à caractériser les violations des articles 3 et 8. Ce n’est jamais un élément central du raisonnement, mais plutôt un indice supplémentaire.
Un exemple intéressant serait la décision d’irrecevabilité CEDH, Budina c. Russie, 18 juin 2009 : la requérante invoquait une violation de l’article 3 de la CEDH car sa pension de retraite était trop faible pour survivre. Dans son raisonnement, la Cour examine le niveau de la pension : celle-ci lui permet de se loger et de se nourrir (mais pas d’acheter des vêtements ou d’avoir accès à des services culturels). Elle avait accès à des services médicaux, ce qui a permis à la Cour de confirmer que le niveau de pension ne créait pas de souffrances concrètes incompatibles avec la dignité humaine. Toutefois, le raisonnement est intéressant car, même si ce n’est pas le cas ici, cela laisse entendre que la difficulté d’accès à la nourriture (entre autres) pourrait être contraire à la dignité humaine.
Le droit à l’alimentation semble pouvoir être protégé sous le couvert de la liberté religieuse (article 9 CESDH). Dans cette affaire, un détenu boudhiste était forcé de manger de la viande, ce qui est contraire aux règles de sa religion. La CEDH fait de l’alimentation adéquate un élément central de son raisonnement. En ne fournissant pas une nourriture adaptée à la religion du détenu, la Pologne a été condamnée pour violation de l’article 9. Dès lors, dans ce cas, il semblerait que la Cour protège, d’une certaine façon, le droit à l’alimentation adéquate par ricochet.
Finalement, les jurisprudences de la Cour ne sont pas très concluantes. La plupart du temps, elle ne cherche pas à protéger le droit à l’alimentation, elle semble s’en servir comme un indice, un critère pour caractériser une autre violation. La seule protection par ricochet se fait sous le couvert de l’article 9.
Plus généralement, au-delà de l’aspect de la religion, il convient également d’ajouter toute la protection liée à l’alimentation et la nourriture pour les personnes privées de liberté (en prison, rétention, etc).. Par exemple, la décision CEDH, Ebedin Abi c. Turquie, 13 mars 2018 condamne la Turquie car le prisonnier n’avait pas accès à l’alimentation qui lui était médicalement prescrite. Celui-ci avait de nombreux problèmes de santé grave, notamment un diabète de type 2 et des problèmes cardiaques. Il devait suivre un régime alimentaire strict, riche en volaille et en légume. Or, le centre pénitentiaire refuse de fournir des repas conformes au régime du détenu, malgré plusieurs demandes de ce-dernier. Cela a entraîné une détérioration de sa santé, La Cour déclare une violation de l’article 3 qui implique une protection de l’intégrité physique des personnes emprisonnées et de prendre les mesures nécessaires pour la santé et le bien-être de la personne. En cas d’alimentation non conforme aux prescriptions médicales, il y a donc manquement au devoir d’ « assurer des conditions de détention adéquates et respectueuses de la dignité humaine”.
La Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, quant à elle, est beaucoup plus audacieuse, dans son rapport avec le droit à l’alimentation. Dans l’affaire du peuple Ogoni, la Commission affirme que le droit à l’alimentation est inséparable de la dignité humaine. Ce droit est protégé implicitement par le droit à la vie, le droit à la santé et le droit au développement économique, social et culturel, respectivement contenus dans les articles 4, 16 et 22 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. Le droit à l’alimentation entraîne, pour le Nigeria, une obligation de protection et de développement des sources de nourritures existantes, ainsi qu’une obligation de garantir l’accès à une nourriture adéquate pour tous les citoyens. Or, en autorisant des compagnies pétrolières à détruire les sources de nourriture du peuple Ogoni, le gouvernement a violé les trois obligations découlant du droit à l’alimentation.
Les cours régionales n’ont pas toutes la même approche du droit à l’alimentation. La CADHP n’hésite pas à consacrer ce droit, mais la CEDH est plus réticente.
Des procès à portée symbolique
En octobre 2016, à La Haye, l’Assemblée des peuples, tribunal citoyen informel concernant le géant américain Monsanto a mené ses travaux. Il s’agissait d’un procès citoyen, sans reconnaissance officielle, dont le but est d’alerter l’opinion et de faire avancer le droit.
Ce tribunal a réuni cinq juges issus de différents continents, doit respecter les opinions contradictoires et émettre des avis juridiques. Des experts et des personnes se présentant comme victimes liées aux produits de Monsanto se sont succédés pour débattre de ses impacts sur la santé, sur les sols et les plantes, la santé animale, la biodiversité, l’agriculture et la sécurité alimentaire. La firme est régulièrement mise en cause pour la diffusion de ses semences OGM et de ses produits phytosanitaires.
Le tribunal d’opinion a rendu son avis consultatif le 18 avril 2017. La compagnie américaine a été reconnue coupable de pratiques portant atteinte à de nombreux droits fondamentaux. Monsanto a été reconnue responsable de crimes contre l’humanité et d’écocide (notamment par la commercialisation de produits toxiques causant la mort de milliers de personnes comme l’agent orange, l’herbicide pulvérisé par avion par l’armée américaine durant la guerre du Vietnam). Monsanto a rejeté l’assemblée de La Haye.
L’avis consultatif relève que le droit à l’alimentation est reconnu en droit international (art. 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 24.2 (c) et (e) et 27.3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, art. 25 (f) et 28.1 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes). Les entreprises ont en outre la responsabilité de respecter ce droit, notamment par application des Principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’OCDE et des Principes directeurs sur les entreprises et les droits de l’homme. L’avis conclut que Monsanto s’est engagée dans des pratiques qui ont un impact négatif sur le droit à l’alimentation, en ce qu’elles conduisent à affecter la disponibilité de l’alimentation pour les individus et les communautés et à réduire leur capacité à se nourrir par eux-mêmes directement ou à choisir des semences non génétiquement modifiées.
- Le tribunal rappelle que le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable est reconnu en droit international. Pas moins de cent quarante États ont consacré ce droit au niveau constitutionnel, ce qui en fait une norme de droit international coutumier.
- Le tribunal rappelle que le droit de jouir du meilleur état de santé possible est reconnu en droit international (art. 12 du Pacte international préc., art. 24 de la Convention préc.). Il est lié à d’autres droits fondamentaux, tels que le droit à l’alimentation, à l’accès à l’eau et à l’assainissement ou encore à un environnement sain.
- L’avis relève que la liberté indispensable à la recherche scientifique est garantie en droit international (art 15, § 3, du Pacte international préc.). Le droit à la liberté de la recherche scientifique est intimement lié au droit à la liberté de penser, d’expression et au droit à l’information. Cette liberté est indispensable pour la protection des droits à l’alimentation, à l’eau et à un environnement sain et pour que les chercheurs puissent s’exprimer librement et soient protégés lorsqu’ils agissent comme lanceurs d’alerte.
Le but de ce tribunal est d’avertir sur la nécessaire amélioration du droit international afin de mieux protéger l’environnement. Aucun effet contraignant n’est donné à cet avis, ni même aucune condamnation a été prononcée contre Monsanto. Cependant la symbolique portée par ce procès, se déroulant dans deux instances emblématiques du droit international, laisse à penser que la protection des droits fondamentaux en lien avec l’environnement doit enfin se trouver dans l’arsenal juridique. phrase à reformuler
III. Comment mobiliser le droit à l’alimentation aujourd’hui ?
Le droit à l’alimentation, de par ses spécificités et la complexité du système dont il dépend, trouve difficilement son applicabilité par les recours juridiques actuels. D’autres pistes sont envisagées pour tendre vers un accès à une alimentation durable pour toutes et tous, dans un mouvement conjoint d’action politique et juridique.
Garantir le droit à l’alimentation par le truchement de notions adjacentes
Plusieurs notions adjacentes au droit à l’alimentation ont été déployées pour tendre vers des objectifs sensiblement similaires.
La sécurité alimentaire, approche fondée sur les droits humains, rompt avec d’une part la posture d’urgence, voire d’assistanat, dans laquelle se situe l’aide alimentaire et d’autre part avec une posture technologiste et productiviste d’évolution des conditions de production de la nourriture.
Cette notion a été employée dans la Loi sur la sécurité alimentaire (“Food Security Act”) qu’a adoptée l’Inde pour traiter le problème de la faim et de la malnutrition. Ce programme de distribution alimentaire visant à attribuer une certaine quantité de féculents, blé et riz à près de 820 individus, rend compte d’une première tentative de mettre en place une sécurité alimentaire à grande échelle.
Bien que cette mesure politique ne fait pas office de protection directe du droit à l’alimentation, la Cour suprême indienne a pu tenter de renforcer l’effectivité de celui-ci. Lors d’une décision de 2001, elle a reconnu par le truchement du droit à la vie, une valeur constitutionnelle au droit à l’alimentation. Ce litige a eu lieu dans le cadre d’un Public Interest Litigation, procédure par laquelle tout justiciable peut porter un pourvoi devant la Cour suprême s’il estime que ses droits fondamentaux ont été bafoués. La Cour a ainsi rendu une décision intéressante en termes d’applicabilité du droit à l’alimentation, en se basant sur les obligations auxquelles l’Inde s’était engagée en ratifiant le PIDESC. Il n’en reste que l’effectivité de ce droit reste aux mains du gouvernement, faute de normes contraignantes.
En France, bien que ni le droit à l’alimentation, ni celui d’être à l’abri de la faim ne soient reconnus juridiquement, des politiques alimentaires sont aussi mises en place pour tendre vers une certaine effectivité. C’est ici, dans une éventuelle mise en œuvre d’un droit à l’alimentation, que la notion de démocratie alimentaire paraît aussi intéressante : elle met l’accent sur l’idée de penser ce droit à partir de tous les acteurs et actrices de la chaîne, de la production à la consommation, en prenant en compte les enjeux environnementaux. Le professeur Tim Lang, qui a théorisé la notion de “démocratie alimentaire”, l’utilise en contrepoint de “contrôle alimentaire”, politique conjointe des capitaux privés et des gouvernements, « pour souligner la grande lutte au cours des siècles , dans toutes les cultures, pour permettre à tous les citoyens d’avoir accès à une alimentation décente, abordable et bénéfique pour la santé, cultivée dans des conditions dans lesquelles ils peuvent avoir confiance. ».
Ces notions sont ainsi autant de portes d’entrées pour nourrir l’effectivité d’un droit à l’alimentation, tant d’un point de vue politique, technique que démocratique.
Renforcer les outils relatifs au droit à l’alimentation : quelques recommandations
Les questions liées au droit à l’alimentation touchent la justiciabilité du droit à l’alimentation, les droits et l’autonomisation des femmes, les changements climatiques, la malnutrition, les catastrophes naturelles et l’aide humanitaire, les conflits et la famine, les travailleurs des secteurs de l’agriculture et de la pêche et les objectifs de développement durable.
La mondialisation des systèmes alimentaires peut potentiellement contribuer à augmenter la disponibilité et la diversité des aliments, et permettre ainsi de lutter contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition. En effet, pour l’instant, cette mondialisation a l’effet inverse et contribue plutôt à la marginalisation des petits exploitants agricoles et paysans, à la “supermarchisation” de l’alimentation et à la hausse des taux de malnutrition. Les travailleurs sont exploités et de plus en plus d’individus sont exposés à des pesticides toxiques.
Les ressources naturelles telles que l’eau, les forêts, les savanes, les terres agricoles et les pâturages sont souvent gérées collectivement selon les règles du droit coutumier. Le contrôle du marché se renforçant, ces terres font l’objet d’investissements agricoles dans le cadre du phénomène mondial d’« accaparement des terres » (Transnational Institute, « The global land grab: a primer » 2012). Ainsi, une perte de la biodiversité et une dégradation de l’environnement s’opère qui va de pair avec des conflits et crises alimentaires.
Les personnes dont l’alimentation et la subsistance dépendent directement du secteur agricole sont particulièrement vulnérables, et les inégalités fondées sur le sexe, l’âge, le lieu, la race, l’appartenance ethnique et la situation migratoire sont accentuées. Les conflits sont en outre un moteur de migrations.
Un exemple frappant : Deux tiers des situations d’insécurité alimentaire aiguë dans le monde s’expliquent par les crises en Afghanistan, en Éthiopie, dans le nord du Nigéria, en République arabe syrienne, en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud et au Yémen.
Bien que ceux qui affament délibérément des populations restent très souvent impunis, la communauté internationale a récemment pris des mesures pour que les États soient tenus responsables des violations du droit à l’alimentation en temps de guerre. Ainsi, en 2018, le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité la résolution 2417 (2018), qui condamne l’utilisation de la famine comme méthode de guerre et les refus illicites d’accès humanitaire aux populations civiles. Dans sa résolution, le Conseil a souligné le lien entre l’insécurité alimentaire provoquée par les conflits et le risque de famine, et a demandé aux parties aux conflits armés de se conformer au droit international humanitaire.
Transformer le système de l’alimentation : la proposition du Collectif Sécurité sociale de l’alimentation
Prenant le parti pris de rassembler toutes les parties prenantes de la production alimentaire, le collectif Sécurité Sociale de l’alimentation souhaite réfléchir à une transformation du système alimentaire. Sur le même modèle que celui de la Sécurité Sociale pour la santé, il s’agirait de garantir un accès à l’alimentation durable pour toutes et tous, et en faire un enjeu démocratique majeur.
Conclusion : pistes de réflexion et d’actions
Si le droit à l’alimentation peine déjà à être reconnu comme un droit fondamental à part entière, son application semble difficilement envisageable, tant devant les juridictions internes que internationales.
Quelques pistes restent intéressantes, comme la protection indirecte par ricochet du droit à l’alimentation devant la CEDH. Il semblerait que l’action ait le plus de chances de porter ses fruits si la requête se fonde sur l’article 9 de la CEDH, relatif à la liberté religieuse, par exemple, ou encore sur l’article 3 interdisant les traitements inhumains et dégradants et l’article 8 sur le droit au respect de la vie privée. Enfin, une piste de réflexion serait l’article 2 de la CEDH portant sur le droit à la vie. Quelles seraient les répercussions suite à des décès car les personnes n’ont pas pu se nourrir faute d’accès physique ou financier à l’alimentation ?
Un élément intéressant qui ressort de tout cela, est l’interdépendance des droits humains : les juridictions utilisent d’autres droits pour protéger le droit à l’alimentation. Finalement, sans alimentation correcte, il n’y a pas de droit à la santé. Et sans environnement sain, il n’y a pas de droit à l’alimentation. Une piste de réflexion sur la reconnaissance et la défense des droits humains, y compris celui à l’alimentation….
Au niveau international, les comités onusiens sont novateurs et reconnaissent, directement ou indirectement, le droit à l’alimentation. Bien que les prononcés de ces organes ne soient pas contraignants, il peut tout de même être intéressant de saisir ces institutions, car leurs décisions peuvent ensuite être invoquées devant les juridictions internes et européennes pour venir renforcer l’argumentaire des requérants. Cela pourrait conduire de nouvelles juridictions à reconnaître ce droit.
Enfin, certes le droit à l’alimentation fait l’objet d’une application timide en droit interne mais certaines pistes sont à creuser. D’une part, les décisions du Tribunal Administratif de Lille concernant les distributions de nourriture aux exilés sur le littoral semblent puiser dans un droit à l’alimentation. En effet, une ordonnance du 22 mars 2017, n°1702397, a annulé l’interdiction des distributions alimentaires sur le fondement que “les mesures litigieuses, qui ont pour effet de priver une population en très grande précarité d’une assistance alimentaire vitale, ne sont ni adaptées, ni nécessaires, ni proportionnées au regard du but réellement poursuivi et des constatations effectuées à ce jour”. D’autre part, une autre piste est le contentieux autour de l’accès à la cantine scolaire pour tous les enfants, y compris sur la question d’accès financier.
Il y a donc, dans une certaine mesure, une prise en compte de la question de l’alimentation dans le contrôle de proportionnalité effectué par les juridictions françaises. Ou du moins, une tentative en ce sens.
Annexes
I. Entretien avec Démocratie alimentaire / Collectif SSA
Dominique Paturel & Patrice Ndiaye
Qui êtes vous ?
Nous sommes dans le collectif SSA par le biais d’un collectif Démocratie alimentaire, créé à la fin du séminaire de recherche qu’on a mené avec Patrice et qui a nécessité qu’on trouve un prolongement qui soit dans cet espace science-société. Ce n’est pas complètement du côté de la recherche qui nécessiterait qu’on soit dans un laboratoire, et ce n’est pas non plus complètement du côté des actions et initiatives collectives en tant que telles. C’est une position assez difficile à tenir car nous rencontrons le problème de travailler avec une approche systémique en prenant en compte les quatre acteurs indispensables au système alimentaire, là où le collectif a une entrée essentiellement agricole.
Comment mobilisez-vous le droit à l’alimentation à travers l’action de votre collectif ?
Fondamentalement, aujourd’hui on est dans un moment particulier dans la façon de poser des nouveaux droits sociaux. L’alimentation est un bon exemple : en France, dès qu’on touche au droit social, la question de l’universalité est fondamentale. Il faut la prendre en compte.
En ce qui concerne le droit à l’eau, cela pourrait se traduire par des politiques publiques qui décideraient, par exemple, que les 10 premiers 10m3 seraient gratuits. Même s’il existe des qualités d’eau différentes sur le territoire, on est tous dans un pays qui a accès à une eau potable.
Sur l’alimentation, on ne peut pas réfléchir comme ça. La question de l’accès universel se confronte à la diversité des régimes alimentaires. Pas seulement à des échelles de cultures, mais simplement par rapport à des groupes d’âges : un nourisson mangera différemment d’un adolescent, ou d’une femme âgée.
D’ailleurs, dans l’aide alimentaire, ce sujet n’est pas du tout traité : les nourrissons ont la même aide alimentaire que celle des adultes, au nom de l’universalité. Il y a une tension entre cette universalité et la prise en compte des besoins identifiés. Contrairement à la façon qu’on a pu avoir de réfléchir jusqu’à maintenant, cette tension n’est pas à résoudre actuellement. Cela nous oblige à sortir du paradigme de pensée habituel binaire “universel/différentiel”.
Une deuxième chose, qui touche autant les questions d’alimentation que d’énergie, le problème est que le référentiel est soit les droits humains (dont droit à l’alimentation), soit de droit à la santé. Or les droits humains sont subalternes aux droits commerciaux, donc la question ne se pose pas : lorsqu’ils rentrent en conflits avec ces droits là, ils sont considérés comme mineurs. Ici se manifestent les enjeux entre droit de l’alimentation et droit à l’alimentation.
A partir des constitutions dans lesquelles nous sommes, le droit à la santé est considéré comme un droit absolu. Si on rentre sur ces questions, il faut donc partir du droit à la santé, c’est-à-dire aborder la question de la pauvreté, c’est-à-dire, partir depuis le biais des inégalités.
C’est un problème dans un pays où l’égalité est fondamentale pour justifier l’universalité. Cela nécessite de se demander : qu’est ce qui fait tort à l’égalité ?
On est davantage sur le fait de constater cette tension, et de la prendre comme telle dans un continuum de réponses.
Si l’on ne renouvelle pas notre vision du droit à l’alimentation, on a pour unique solution de moderniser l’existant, le fait de reconnaître des inégalités nouvelles, et d’y répondre par une modernisation des politiques sociales. C’est ce qui se fait depuis les années 80.
On est dans une période rude pour les chercheurs-ses de recherche impliquée. En l’espace de 5 ans, tout notre travail est traduit en droit commercial. Je fais partie des courants classiques français autour de la critique sociale, et aujourd’hui cette critique se transforme en segment de marché quasi immédiatement.
Notre travail sur le droit à l’alimentation a eu un effet insupportable, celui d’être rapatrié par les associations luttant contre la pauvreté, au nom de la dignité. Au-delà de ça, il n’y a jamais de dénonciation de ce droit et de sa non application.
Magali Ramel soutient sa thèse sur le droit à l’alimentation, dans laquelle elle analyse comment ce droit pourrait avoir des voies d’application et n’est pourtant pas appliqué en France.
Nous sommes aussi arrivées à des conclusions similaires : les seules marges de manœuvre reposent sur des protocoles, des déclarations, des conventions, qui ont pu amorcer les fondements juridiques d’une responsabilité étatique mais qui n’offrent pas de voies solides à une réelle application, ou de transformations concrètes en des politiques publiques.
La réponse de la France au droit à l’alimentation est l’aide alimentaire. Cette filière de l’aide alimentaire s’est mise en place dans une période précise, milieu des années 80, lorsque la crise économique était largement visible dans ses 1ers effets. Cette filière a aussi son rôle dans le soutien économique à l’agriculture, qui représente une part importante du PIB. On peut même observer que la construction de la filière de l’alimentaire correspond au moment de l’arrêt de l’aide alimentaire internationale au sein de la politique agricole commune. On peut donc supposer un recyclage de cette filière, à l’échelle nationale et européenne.
Mais nous n’avons pas accès aux textes et débats concernant ce sujet, et surtout nous n’avons pas la possibilité de nous entretenir avec les fonctionnaires de l’Union européenne. Cela montre aussi la puissance du lobby agricole qui pendant toutes ces années ont permis que l’aide alimentaire soit comprise dans la PAC.
Comment est ce que vous incluez la question de la durabilité dans le droit à l’alimentation ? Comment définissez-vous ce caractère durable et quels sont les leviers essentiels pour le concrétiser ?
L’entrée pour le droit à l’alimentation, c’est la démocratie, dans une société qui fonctionne par le droit. Pour moi, la démocratie alimentaire évoque 2 entrées : celles des actions collectives, qui permettent de se réapproprier les systèmes alimentaires (SSA, Amap, jardins) et celle de l’entrée par le droit, qui est fondamental pour faire avancer la question.
Nous revendiquons un “droit à l’alimentation durable” pour marquer la rupture avec le droit à l’alimentation tel qu’il est qualifié dans les droits humains. Cette proposition s’inscrit dans la façon dont s’est définie l’alimentation durable, à la fin des années 1990.
On a repris notamment la définition donnée par la FAO, qui inclut l’idée de “systèmes alimentaires”. C’est l’idée de partir de ce qu’il y a dans nos assiettes et de reconnecter ça avec les conditions de production de cette alimentation. Cette démarche transforme notre manière de voir ce qui se passe.
Selon vous, quelle place le droit peut-il jouer dans la lutte pour l’accès à une alimentation durable pour toutes et tous ?
On se pose la question de l’intérêt général, qui est une notion qu’on peut travailler d’un point de vue juridique. Un travail important a été fait sur l’analyse des obligations qui existent à l’échelle des collectivités territoriales. La notion de service public local est aujourd’hui mobilisée pour une expérimentation d’un “service public local de l’alimentation” au sein de la commune de Grande-Synthe.
Notre hypothèse sur cette expérimentation : avec cette approche systémique, cette tension identifiée mais non résolue, ce service public local pose la question de la coordination des politiques publiques de l’alimentation. Il a déjà beaucoup d’initiatives autour de l’agriculture, de la santé et de l’écologie : comment rapatrier ces questions dans un espace qui permettrait d’en construire et d’en élaborer une politique publique ?
Nous pourrions avoir ces espaces à l’échelle d’une région, d’une intercommunalité : des échelons qui travaillent la restauration collective publique.
Et derrière ces échelons, la proposition politique est de travailler à une confédération de démocraties alimentaires. Partir des groupes locaux d’alimentation durable à l’échelle des bassins de vie, quitte à ce que ces groupes se regroupent pour former une caisse de sécurité sociale.
Il s’agit d’éviter de reproduire le modèle de la démocratie représentative qui favorise la prise de pouvoir par les groupes dominants habituels. Autrement, cela continuera d’exclure les familles à petit budget, les femmes, et laissera la parole aux représentants traditionnels.
Dans les groupes dans lesquels on travaille, certaines jeunes femmes ont proposé un “double système” basé sur le bassin de vie avec des propositions de vie démocratique varié, qui ne se limitent pas au tirage au sort, et basé sur des groupes spécifiques non mixtes.
Il y a aussi les voix des enfants et adolescents à inclure, d’abord parce qu’ils seront responsables du monde de demain, et parce qu’il y a un gros enjeu de reconnexion avec les mécanismes de la démocratie collective.
En effet, l’alimentation est un sujet dont tout le monde peut se saisir, dont les adolescents et enfants qui ont peu de regard sur le choix de leur alimentation.
L’enjeu qui a là est autant l’enjeu de la transformation que celui de la transition. Si on veut réduire la consommation de viande, il faut aussi penser l’après.
II. Textes officiels
A : Conventions et traités :
Conventions et traités internationaux
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques, New York, adopté le 16 décembre 1966.
- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, New York, adopté le 16 décembre 1966.
- Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes, New York, adoptée le 18 décembre 1979.
- Convention relative aux droits de l’enfant, New York, adoptée le 20 novembre 1989.
Conventions et traités régionaux
- Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, Rome, adoptée le 4 novembre 1950.
- Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’Homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels “Protocole de San Salvador”, San Salvador, adopté le 17 novembre 1988.
B : Textes des organes onusiens
Assemblée générale des Nations unies
- AGNU, Déclaration universelle des droits de l’Homme, résolution A/RES/217.A(III), 10 décembre 1948.
- AGNU, Le droit à l’alimentation – Note du Secrétaire général, résolution A/56/210, 23 juillet 2001, 32 p.
Comités des Conventions onusiennes
- CESCR, Le droit à une nourriture suffisante (art. 11), observation générale n°12, 1999, E/C.12/1999/5, 10 p.
Autres entités du système onusien
- FAO, Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale, Rome, 13 novembre 1996.
- Rapporteuse spéciale sur le droit à l’alimentation, Réflexion analytique sur les systèmes alimentaires, les crises alimentaires et l’avenir du droit à l’alimentation, rapport, 21 janvier 2020, A/HRC/43/44, 23 p.
III : Bibliographie
A : Ouvrages et manuels
- I. ALVAREZ VISPO, L. MICHELE et A. R. SABANGAN, Rapport sur l’état du droit à l’alimentation et à la nutrition, Réseau mondial pour le droit à l’alimentation et à la nutrition, juillet 2021, 45 p.
- Thivet, Delphine. « Chapitre 9. La constitutionnalisation d’un droit à l’alimentation en Inde », Antoine Bernard de Raymond éd., Un monde sans faim. Presses de Sciences Po, 2021, 253-278 pp.
- D. PATUREL, M.-N. BERTRAND et C. DELGA, Manger, plaidoyer pour une sécurité sociale de l’alimentation, Paris, Arcane17, 2020, 127 p.
- D. PATUREL et P. NDIAYE (dir.), Le droit à l’alimentation durable en démocratie, Nîmes, Champ social éditions, 2020, 242 p.
B : Thèses
- B. BONZI, Faim de Droits, le don à l’épreuve des violences alimentaires, thèse soutenue le 18 juin 2019 à l’EHESS.
- B. CLEMENCEAU, Le droit à l’alimentation, thèse soutenue le 2 septembre 2020 à l’Université Paris-Est-Créteil.
C : Articles
- P.-E. BOUILLOT, « L’absence de considérations du droit à l’alimentation dans la construction du droit de l’alimentation », Droit et société, vol. 101, n° 1, 2019, pp. 53-69.
- C. NIVARD, “Le droit à l’alimentation”, La Revue des droits de l’Homme, 2012, n° 1, pp. 245-260.
- D. PATUREL et M. RAMEL, « Éthique du care et démocratie alimentaire : les enjeux du droit à une alimentation durable », Revue française d’éthique appliquée, vol. 4, n° 2, 2017, pp. 49-60.
- G. POISSONNIER, « Tribunal international de Monsanto : portée de l’avis consultatif », Recueil Dalloz, 2017, p. 1123.
D : Rapports
- “Un droit à la cantine scolaire pour tous les enfants”, Rapport du défenseur des droits, mai 2019.
IV : Jurisprudence
Jurisprudence régionale
Cour européenne des droits de l’Homme
- CEDH, Z et autres c. Royaume-Uni, arrêt, 10 mai 2001, requête n° 29392/95.
- CEDH, Gagiu c. Roumanie, arrêt, 24 mai 2009, requête n° 63258/00.
- CEDH, Jakobski c/ Pologne, arrêt, 7 décembre 2010, requête n° 18429/06.
- CEDH, Florea c. Roumanie, arrêt, 14 décembre 2010, requête n° 37186/03.
- CEDH, Ebedin Abi c. Turquie, 13 mars 2018, requête n° 10839/09
Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples
- CADHP, Social and Economic Rights Action Center, Center for Economic and Social Rights c. Nigeria, 13 octobre 2001, Com. 155/96.
Jurisprudence nationale
Colombie
- Cour constitutionnelle de Colombie, Acción de tutela instaurada por Abel Antonio Jaramillo y otros, 22 janvier 2004, T-025/04.
France
- Tribunal administratif de Lille, 22 mars 2017, n°1702397
Prononcés des Comité onusiens
- CCPR, Bholi Pharaka c. Népal, 15 juillet 2019, CCPR/C/126/D/2773/2016.
- CCPR, Caceres et al. c. Paraguay, 25 juillet 2019, CCPR/C/126/D/2751/2016.
- CEDAW, L.A. et al. c. Macédoine du Nord, 24 février 2020, CEDAW/C/75/D/110/2016.
- CEDAW, S.N. et E.R. c. Macédoine du Nord, 24 février 2020, CEDAW/C/75/D/107/2016.
- CRC, D.D. c. Espagne, 31 janvier 2019, CRC/C/80/D/4/2016.