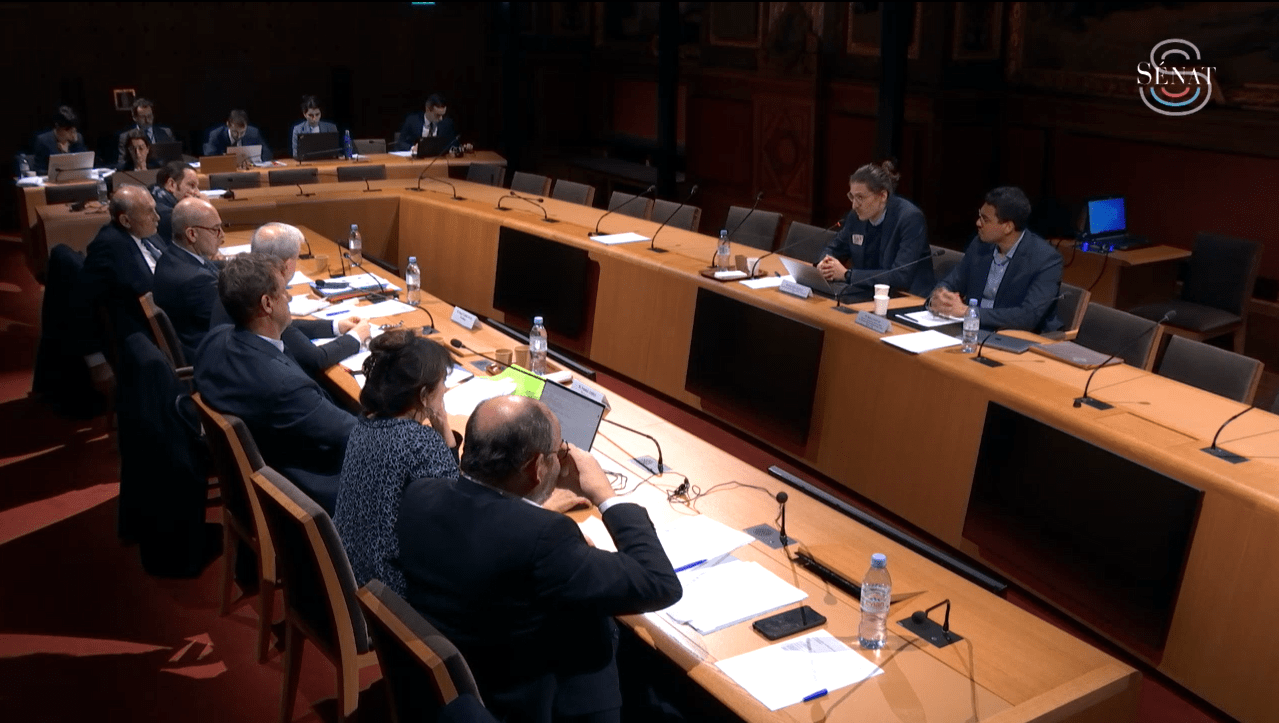Article rédigé par :
Christel Cournil* – Professeure des universités en droit public ; Membre du laboratoire LASSP, Sciences Po Toulouse, Université Toulouse Capitole ; Membre du projet ANR Proclimex.
Brice Laniyan – Docteur en droit public à l’université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) (ISJPS-UMR 8103) ; Juriste chez Notre Affaire à Tous.
Note : Reproduction strictement non commerciale, exceptionnelle autorisée à titre gracieux.
Christel Cournil, Brice Laniyan. « Notre Affaire à Tous. Les stratégies contentieuses d’une requérante au service de la justice environnementale », Revue du Droit Public, n°2, 30 juin 2025, page 31. Accessible ici : https://www.labase-lextenso.fr/revue/RDP/2025/2
Depuis une trentaine d’années en France, les ONG environnementales ont intégré le recours au droit dans leurs stratégies d’action, professionnalisant leurs pratiques jusqu’à faire de la justice une arène politique. L’association Notre Affaire à Tous incarne cette dynamique en développant des contentieux stratégiques pour influencer l’évolution du droit en faveur de la justice climatique. Par ses actions diverses, elle vise à contraindre l’État à respecter ses obligations écologiques, à stopper des projets « climaticides » et à lutter contre les inégalités socio-environnementales.
L’arme contentieuse n’a pas toujours figuré au répertoire d’actions collectives [1] des organisations non gouvernementales de protection de l’environnement (ONGE) qui ont longtemps privilégié le plaidoyer par le truchement d’actions de terrain aussi singulières que médiatiques. Depuis une trentaine d’années, les ONGE ont affiné leurs stratégies [2] en développant de nouvelles capacités d’action [3] telles que la sensibilisation du politique à la science, mais aussi des capacités d’influence dans la construction, la mise en œuvre ou le renforcement du droit de l’environnement [4] à la fois par la protestation, la persuasion, la pression et l’expertise constructive. Leurs répertoires d’action se sont enrichis en se professionnalisant [5] toujours plus, notamment face au défi de l’urgence climatique.
En France, les associations de défense de l’environnement ont bien compris la force de « l’arme du droit » [6], celle-ci devenant une énième corde à leur arc. En se diversifiant [7], leurs répertoires d’action collective se sont progressivement juridicisés et judiciarisés. Certaines ONGE ont mis en place des actions particulièrement sophistiquées en recourant au droit – moyen de contestation comme les autres. Ces associations agissent par le biais de trois fenêtres. D’abord, lors de la phase pré-normative, elles participent souvent à alerter sur un enjeu singulier et peuvent alors édifier un discours sur les besoins de droits (nouveaux droits ou modifications du droit). Ensuite, dans la phase clef de l’élaboration [8] de la norme, elles exercent une influence « discursive » en cherchant à insérer des concepts, des mots dans les textes au sein des négociations internationales [9] par la diplomatie « des couloirs » lors des COP ou lors des phases de session et débats parlementaires nationaux [10] en impactant la fabrique du droit. Enfin, en aval, les ONGE n’hésitent plus à saisir le juge pour s’assurer de l’application de la norme juridique. Aujourd’hui, « la justice comme arène » [11] est bien ancrée dans la panoplie des répertoires juridiques. Suivant le modèle popularisé par l’Affaire du Siècle et l’affaire Grande-Synthe, de nouvelles actions contentieuses « en carence structurelle » [12] sont régulièrement portées à l’appréciation des juridictions administratives sur des thématiques diverses : développement des énergies renouvelables [13], déserts médicaux [14], contrôle au faciès [15], mal-logement [16], manque de « haltes soins addictions » (ou « salles de shoot ») [17]… Et indiscutablement la construction de recours dit « stratégiques » [18] est progressivement devenue une forme de participation politique dans la cité pour certaines ONGE dont la benjamine Notre Affaire à Tous [19].
Créée en 2015, Notre Affaire à Tous est une association de protection de l’environnement qui utilise le droit comme un levier stratégique pour protéger le vivant et lutter contre la triple crise environnementale (climat-biodiversité-pollution). L’association est née d’un vide dans le paysage associatif français. Aucune association de protection de l’environnement ou de défense des droits de l’Homme ne s’était encore donnée comme raison d’être la défense de la justice climatique [20] dans sa dimension juridictionnelle. C’est pour combler ce manque, et surtout pour tenter « d’importer » en France le contentieux gagné aux Pays-Bas par la fondation Urgenda, que Marie Toussaint [21] et d’autres jeunes juristes et avocats ont créé cette structure singulière qu’est Notre Affaire à Tous. L’intention première de l’association était d’influencer la fabrique du droit en tentant d’orienter les cadres normatifs en vue d’obtenir des résultats probants pour renforcer la lutte climatique et ainsi contenir les effets délétères des changements climatiques. Et grâce à ses actions, en 10 ans d’existence, « l’activisme légal et juridictionnel » est devenu particulièrement intense en matière de justice climatique.
L’association a toutefois considérablement diversifié son répertoire d’actions juridiques depuis sa création avec des activités de contentieux et de plaidoyers menées tant au niveau local, national, européen et international ; des contributions extérieures devant le Conseil constitutionnel, des amicus curiae devant la Cour européenne des droits de l’Homme, des soumissions auprès des comités onusiens, une soumission lors de l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’Homme, un benchmark de la vigilance climatique, la mise en place d’un programme d’éducation et de sensibilisation juri- dique à travers des procès simulés… Néanmoins, l’« ADN » de Notre Affaire à Tous reste la conception de « contentieux stratégiques ». Ainsi nommés et systématisés par la doctrine anglo-saxonne, fruit d’une stratégie plurielle de plaidoyer – politique, éthique, sociale et juridique –, ce type d’actions désigne les cas dans lesquels un requérant engage une action en justice avec une ambition dépassant le cadre strict du litige. Bien que l’objet premier du contentieux soit la défense de son intérêt personnel, son objectif secondaire est de favoriser une évolution politico-juridique. Cela peut se traduire par la reconnaissance d’une illégalité, d’une réparation ou, plus largement, par l’obtention d’une nouvelle interprétation du droit, susceptible de profiter à tous [22]. Dès lors, l’avantage différentiel de l’association s’exprime, avant tout, dans l’identification et l’usage des fondements juridiques et des voies de droit qui seront les plus à même de susciter, par voie jurisprudentielle, la production d’un droit plus protecteur du vivant. Notre Affaire à Tous cherche à repousser les frontières du droit et à poser les premiers précédents juridiques. L’association est devenue, suivant l’expression de Marc Galanter, un « utilisateur fréquent du droit » [23] (repeat players) [24] qui a su développer un savoir-faire dans la conception de recours stratégiques en matière climatique et environnementale.
Nous reviendrons essentiellement sur les intentions stratégiques de l’association à porter la cause climatique et environnementale devant le juge administratif en tant que requérante de plus en plus aguerrie. L’objet de cette contribution est de proposer une systématisation des principaux objectifs contentieux portés devant le juge administratif par l’association, et ici présentés en quatre directions « tactiques ». L’association a choisi de faire préciser par le juge les obligations de com- portement de l’État en matière de lutte climatique et de biodiversité (I), de mettre fin à certains projets locaux inutiles, climaticides ou polluants (II), d’engager la sortie fossile par la diversification contentieuse (III) et, enfin, de promouvoir la lutte contre les pollutions massives locales et les inégalités socio-environnementales (IV).
I. Faire préciser les obligations de comportements étatiques en matière environnementale par le contentieux systémique
L’un des moyens de porter un plaidoyer puissant sur la justice climatique a été de contester le manque d’ambition des États devant les juges. C’est la voie que l’association Notre Affaire à Tous a choisi de prendre en France avec L’Affaire du siècle, s’inscrivant ainsi dans une tendance contentieuse mondiale [25]. En effet, la reconnaissance de la « justiciabilité » des questions climatiques impulsée par la célèbre affaire Urgenda a provoqué un effet d’entraînement avec l’émergence d’environ une centaine d’actions dirigées contre des pouvoirs publics [26] dans le monde.
Dans ce type de contentieux, les juges considèrent que la prise de décision en matière climatique relève en principe du pouvoir politique, lequel détient une légitimité électorale et bénéficie d’une marge d’appréciation variable dans la définition des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ainsi que dans le choix des moyens concrets pour les atteindre [27]. Comme le rappelle la Cour européenne des droits de l’Homme dans Klimaseniorinnen, cette sphère d’action du pouvoir politique doit cependant s’exprimer dans les limites de l’État de droit [28], lesquelles sont souvent définies ou précisées par voie jurisprudentielle. En redéfinissant les relations normatives entre les différents pouvoirs dans le cadre de ces litiges, le juge s’affirme comme un acteur stratégique qui – disposant de son propre agenda – est susceptible de répondre aux exigences de justice climatique et sociale exprimées par la société civile. Le juge et le procès deviennent les moyens par lesquels la société civile s’intègre à la gouvernance climatique, contestant ainsi les politiques d’un gouvernement ou les décisions stratégiques d’une entreprise. C’est dans cette perspective stratégique [29] que Notre Affaire à Tous, accompagnée de trois autres associations (la Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France et Oxfam France), a saisi en 2019 le tribunal administratif (TA) de Paris en initiant L’Affaire du siècle [30].
L’ambition politico-juridique des associations requérantes était de faire reconnaître l’insuffisance des actions de l’État en matière climatique et d’obtenir du juge qu’il lui enjoigne de prendre toutes mesures utiles pour réduire les émissions de GES à un niveau compatible avec le maintien du réchauffement planétaire en deçà de l’objectif de température fixé par l’accord de Paris. L’ambition contentieuse du recours était de trouver un fondement juridique contraignant à l’action de l’État en matière de lutte climatique et « climatiser » la responsabilité administrative [31]. Il s’agissait de faire imputer à l’État le dommage lié au surplus fautif d’émissions de GES consécutif au dépassement du premier budget-carbone couvrant la période 2015-2018 et de le considérer à l’origine d’un préjudice objectif causé à l’environnement et d’un préjudice moral causé aux associations. Pour ce faire, Notre Affaire à Tous et les autres associations de l’Affaire du siècle ont développé une double stratégie contentieuse en intervenant dans un autre contentieux climatique – concomitant et très similaire – mené devant le Conseil d’État par la ville de Grande-Synthe et son ancien maire Damien Carême (affaire Grande- Synthe [32]). L’objectif pour les associations étant de dupliquer dans un recours pour excès de pouvoir l’argumentaire juridique relatif à la reconnaissance d’une obligation étatique de comportement en matière de lutte climatique.
Rendu moins de trois mois après le premier arrêt Grande-Synthe du Conseil d’État reconnaissant implicitement une obligation contraignant à l’action de l’État en matière de lutte climatique, le premier jugement de l’Affaire du siècle avant- dire droit du 3 février 2021 [33] du TA de Paris a fait nettement avancer l’idée de justice climatique défendue par Notre Affaire à Tous. Le tribunal y consacre explicitement une obligation générale de lutte contre le changement climatique [34]. Celle-ci permettant aussi au juge de constater l’existence d’un dommage environnemental [35] résultant du surplus d’émissions de GES autorisé par la loi qu’il impute à l’inaction de l’État. Le jugement reconnaît alors une faute de l’État et indemnise le préjudice moral des associations à hauteur d’un euro. Il admet de surcroît la recevabilité des demandes en indemnisation du préjudice écologique tout en précisant pour la première fois, devant le juge administratif, les conditions dans lesquelles il pourra être invoqué et réparé, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles actions. Si le tribunal refuse néanmoins l’indemnisation financière d’un euro symbolique, la stratégie contentieuse des associations requérantes consistait à utiliser cette demande d’indemnisation du préjudice écologique comme le moyen d’obtenir une injonction réparatrice. L’idée était donc de réparer et de faire cesser le préjudice écologique par l’obtention de « mesures supplémentaires », dans l’esprit de l’article 1252 du Code civil [36].
Le second jugement du 14 octobre 2021 [37] imposa un calendrier d’exécution aux ministres compétents pour prendre, avant le 31 décembre 2022, toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique et à prévenir l’aggravation des dommages au titre du surplus fautif de 15 Mt CO2eq. Non contentes des actions étatiques initiées dans le laps laissé par le juge, telles des vigies de l’action gouvernementale, les associations ont engagé un nouveau contentieux inédit : celui du suivi de l’exécution de l’action climatique. Toutefois, par un jugement du 22 décembre 2023 [38], le juge de l’exécution du TA de Paris a refusé de prononcer les mesures d’exécution supplémentaires demandées par les requérantes, alors même que la réparation du préjudice restant n’a pas été jugée complète avec un reliquat compris entre 3 et 5 Mt CO2eq. La quantification du préjudice écologique demeure une opération difficile qui a été enfermée dans l’approche arithmétique choisie par le tribunal en 2021 et de laquelle il ne peut sortir dans son office limité du suivi de l’exécution. C’est désormais la cour d’appel de Paris (après le refus de compétence du Conseil d’État en décembre 2024 [39]) qui tranchera les ultimes demandes des associations, notamment leur demande d’astreintes d’un montant total d’1 milliard et 102,5 millions d’euros correspondant au coût social du carbone. C’est au prix d’une longue bataille juridique de plus de six années que la coalition de l’Affaire du Siècle est parvenue à faire constater l’inaction climatique par un juge, a contribué à la « climatisation » du droit de la responsabilité administrative et à faire « pression » sur l’État pour que celui-ci mette son pouvoir de réglementation au service de la cause climatique.
Forte de cette expérience résultant de savoir-faire de juristes et experts [40] dans ce contentieux climatique complexe, l’association Notre Affaire à Tous a très vite capitalisé [41] cet acquis en reprenant, avec quatre autres organisations (Pollinis, Association nationale pour la protection des eaux et rivières (ANPER-TOS), Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et Biodiversité sous nos pieds), les mêmes lignes stratégiques pour engager la première action en justice au monde en carence fautive contre un État pour son inaction face à l’effondrement de la biodiversité (L’Affaire justice pour le Vivant [42]). L’objectif est semblable : faire reconnaître une obligation de comportement en matière de protection du vivant, l’existence d’un préjudice écologique résultant d’une contamination généralisée de l’eau, des sols et de l’air par les pesticides et la faute de l’État. Les associations ont ici aussi obtenu gain de cause [43] puisque le TA de Paris reconnaît des lacunes dans les procédures d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des pesticides, mises en évidence par les associations, et considère que ces manquements relèvent de la responsabilité de l’État. Il établit un lien de causalité direct entre les insuffisances dans l’évaluation des risques et le déclin de la biodiversité. Et concernant l’injonction, le tribunal impose à l’État un délai pour mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de respecter les objectifs de réduction des pesticides fixés par les plans Ecophyto. Non satisfaites sur leurs demandes tendant à revoir les méthodologies d’évaluation des risques liés aux pesticides, contrairement à ce que préconisait d’ailleurs la rapporteure publique, les associations ont fait appel en 2024 et s’engageront sans aucun doute dans un nouveau contentieux du suivi de l’exécution du jugement inédit de 2023.
II. Mettre fin aux projets locaux « climaticides », inutiles ou polluants
Partout dans le monde, la contestation de projets d’ouvrages publics ou privés ayant un impact important sur la soutenabilité du système climatique s’est peu à peu développée, attestant d’une diversification des procès climatiques. La construction d’un oléoduc [44] entre le Canada et les États-Unis, l’extension d’un aéroport en Autriche [45] ou au Royaume-Uni [46], l’ouverture de mines de charbon à ciel ouvert en Nouvelle-Galles du Sud en Australie [47] ou encore d’une centrale thermique à charbon à Lephalale en Afrique du Sud [48] ont été portées à l’appréciation de juges nationaux. Cette tendance à contester les projets dits « climaticides » va sans doute s’intensifier dans les prochaines années, y compris en France ; ce qui n’a pas échappé à l’association Notre Affaire à Tous qui en a fait un axe stratégique.
Dans un premier temps, Notre Affaire à Tous s’est s’associée à d’autres organisations non gouvernementales et « influenceurs » [49] pour lancer un projet citoyen intitulé SuperLocal [50], qui a eu pour fonction de mettre en réseau des luttes locales contre toutes sortes de projets polluants en France [51]. Si cette campagne a été médiatique et a développé une forme singulière de mobilisations sociales et environnementales en fédérant des collectifs de riverains, elle a ensuite permis à Notre Affaire à Tous d’identifier des projets locaux permettant d’être contestés devant le juge administratif sur la base d’un argumentaire défendant la soutenabilité du système climatique. Il s’agit pour elle de porter l’attention du juge sur la nécessité pour les autorités locales d’adopter une « lecture climatique » des décisions locales d’urbanisme et d’amener ces dernières à une progressive « climatisation du droit de l’urbanisme » dans les différents documents territoriaux (schéma de cohérence territoriale (SCOT), plan local d’urbanisme, permis de construire, etc.). De surcroît, l’ambition est d’inciter les porteurs de projets à réaliser des études d’impacts plus four- nies intégrant pleinement les impacts négatifs au regard d’une des neuf limites planétaires. Dès lors, aux côtés de l’Association contre l’allongement de la piste de l’aéroport Caen-Carpiquet, Notre Affaire à Tous a déposé en 2019 un recours gracieux et un recours pour excès de pouvoir afin d’annuler le SCOT de Caen métropole permettant l’extension du site. De la même façon, l’association a soutenu [52] un recours contre un projet d’agrandissement du centre commercial ou est venue en appui d’un recours visant au retrait d’un permis de construire sur un projet local (projet Tropicalia). En mai 2020, 14 associations déposaient, aux côtés de Notre Affaire à Tous, un recours demandant l’annulation du SCOT de Roissy définissant l’aménagement du territoire de Roissy Pays de France qui visait à la fois l’urbanisation du Triangle de Gonesse et l’aménagement d’un terminal 4 à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle. En 2021, le gouvernement demandait au groupe ADP d’abandonner ce projet d’extension et de lui en présenter un nouveau, plus cohérent avec les objectifs de lutte climatique et de protection de l’environnement.
Plus récemment, à propos du projet d’autoroute A69 et à l’initiative du collectif La Voie Est Libre, l’association Notre Affaire à Tous et 13 autres associations sont intervenues devant le TA de Toulouse dans ce dossier sensible, initié en mai 2023. Elles souhaitaient appuyer un argumentaire sur les enjeux de démocratie environnementale dans la procédure d’autorisation de ce type de grands projets d’infrastructures. Les associations estimaient que les travaux de la liaison autoroutière Castres-Toulouse avaient débuté en l’absence d’études sérieuses par l’État et d’alternatives routières et ferroviaires mettant à mal tout le processus décisionnel. Sur le fond du dossier, alors que le rapporteur public s’était prononcé en faveur de l’annulation totale de l’autorisation environnementale du projet et a confirmé l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), le TA de Toulouse [53] a (chose rare) rouvert l’instruction du dossier sur un fait « nouveau » mentionné par l’État dans sa note en délibéré. L’État a immédiatement fait appel de cette décision tout en obtenant de la cour administrative d’appel de Toulouse [54], l’autorisation de reprendre les travaux en attendant l’issue de cette action en justice. Ce dossier est loin d’être clos et atteste surtout d’une stratégie de contestation contentieuse collective qui cible localement les projets inutiles, climaticides ou polluants ou encore, dernièrement, les décrets qui encouragent le détricotage du droit de l’environnement, connu aussi sous le nom de « greenbackslash réglementaire ». En ce sens, Notre Affaire à Tous et l’association Zero Waste France ont initié un triple recours gracieux et contentieux [55] demandant notamment l’annulation des décrets d’application de la loi relative à l’Industrie verte ; des décrets publiés [56] entre les deux tours des législatives. Les associations estimant que le principe du pollueur-payeur et le principe de non-régression sont mis à mal et que la protection des espèces sera fragilisée avec l’introduction de la possibilité de reconnaître de manière anticipée l’existence d’une RIIPM de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées. Récemment, Notre Affaire à Tous a réalisé une intervention volontaire dans le cadre d’une demande de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) présentée lors d’un recours pour excès de pouvoir introduit par l’association Préservons la forêt des Colettes à l’encontre du décret du 5 juillet 2024 [57] qualifiant d’intérêt national majeur le projet d’extraction et de transformation de lithium par la société Imérys dans l’Allier. La QPC a été transmise avec succès par le Conseil d’État [58] au Conseil constitutionnel pour juger de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 411-2-1 du Code de l’environnement (RIIPM). Toutefois, dans sa décision du 5 mars 2025 [59], ce dernier n’a reconnu aucune inconstitutionnalité.
III. Engager la « sortie fossile » par la diversification contentieuse
Face à l’inertie des États sur la « sortie fossile », la lenteur et les vicissitudes de la coopération internationale, les engagements volontaires insuffisants et non respectés des entreprises les plus émettrices, notamment les Carbon majors, des ONGE ont choisi – non sans difficulté – des voies secondaires en convoquant les juges nationaux pour responsabiliser certains acteurs privés systémiques. L’objectif avoué de ces actions stratégiques est de contraindre les entreprises les plus émettrices à réorienter leurs stratégies d’entreprises vers la décarbonation de l’économie et la sortie des énergies fossiles. Il est attendu de ces acteurs privés systémiques qu’ils fassent leur part dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris et contribuent au maintien de l’augmentation de la température moyenne à 1,5 °C. Pour les ONGE, cela passe par la reconnaissance par voie jurisprudentielle d’obligations de comportement en direction des acteurs privés ; des obligations de comportement directement inspirées de celles appliquées à l’État dans les contentieux du type L’Affaire du siècle et l’affaire Grande-Synthe. Participant à cette dynamique contentieuse naissante en Europe, Notre Affaire à Tous s’est alors tournée vers le juge judiciaire. En s’appuyant notamment sur la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance et l’article 1252 du Code civil, l’association a assigné TotalEnergies [60] et la banque BNP Paribas [61] pour manquement à leur devoir de vigilance climatique, avec l’ambition que ces deux multinationales cessent de participer au développement de nouvelles capacités de pétrole et de gaz. Notre Affaire à Tous souhaite ainsi défendre une « ligne de crête » stratégique essentielle : celle d’étendre les obligations pesant sur les États en direction d’acteurs économiques [62]. Le but est de faire jouer l’effet horizontal des droits fondamentaux dans les contentieux climatiques visant les acteurs non étatiques. Il s’agit de surcroît de capitaliser et étendre les acquis des décisions rendues par le juge administratif devant le juge judiciaire.
D’autres types de contentieux [63] visant à l’opérationnalisation de la « sortie fossile » émergent devant le juge administratif avec pour ambition d’annuler ou de revoir à la baisse toutes nouvelles exploitations de combustibles fossiles jugées « climaticides ». Le Conseil d’État a réalisé une interprétation décisive qui a inscrit clairement l’amorce de la « sortie fossile » dans le cas de délivrance de nouveaux permis de recherche d’hydrocarbures depuis la loi Hulot. La société d’extraction pétrolière European Gas Limited – qui s’était vu refuser en 2017 un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dits « permis Bleue Lorraine Nord » par la ministre de l’Environnement – a entamé un long contentieux [64] qu’elle vient de perdre. Le Conseil d’État a confirmé [65] que l’Administration pouvait refuser un permis de recherche d’hydrocarbures et cette interprétation a entraîné des conséquences sur une des dernières demandes de forage déposées en France, notamment celle sur la commune de La Teste-de-Buch par la société canadienne Vermillion Energy qui s’est vue refuser par le Préfet de Gironde le 6 juin 2025, la possibilité de creuser huit nouveaux puits pétroliers sur son site du Cazeaux. Dans ce contexte, Notre Affaire à Tous a souhaité intervenir dans un contentieux en cours devant le juge administratif visant justement à l’extension d’un forage pétrolier. En janvier 2024, la préfecture de Seine-et-Marne avait accordé à la compagnie pétrolière Bridge Énergies l’autorisation de forer deux nouveaux puits de pétrole à Nonville. La régie municipale Eau de Paris et la Ville de Paris ont alerté du risque de pollution des nappes phréatiques par des hydrocarbures. Opposées au projet, elles ont déposé un recours visant à annuler le décret autorisant ces nouveaux puits. Notre Affaire à Tous et plusieurs ONGE (Les Amis de la Terre France, France Nature Environnement Île-de-France et Seine-et-Marne, Reclaim Finance et le Réseau Action Climat) ont usé, ici encore, de la procédure de l’intervention volontaire en soutien de ce recours. La stratégie contentieuse étant d’apporter au juge des fondements juridiques complémentaires permettant de dénoncer l’argument de la captation des émissions de carbone avancé par Bridge Energies pour vanter la prétendue neutralité carbone de son projet ; technologie jugée par le collectif ONGE comme non-maîtrisée et très coûteuse. Notre Affaire à Tous a souhaité mobiliser un argumentaire inédit mettant en lumière l’impact que ce nouveau projet pétrolier a et aura dans le temps long sur les générations futures. La Cour européenne de Strasbourg [66], la Cour constitutionnelle allemande [67], le juge administratif [68] comme le Conseil constitutionnel [69] commençant à y être sensibles dans de récentes décisions. De surcroît, l’idée des associations est de défendre in fine que l’interdiction de tout nouveau forage découle de l’obligation étatique de lutte climatique [70] (ici l’obligation de garantir la « sortie fossile ») qui pèse sur l’État français au nom de ces engagements internationaux et du respect des droits de l’Homme, y compris dans une lecture intergénérationnelle. L’État devant faire sa juste part (fair share) [71] de la lutte climatique en interdisant sur son territoire tout « projet climaticide ».
IV. Promouvoir la lutte contre les pollutions massives locales et les inégalités socio-environnementales
À l’aide d’un riche maillage associatif et de riverains impactés par des pollutions diffuses, Notre Affaire à Tous a diversifié sa stratégie d’activisme juridictionnel. Les contentieux liés aux per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont symptomatiques de cette évolution. L’enquête journalistique du Forever Pollution Project identifiait en 2024 plus de 900 sites pollués par les PFAS en France [72]. Cette contamination d’ampleur – que la chercheuse Lieselot Bisschop n’hésite pas à qualifier de « crime industriel facilité par l’État » (state-facilitated corporate crime) [73] – s’explique par les insuffisances du régime légal encadrant ces substances qui repose sur une approche fragmentée traitant chaque molécule de manière isolée et continuellement en décalage des avancées scientifiques. La pollution du sud de la métropole lyonnaise et de sa zone industrielle a donné lieu à un contentieux inédit de santé environnementale prénommé l’affaire Vallée de la chimie [74], initié notamment par Notre Affaire à Tous et son groupe local de Lyon en 2023. La procédure du « référé pénal environnemental » prévue à l’article L. 216-13 du Code de l’environnement a d’abord été choisie et testée, sans résultat probant devant le juge judiciaire. L’association s’est ensuite constituée partie civile aux côtés de 6 autres associations et 34 victimes dans la procédure pénale. Puis, à la suite de l’autorisation d’une nouvelle unité de production de la société Daikin par les autorités préfectorales en février 2024, Notre Affaire à Tous est intervenue cette fois dans la procédure initiée par l’association Bien-Vivre-à-Pierre-Bénite et le collectif d’habitant·e·s PFAS contre Terre devant le juge administratif, en appuyant l’argumentaire du référé-suspension de l’arrêté contesté. Si le TA de Lyon a émis un jugement favorable aux riverains conta- minés qui a conduit à la suspension de l’activité de Daikin en juin 2024, le juge des référés a précisé que l’extension autorisée étant substantielle, il y avait lieu de la soumettre à autorisation environnementale et donc à une évaluation environnementale. La publication d’un nouvel arrêté préfectoral complémentaire en octobre 2024 a néanmoins acté la reprise de l’extension de l’activité de Daikin [75]. Enfin, l’étape prochaine est d’impulser une dynamique contentieuse collective (action collective) pour les « victimes de masse » en tentant d’obtenir réparation des préjudices des riverains du Site de Pierre-Bénite, du plus gros hot spot français de contamination de PFAS [76]. Si l’activisme juridictionnel en matière de PFAS n’a pas encore apporté de résultats performatifs sur le plan du contentieux administratif et judiciaire, la médiatisation de ces actions a suscité une prise de conscience du grand public, mais surtout de l’exécutif (Plan d’action ministériel sur les PFAS 2023-2027) et du travail parlementaire [77].
Enfin, l’un des plus récents axes stratégiques de Notre Affaire à Tous consiste à lutter contre les inégalités socio-environnementales encore invisibilisées en France à la différence d’autres pays, dont les États-Unis qui ont construit une justice environnementale à travers une série de procès menés par/pour des minorités raciales ou des populations précaires impactées par des graves pollutions [78]. C’est donc par le détour de la défense de l’accès à l’eau des Mahorais qu’une action contentieuse a été initiée en 2023, par Notre Affaire à Tous, l’association Mayotte a soif ainsi que 15 victimes mahoraises, sous la forme d’un référé-liberté et sur la base d’un argumentaire périphérique, néanmoins inédit de « discrimination environnementale » [79]. Le TA de Mayotte [80] puis le Conseil d’État [81] n’y ont toutefois pas été réceptifs ; ce dernier ayant rejeté en décembre 2023 la requête des associations qui demandaient au préfet de Mayotte de déclencher le plan ORSEC « eau potable » et de mettre en place un plan d’urgence sanitaire pour faire face à la crise de l’eau, estimant ainsi que les mesures prises par l’État étaient suffisantes pour répondre à la situation. Sur cette même question, l’action de Notre Affaire à Tous se déploie désormais à l’international avec une « plainte » déposée auprès de rapporteurs spéciaux dans le cadre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’Homme. Dans cette même dynamique socio-environnementale, l’association Notre Affaire à Tous, au sein du collectif L’Affaire du Siècle et aux côtés de sinistrés [82], a déposé tout récemment un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État. Ce recours vise à dénoncer la carence structurelle des pouvoirs publics dans la planification de l’adaptation au changement climatique, notamment à travers le troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-3). Les requérants, directement touchés par des inégalités sociales, environnementales et territoriales, subissent des situations dramatiques : refus d’indemnisation de la part des assureurs, conditions de vie insalubres dans des logements devenus inhabitables lors des vagues de chaleur, ou encore dégradations liées au retrait-gonflement des argiles (RGA) ou aux inondations. Ce recours stratégique revêt une portée systémique. Il entend faire reconnaître le manquement des autorités à leur obligation d’adaptation au changement climatique, fondée à la fois sur le droit climatique et les droits fondamentaux, et demande en conséquence la correction du dispositif existant.
Conclusion
La diversité des répertoires d’action juridique de la requérante Notre Affaire à Tous témoigne d’une forte capacité d’initiatives contentieuses et débouche sur des succès comme des échecs illustrant un apprentissage continu qui stimule en retour son activisme juridictionnel. Sur le fond, la forte politisation des argumentaires juridiques mobilisés dessine plusieurs « lignes de crêtes » défendues dans ces actions contentieuses aux véhicules procéduraux variés (recours indemnitaire, recours pour excès de pouvoir, intervention volontaire, référé liberté, référé pénal environnemental, assignation, etc.). L’association semble ainsi œuvrer – à sa manière – à amorcer en France un « contentieux de la juste transition » socio-écologique déjà identifié et théorisé [83] ailleurs dans le monde.
Notes
*NDA : L’autrice précise son implication dans l’association depuis 2017 ; elle y est administratrice depuis 2019.
[1] Au sens de Charles Tilly qui a théorisé sur le répertoire d’action collective dans le cadre des mobilisations contestataires.
[2] N. Berny, Défendre la cause de l’environnement. Une approche organisationnelle, 2019, PU Rennes, Res Publica.
[3] J.-F. Morin et A. Orsini, Politique internationale de l’environnement, 2015, Presses de Sciences Po.
[4] S. Lavallée, « Les organisations non gouvernementales, catalyseurs et vigiles de la protection internationale de l’environnement ? », in É. Canal-Forgues (dir.), Démocratie et diplomatie environnementales – Acteurs et processus en droit international, 2015, Pedone, p. 65 à 94.
[5] S. Ollitrault, « Les ONG, des outsiders centraux des négociations climatiques ? », Revue internationale et stratégique 2018, vol. 109, n° 1, p. 135 à 143.
[6] L. Israël, L’arme du droit, 2020, Presses de Sciences Po.
[7] S. Ollitrault, Militer pour la planète : sociologie des écologistes, 2008, PU Rennes.
[8] J.Olivier, « Les nouveaux acteurs du droit de l’environnement. Le rôle de l’UICN dans l’élaboration du droit de l’environnement », RJE 2005, n° 3, p. 274 à 296.
[9] M. Betsill et E. Corell, « NGO influence in international environmental negotiations : a framework for analysis », Global environmental politics 2001, vol. 1, n° 4, p. 65 à 85.
[10] R. Léost et M. Piederrière, « La contribution de France Nature Environnement à l’élaboration de la loi Grenelle 2 », RJE 2010, vol. 5, n° spécial, p. 13. V. RAC, travail sur le projet de la loi française Climat résilience, 2021 ; RAC, « Le climatomètre », sur le suivi parlementaire : https://climatometre.org/
[11] L. Israël, L’arme du droit, 2020, Presses Sciences Po, p. 73.
[12] A. Goin et L. Cadin, « Le juge ne peut pas tout », AJDA 2023, p. 2105.
[13] CE, 6 nov. 2024, n° 471039, Sté Éolise : Lebon.
[14] « L’UFC-Que Choisir attaque l’État pour inaction : déserts médicaux », Le Monde, 21 nov. 2023.
[15] CE, 11 oct. 2023, n° 454836, Amnesty International France et a. : Lebon.
[16] « L’État attaqué en justice pour non-respect des lois sur l’hébergement des sans-abris et le logement opposable », Le Monde, 13 févr. 2025.
[17] « Salles de shoot : l’État attaqué en justice pour son “inaction” concernant l’avenir du dispositif », Le Monde, 14 avr. 2025.
[18] C. Cournil et A. S. Denolle (dir.), Le droit : une arme au service du vivant ? Plaidoyers et contentieux stratégiques, 2024, Pedone.
[19] Pour une présentation plus complète de l’association, v. C. Cournil, « Notre affaire à tous et l’arme du droit. Le combat d’une ONG pour la justice climatique », in V. de Boillet et a. (dir.), Environnement, climat. Principes, droits et justiciabilité, 2024, Helbing Lichtenhahn Verlag, p. 171 à 197.
[20] L. Laigle, « Justice climatique et mobilisations environnementales », VertigO, mars 2019, vol. 19, n° 1, https://doi.org/10.4000/vertigo.24107.
[21] Marie Toussaint est militante écologiste, juriste de l’environnement et, depuis mai 2019, députée européenne sur la liste Europe Écologie Les Verts.
[22] V. Lefebve, « Le “contentieux stratégique” entre logiques instrumentale et émancipatrice. Réflexions à partir de quelques évolutions jurisprudentielles récentes dans le domaine de la lutte contre la pauvreté », Working Paper 2019, cité in J. Ringelheim et V. Van Der Plancke, « Contentieux stratégique et mobilisations judiciaires. L’action en justice comme forme de participation politique ? », in A. Bailleux et M. Messiaen (dir.), À qui profite le droit ? Le droit, marchandise et bien commun, 2020, Anthemis, p. 193 à 220.
[23] Cette traduction est de Diane Roman, La cause des droits, 2022, Dalloz.
[24] M. Galanter, « Why the “Haves” Come Out Ahead : Speculations on the Limits of Legal Changes », Law and Society Review 1974, 9 (1), p. 95 à 160 (trad. « Pourquoi c’est toujours les mêmes qui s’en sortent bien ? : réflexions sur les limites de la transformation par le droit », Droit et société 2013/3, n° 85, p. 575 à 640).
[25] C. Cournil et L. Varison (dir.), Les procès climatiques : du national à l’international, 2018, Pedone ; C. Cournil, Les grandes affaires climatiques, Confluence des droits, 2020, DICE.
[26] 81 actions dirigées contre des pouvoirs publics en 2022. J. Setzer et C. Higham, « Global Trends in Climate Change Litigation : 2023 Snapshot », Grantham Research Institute 2023, p. 3, n° 5. V. aussi C. Higham, J. Setzer et E. Bradeen, « Challenging government responses to climate change through framework litigation », Grantham Research Institute 2022, p. 16.
[27] CEDH, 9 avr. 2024, n° 53600/20, VereinKlimaseniorinnen Schweiz et a. c/ Suisse, § 543.
[28] CEDH, 9 avr. 2024, n° 53600/20, § 412.
[29] B. Laniyan, « Perspective et méthodologie de Notre Affaire À Tous dans l’élaboration de recours climatiques stratégiques », in C. Cournil et A.-S. Denolle (dir.), Le droit : une arme au service du vivant ? Plaidoyers et contentieux stratégiques, 2024, Pedone, p. 221 à 240.
[30] C. Cournil et M. Fleury, « De “l’Affaire du siècle” au “casse du siècle” ? », La Revue des droits de l’Homme, actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 7 févr. 2021.
[31] C. Cournil et M. Fleury, « De “l’Affaire du siècle” au “casse du siècle” ? », La Revue des droits de l’Homme, actualités Droits-Libertés, https://doi.org/10.4000/ revdh.11141, mis en ligne le 7 févr. 2021.
[32] CE, 19 nov. 2020, n° 427301, Cne Grande-Synthe : Lebon, p. 406 – CE, 1er juill. 2021, n° 427301, Cne Grande-Synthe : Lebon, p. 201, concl. S. Hoynck – CE, 10 mai 2023, n° 467982, Cne Grande-Synthe et a. : H. Delzangles, « Le premier “recours climatique” en France : une affaire à suivre ! », AJDA 2021, p. 217 ; R. Radiguet, « Objectif de réduction des émissions de gaz… à effet normatif ? », JCP A 2020, 2337 ; C. Huglo, « L’obligation climatique en France et l’affaire de Grande-Synthe », EEI mars 2021, n° 3, dossier 12.
[33] TA de Paris, 3 févr. 2021, nos 1904967, 1904968, 1904972 et 1904976, Assoc. Oxfam France et a.
[34] C. Cournil et M. Fleury, « De “l’Affaire du siècle” au “casse du siècle” ? », La Revue des droits de l’Homme, actualités Droits-Libertés, https://doi.org/10.4000/ revdh.11141, mis en ligne le 7 févr. 2021.
[35] Cons. 16.
[36] « Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par une personne mentionnée à l’article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage ».
[37] TA de Paris, 14 oct. 2021, nos 1904967, 1904968, 1904972 et 1904976, Assoc. Oxfam France et a.
[38] TA de Paris, 22 déc. 2023, n° 2321828/4-1, Assoc. Oxfam France et a.
[39] CE, 13 déc. 2024, n° 492030.
[40] C. Cournil, « Experts et expertises au sein des procès climatiques : objectiver, prouver, convaincre », in C. Cournil (dir.), Expertises et argumentaires juridiques. Contribution à l’étude des procès climatiques, Confluence des droits, Aix-en- Provence, 2024, DICE, p. 107 à 130, en ligne : https://books.openedition.org/ dice/17372.
[41] A.-S. Denolle, « Le recours “biodiversité – Justice pour le Vivant”, prolonger les premiers contentieux climatiques français », in C. Cournil (dir.), Expertises et argumentaires juridiques. Contribution à l’étude des procès climatiques, Confluence des droits, Aix-en-Provence, 2024, DICE, p. 269 à 283.
[42] https://lext.so/m6_p72.
[43] TA Paris, 29 juin 2023, n° 2200534/4-1, Notre Affaire À Tous, Pollinis, Assoc. Biodiversité sous nos pieds, ANPER-TOS et ASPAS.
[44] Indigenous Environmental Network c/ US Department of State, 2018-2019.
[45] TA fédéral autrichien, 2 févr. 2017, n° W109 2000179-1/291E, Vienna-Schwechat Airport Expansion. C. const. autrichienne, 29 juin 2017, nos E 875/2017-32 et E 886/2017-31, Vienna Schwechat Airport expansion.
[46] CA Angleterre, 27 févr. 2020, n° C1/2019/1053 (rejet de l’agrandissement de l’aéroport de London-Heathrow).
[47] T. des affaires foncières et environnementales de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, 8 févr. 2019, Gloucester Resources Limited c/ Minister for Planning (rejet de l’autorisation d’exploitation d’une mine de charbon).
[48] High Court of South Africa, 8 mars 2017, n° 65662/16, Earthlife Africa Johannesburg c/ Ministre des affaires environnementales et a.
[49] Le mouvement et la chaîne YouTube Partager C’est Sympa.
[50] Campagne Superlocal : https://lext.so/u9bm0A.
[51] Extensions d’aéroports, nouveaux centres commerciaux, fermes usines, autoroutes, complexes touristiques, fermetures de petites lignes de train et de services publics, etc.
[52] Soutien au recours porté par les associations Alternatiba Rosny, Bondy Écologie, Le Sens de l’Humus, Murs à Pêches-Map et le MNLE 93 Nord Est Parisien contre le projet d’extension du centre commercial Rosny 2 en mars 2020.
[53] TA Toulouse, 27 févr. 2025, nos 2303544, 2304976 et 2305322.
[54] CAA Toulouse, 4e ch., 28 mai 2025, n° 25TL00597 – CAA Toulouse, 4e ch., 28 mai 2025, n° 25TL00642 – CAA Toulouse, 4e ch., 28 mai 2025, n° 25TL00653.
[55] Recours déposé le 7 janvier 2024.
[56] D. n° 2024-708, 5 juill. 2024 – D. n° 2024-742, 6 juill. 2024 – D. n° 2024-704, 5 juill. 2024.
[57] D. n° 2024-740, 5 juill. 2024.
[58] CE, 9 déc. 2024, n° 497567.
[59] Cons. const., QPC, 5 mars 2025, n° 2024-1126.
[60] L’affaire TotalEnergies-Climat : TJ Paris, 6 juill. 2023, n° 22/03403 – CA Paris, 5-12, 18 juin 2024, n° 23/14348 – CA Paris, 18 juin 2024, n° 21/22319 – CA Paris, 18 juin 2024, n° 23/10583 : Dalloz actualité, 1er juill. 2024, obs. A.-M. Ilcheva ; Dalloz actualité, 21 juin 2024, obs. A. Stevignon et B. Laniyan.
[61] Trois associations (Notre Affaire À Tous, Les Amis de la Terre France et Oxfam France) ont mis en demeure, le 26 octobre 2022, puis assigné, le 23 février 2023, le groupe BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de la loi relative au devoir de vigilance et d’autres dispositions du Code civil (l’af- faire BNP). Ce recours a, par ailleurs, inspiré une nouvelle action aux Pays-Bas où Milieudefensie a mis en demeure la Banque ING de se conformer à son devoir de diligence climatique. B. Laniyan, « La mise en demeure de la Banque ING par Milieudefensie, prémisse d’un nouveau contentieux climatique », La Revue des droits de l’Homme, actualités Droits-Libertés, 2 avr. 2024.
[62] Ce type de contentieux climatique contre les entreprises, notamment le plus emblématique d’entre eux opposant l’ONGE Milieudefensie à Shell, a directement inspiré la création de l’article 22 de la directive relative au devoir de vigilance dite directive CS3D. Cette disposition impose aux entreprises – atteignant certains seuils – de publier et mettre en œuvre un plan de transition climatique qui organise l’alignement de leur modèle d’affaires sur l’objectif 1,5 °C fixé par l’accord de Paris.
[63] C. Cournil, « La sortie fossile : la voie juridictionnelle », RJE n° 1, 2025, p. 107-122.
[64] TA de Strasbourg, 22 juill. 2020, n° 1703642 – CAA Nancy, 29 déc. 2022, n° 20NC02931 – CE, 24 juill. 2024, n° 471780.
[65] CE, 18 déc. 2019, n° 421004, cons. 6.
[66] CEDH, 9 avr. 2024, n° 53600/20, VereinKlimaseniorinnen Schweiz et a. c/ Suisse, § 419.
[67] C. const. allemande, 24 mars 2021, nos 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20 et 1 BvR 96/20, pt 193.
[68] CE, 5e-6e ch. réunies, 2 août 2023, n° 467370, Assoc. Meuse nature environnement et a. – CE, 3e-8e ch. réunies, 3 oct. 2024, n° 494941.
[69] Cons. const., DC, 12 août 2022, n° 2022-843 – Cons. const., QPC, 27 oct. 2023, n° 2023-1066, Assoc. Meuse nature environnement et a. : H. Avvenire, « Environnement et droit des générations futures. Don’t look up », RDP juin 2024, n° RDP200d6.
[70] Intervention volontaire dans l’instance n° 2404456, Mémoire complémentaire du 18 novembre et 20 décembre 2024. V. TA Melun, 30 janv. 2025, n° 2404456, § 37.
[71] Sur cette question, v. European Scientific Advisory Board on Climate Change, « Scientific advice for the determination of an EU-wide 2040 climate target and a greenhouse gas budget for 2030-2050 », 15 juin 2023, https://lext.so/K6c8_S.
[72] https://foreverpollution.eu/.
[73] « Révélations sur la contamination massive de l’Europe par les PFAS, ces polluants éternels », Le Monde, févr. 2023 : https://lext.so/0jA1-E.
[74] A. Clerc, « L’utilisation du référé pénal environnemental dans la Vallée de la chimie », in C. Cournil et A.-S. Denolle (dir.), Le droit : une arme au service du vivant ? Plaidoyers et contentieux stratégiques, 2024, Pedone, p. 109 à 124.
[75] TA Lyon, 13 sept. 2024, n° 2407723. Le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l’arrêté de la préfète du Rhône du 14 mai 2024 qui a imposé des prescriptions complémentaires à l’exploitant à la suite de l’installation.
[76] Cabinet Kaizen avocat, assoc. Notre Affaire à Tous et PFAS contre Terre, communiqué de presse, 3 févr. 2025, à Oullins-Pierre-Bénite. V. le site de l’action collective : https://lext.so/a4dOeH ; Guide d’information citoyen, « Toutes et tous impacté·e·s par les PFAS : ensemble pour obtenir réparation de nos préjudices », janv. 2025, p. 21.
[77] Prop. L. n° 161, visant à protéger la population des risques liés aux PFAS, et la récente loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS).
[78] V. les travaux du juriste américain Robert Bullard et notamment son ouvrage Dumping in Dixie : Race, Class, and Environmental Quality.
[79] Cette idée est défendue dans un récent rapport de Notre Affaire à Tous, « Soif de justice : Agir contre les discriminations environnementales d’accès à l’eau potable dans les territoires dits d’Outre-mer », juin 2025, 92 p.
[80] TA Mayotte, 25 nov. 2023, n° 2304427.
[81] CE, 26 déc. 2023, n° 489993.
[82] V., en ce sens, le détail de l’action : https://lext.so/q0ReB9.
[83] A. Savaresi, J. Setzer, S. Bookman et a., « Conceptualizing just transition litigation », Nat Sustain 2024, n° 7, p. 1379 à 1384.