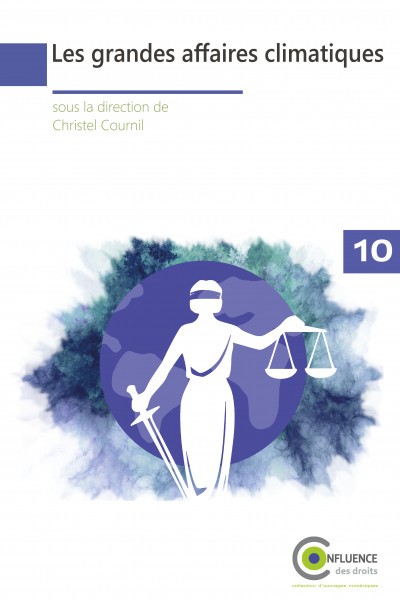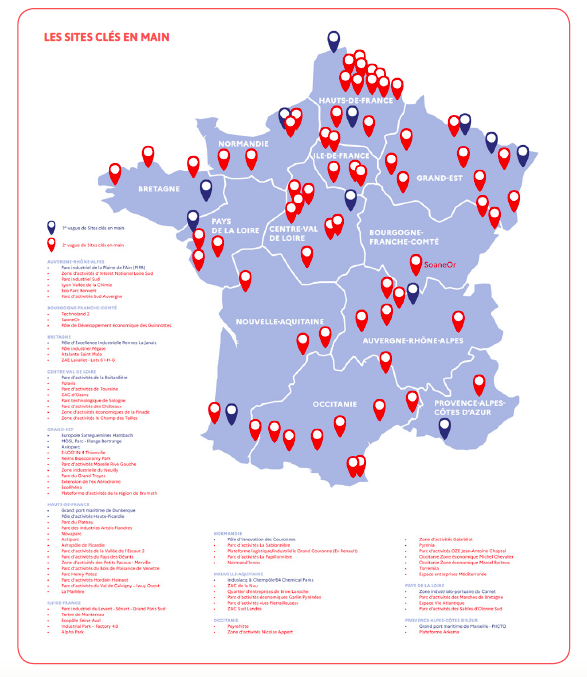Une coalition internationale d’associations (Canopée, CPT, Envol Vert, Mighty Earth, Notre Affaire à Tous et Sherpa) et d’organisations représentatives des peuples autochtones de Colombie et du Brésil (OPIAC, COIAB, FEPIPA et FEPOIMT) met en demeure le groupe Casino de prendre les mesures nécessaires pour exclure le boeuf issu de la déforestation et l’accaparement de territoires autochtones de sa chaîne d’approvisionnement au Brésil et en Colombie. Elle se réserve également le droit de solliciter la réparation des préjudices qui en découlent.
L’élevage bovin est la cause principale de la déforestation de l’Amazonie Selon les données de l’INPE (Institut national de recherche spatiale brésilien), sur la période d’août 2019 à juillet 2020, qui est la référence pour observer l’évolution de la déforestation, 9216 km2 ont été déboisés en Amazonie brésilienne, soit 34,5 % de plus que la période précédente. L’élevage bovin en est la principale cause. Les enquêtes menées depuis près de 10 ans ne cessent de pointer la responsabilité des abattoirs et des distributeurs. Non seulement ils s’approvisionnent régulièrement en viande bovine provenant de zones récemment déforestées mais ils ferment les yeux sur les pratiques de “blanchiment de bétail” visant à contourner la législation brésilienne. Ces pratiques permettent à des exploitations responsables de crimes environnementaux de vendre leurs bœufs en toute impunité.
De la viande issue de la déforestation dans les supermarchés Casino au Brésil Le groupe Casino est le leader de la distribution au Brésil à travers sa filiale “Grupo Pão de Açúcar”. Il y représente 15% des parts du marché, et près de la moitié du chiffre d’affaires mondial du groupe (47%) se fait sur le marché latino-américain. En juin 2020, l’association Envol Vert publiait une enquête accablante, mettant en évidence des preuves de déforestation récente et de pratiques d’accaparement de terres menée à partir d’échantillons de produits carnés vendus dans plusieurs supermarchés du groupe Casino au Brésil.
Selon Boris Patentreger, fondateur de l’association, « Ces enquêtes démontrent l’existence de liens entre plusieurs fermes impliquées dans la déforestation illégale et des produits vendus dans les supermarchés du groupe Casino. A elles seules, ces fermes représentent 4497 hectares de déforestation ».
Casino en violation de son devoir de vigilance ? Depuis 2017, le Groupe Casino est pourtant soumis à la loi française sur le devoir de vigilance qui lui impose de prendre des mesures adaptées pour prévenir les atteintes graves aux droits humains, à l’environnement et à la santé et sécurité des personnes résultant de ses activités, de celles de ses filiales, fournisseurs et sous-traitants. Alors que le groupe Casino reconnaît explicitement que la chaîne d’approvisionnement en viande bovine au Brésil est exposée à des risques extrêmement graves, sa politique en la matière est manifestement défaillante.
Selon Sandra Cossart, de l’association Sherpa, « le seul fait que Casino déclare dans son plan de vigilance que 100% de ses fournisseurs ont adhéré à sa politique sur la déforestation, alors que l’implication de ces mêmes fournisseurs dans la déforestation est régulièrement dénoncée, démontre que cette politique est soit inadaptée, soit non mise en oeuvre, soit les deux ».
Etelle Higonnet, directrice de campagnes à Mighty Earth, ajoute: « Casino achète du bœuf à des fournisseurs comme JBS, l’une des pires entreprises internationales en ce qui concerne la déforestation – et la plus grande entreprise de viande au monde. JBS est devenu célèbre pour sa corruption grâce au scandale « Lava Jato » (lavage express) ainsi que son implication dans l’esclavage moderne, la déforestation, les incendies en Amazonie, et l’accaparement des terres autochtones. Cependant, grâce à la nouvelle loi française, Casino doit enfin assumer une réelle responsabilité envers JBS et tous ses autres fournisseurs de viande responsables de déforestation et des violations des droits humains. En effet, tous les supermarchés français sont désormais avertis : nous avons l’intention de les tenir responsables du respect de la loi ».
Pour Célia Jouayed, de l’association Notre Affaire à Tous, « il est nécessaire que les grandes entreprises telle que Casino prennent toute la mesure de la portée de la loi sur le devoir de vigilance qui leur impose de prendre les mesures concrètes visant à prévenir les risques au droits humains, à l’environnement et à la santé, et non pas de se contenter de les identifier de manière formelle dans un document. » Pour Me Sébastien Mabile et Me François de Cambiaire du cabinet Seattle, conseils des associations, « il s’agit d’une action historique contre le groupe Casino, fondée sur une loi pionnière qui permettra au juge français de prescrire les mesures qui s’imposent pour enrayer la destruction de l’Amazonie par des compagnies françaises et réparer les préjudices subis ».
OPIAC, COIAB, FEPIPA, FEPOIMT, CPT, Canopée, Envol Vert, Mighty Earth, Notre Affaire à Tous et Sherpa demandent formellement au groupe Casino de respecter ses obligations légales en prenant les mesures nécessaires pour exclure tout le bœuf issu de la déforestation de sa chaîne d’approvisionnement. Si l’entreprise ne se met pas en conformité dans un délai de 3 mois prévu par la loi, les organisations entendent saisir la juridiction compétente.
Casino et la déforestation au Brésil
Depuis plus de 10 ans, les organisations brésiliennes alertent sur les multiples atteintes à l’environnement et aux droits humains causées par l’élevage bovin au Brésil : déforestation, accaparement de territoires indigènes, travail forcé.
Depuis, les autorités judiciaires brésiliennes ont conclu des accords avec certains des producteurs de viande brésiliens – au premier rang desquels JBS, Marfrig, et Minerva – pour sanctionner les abattoirs s’approvisionnant auprès d’exploitations responsables de telles atteintes.
Mais les contrôles des abattoirs sont insuffisants et ne concernent que les fermes leur vendant directement de la viande, sans traçabilité. Les pratiques de “blanchiment de bétail” se sont développées – multipliant les intermédiaires entre les fermes et les abattoirs. La déforestation causée par l’élevage a repris de plus belle ces dernières années, incitée par l’impunité en la matière depuis l’arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro.
Casino contrôle les supermarchés appartenant au Grupo Pao de Açucar (GPA) au Brésil. Le marché latino-américain représente près de la moitié du chiffre d’affaires mondial du groupe (47%).
En juin dernier, Envol Vert a publié une enquête menée sur un simple échantillon de viandes vendues en rayon de magasins contrôlés par GPA, révélant qu’une partie provenait d’exploitations ayant contribué à la déforestation illégale ou installées sur le territoire indigène Apyterewa. Depuis plusieurs années, les alertes concernant notamment JBS se multiplient.
Casino s’est contenté, en réponse, de rappeler sa politique et de prôner le besoin de “définir des règles de contrôle communes entre tous les acteurs distributeurs fournisseurs, pouvoirs publics et société civile” se cachant derrière des processus qui piétinent depuis des années.
La loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères
Adoptée le 27 mars 2017, la loi sur le devoir de vigilance des sociétés-mères et entreprises donneuses d’ordre oblige les sociétés françaises concernées à établir, publier et mettre en oeuvre de manière effective un plan de vigilance. Les mesures de vigilance doivent être propres à identifier et à prévenir les risques d’atteintes graves aux droits humains et aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité des personnes, et à l’environnement résultant de leurs activités mais aussi des activités de leurs filiales et fournisseurs à l’étranger.
En cas de manquement à ces obligations, les entreprises peuvent être attraites en justice et se voir enjoindre de se mettre en conformité avec la loi, voire de réparer les préjudices découlant des fautes de vigilance.
Nos demandes
Nos organisations mettent formellement en demeure le groupe Casino de se mettre en conformité avec la loi sur le devoir de vigilance concernant ses approvisionnements en boeuf au Brésil et en Colombie, et ce dans un délai de trois mois.
Elles demandent notamment à Casino :
- D’établir une cartographie présentant, analysant et hiérarchisant les risques d’atteintes graves résultant de l’approvisionnement des filiales de Casino en Amérique du Sud en viande de bœuf, notamment au Brésil et en Colombie, régulièrement mise à jour pour tenir compte des pratiques observées dans la filière bovine (y compris les pratiques dites de « blanchiment de bétail »),
- D’adopter des mesures d’évaluation de la situation des fournisseurs et des actions adaptées d’atténuation des risques et de prévention des atteintes graves, permettant d’exclure tout approvisionnement en viande de bœuf issue d’exploitations (zones d’approvisionnement et/ou fournisseurs) ayant contribué à la déforestation ou à la conversion d’écosystèmes (telles que définies par l’Accountability Framework Initiative), ayant eu recours au travail forcé ou à des conditions de travail dégradantes ou ayant porté atteinte aux droits des populations indigènes,
- D’évaluer publiquement et régulièrement l’efficacité et l’effectivité des mesures de vigilance en s’appuyant sur des indicateurs de moyens et sur des indicateurs de résultat en y associant les parties prenantes externes.
Elles se réservent le droit de demander la réparation des préjudices subis du fait des manquements du groupe Casino à son devoir de vigilance.
Les organisations signataires
- Canopée est une nouvelle organisation fondée en 2018 qui émerge du besoin critique de construire un contre-pouvoir citoyen pour mieux protéger les forêts en France et dans le monde. Nous sommes une association lanceuse d’alerte qui dénonce les menaces pesant sur les forêts. Nous ne nous contentons pas de dénoncer, ce que nous voulons, c’est agir à la racine des problèmes en produisant une contre-expertise de qualité et en la portant dans l’espace public. Canopée est membre des Amis de la Terre France et du collectif SOS Forêt.
- Envol Vert agit pour la préservation de la forêt et de la biodiversité en Amérique Latine (principalement Colombie et Pérou) et en France. Depuis 2011, nous développons des projets de terrain concrets et efficaces qui incluent la reforestation d’aires dégradées, le développement de l’agroforesterie et d’alternatives à la coupe illégale comme l’écotourisme, le développement de réserves naturelles, la sauvegarde ou la réintroduction d’espèces. Envol Vert mène également des campagnes de communication et des actions de sensibilisation afin d’inciter les entreprises et les citoyens à changer leurs modes de production et/ou de consommation.
- Mighty Earth est une organisation américaine de plaidoyer qui œuvre pour la protection des forêts tropicales, des océans et du climat. Nous aspirons à être l’organisation environnementale la plus efficace à l’internationale. Nos campagnes et notre équipe ont joué un rôle de premier plan en persuadant les plus grandes entreprises mondiales du secteur de l’alimentation et de l’agriculture d’adopter des politiques visant à éliminer la déforestation et les atteintes aux droits de l’homme de leurs chaînes d’approvisionnement, et ont conduit à l’adoption de transferts de plusieurs milliards de dollars vers l’énergie propre.
- Notre Affaire à Tous est une association qui oeuvre pour protéger le vivant, les communs naturels et le climat via l’utilisation du droit. Issu-es du mouvement pour la reconnaissance du crime d’écocide dans le droit international afin de sanctionner les crimes les plus graves contre l’environnement et à l’origine de l’Affaire du Siècle, les membres de Notre Affaire à Tous se positionnent comme « avocat-es de la planète », en cherchant à établir par la jurisprudence, le plaidoyer juridique et la mobilisation citoyenne une responsabilité effective et objective de l’humain vis-à-vis de l’environnement.
- OPIAC (Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana) est une institution colombienne à caractère spécial autochtone sans but lucratif qui exerce la représentation politique des peuples indigènes de l’Amazonie colombienne devant les institutions nationales et internationales. Son principal objectif est de faire en sorte que tous les droits collectifs et individuels de ses membres soient respectés et reconnus par tous les acteurs situés dans la région de l’Amazonie colombienne.
- Sherpa est une association créée en 2001 qui a pour mission de combattre les nouvelles formes d’impunité liées à la mondialisation et de défendre les communautés victimes de crimes économiques. Sherpa œuvre pour mettre le droit au service d’une mondialisation plus juste. L’action de l’association repose sur quatre outils interdépendants que sont la recherche, le contentieux, le plaidoyer et le renforcement de capacités. Ces actions sont menées par une équipe de juristes et d’avocats. Les activités de Sherpa ont contribué à l’indemnisation de communautés affectées par des crimes économiques, à des décisions judiciaires historiques à l’égard de multinationales et de leurs dirigeants et à des politiques législatives inédites.
- OPIAC (Organisation Nationale des Peuples Autochtones de l’Amazonie Colombienne) est une institution autochtone colombienne, une organisation à but non lucratif qui exerce une représentation politique des peuples autochtones de l’Amazonie colombienne devant les institutions nationales et internationales. Son objectif principal est de faire en sorte que tous les droits collectifs et individuels de ses membres soient respectés et reconnus par tous les acteurs situés dans la région amazonienne colombienne.
- La Commission Pastorale de la Terre (CPT), créée en 1975, est rattachée à la Conférence nationale des évêques du Brésil (CNBB). Elle est engagée sur l’enjeu crucial du partage de la terre et contre la destruction de l’environnement. Ses équipes locales sont présentes dans chacun des Etats du Brésil, accompagnant à la base communautés et groupes en lutte, joignant sa voix aux leurs, dénonçant injustices, violences, discrimination, travail esclave.
- COIAB (Coordination des organisations autochtones de l’Amazonie brésilienne) fondée le 19 avril 1989, est la plus grande organisation autochtone régionale du Brésil, qui a émergé à l’initiative des dirigeants des organisations autochtones. La mission du COIAB est de défendre les droits des peuples autochtones à la terre, à la santé, à l’éducation, à la culture et à la durabilité, en tenant compte de la diversité des peuples et en recherchant leur autonomie à travers l’articulation politique et le renforcement des organisation autochtones.
- FEPIPA (Fédération des Peuples Autochtones du Pará) fondée en avril 2016, est une organisation autochtone, créée pour promouvoir le bien-être social, politique, économique et culturel et les droits de l’homme des peuples autochtones. Elle vise à défendre et à discuter des intérêts collectifs des peuples et communautés autochtones de l’État de Pará, en promouvant leur organisation sociale, culturelle, économique et politique, en renforçant leur autonomie.
- FEPOIMT (Fédération des Peuples Autochtones du Mato Grosso) créée en juin 2016 est née de la nécessité de s’unir pour l’action et l’articulation politiques, visant à l’organisation sociale, culturelle, économique et au développement durable et politique des peuples et organisations autochtones du Mato Grosso. Ses principaux défis sont la garantie et la régularisation des terres, la gestion de l’environnement, la protection du territoire et la lutte pour les droits des autochtones.
Le cabinet d’avocat les accompagnant
Seattle Avocats est un cabinet d’avocat spécialisé sur les question de responsabilité des entreprises du fait d’atteintes à l’environnement et aux droits humains. Monsieur Sébastien Mabile et Monsieur François de Cambiaire représentent des ONGs et des collectivités dans le cadre des premières actions introduites sur le fondement de la loi devoir de vigilance des entreprises, notamment contre Total et contre le groupe de transport XPO Logistics, et s’intéressent en particulier aux débats en cours au niveau international et européen sur la responsabilité sociale et pénale des multinationales. S’agissant de dommages particulièrement graves à l’environnement ayant des conséquences tout aussi graves sur les droits des populations autochtones, le cabinet Seattle Avocats apporte son soutien et ses compétences à la coalition internationale d’associations qui mettent en demeure le groupe Casino de se conformer à la loi sur le devoir de vigilance.