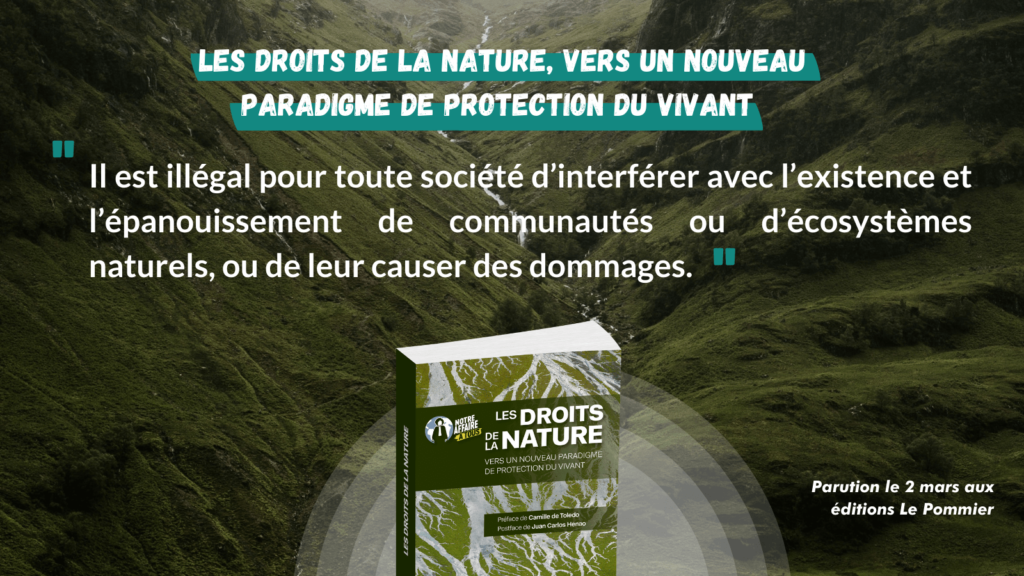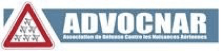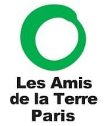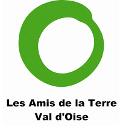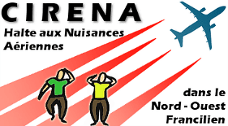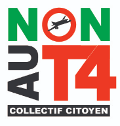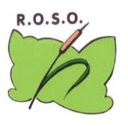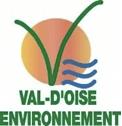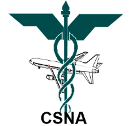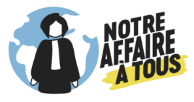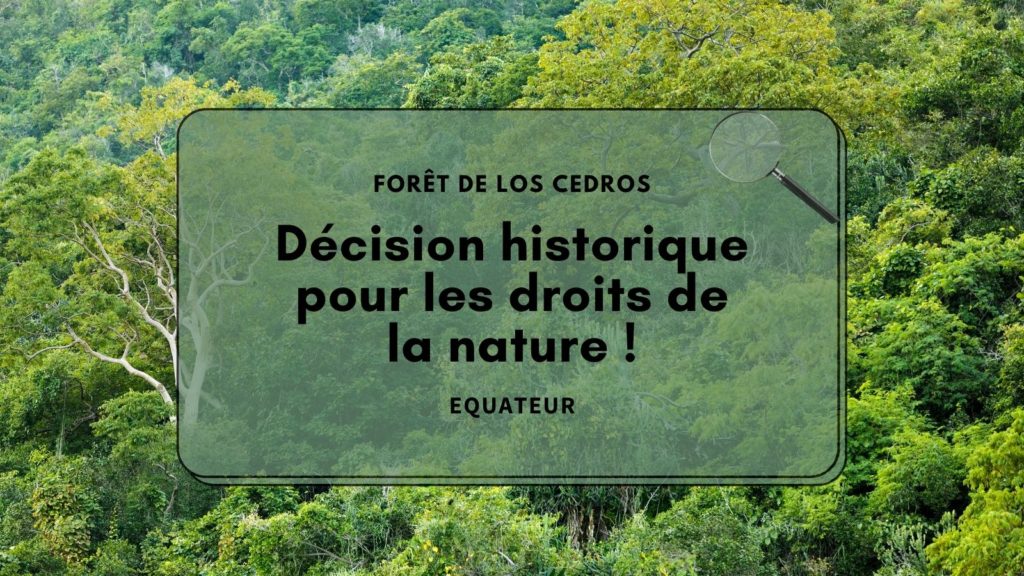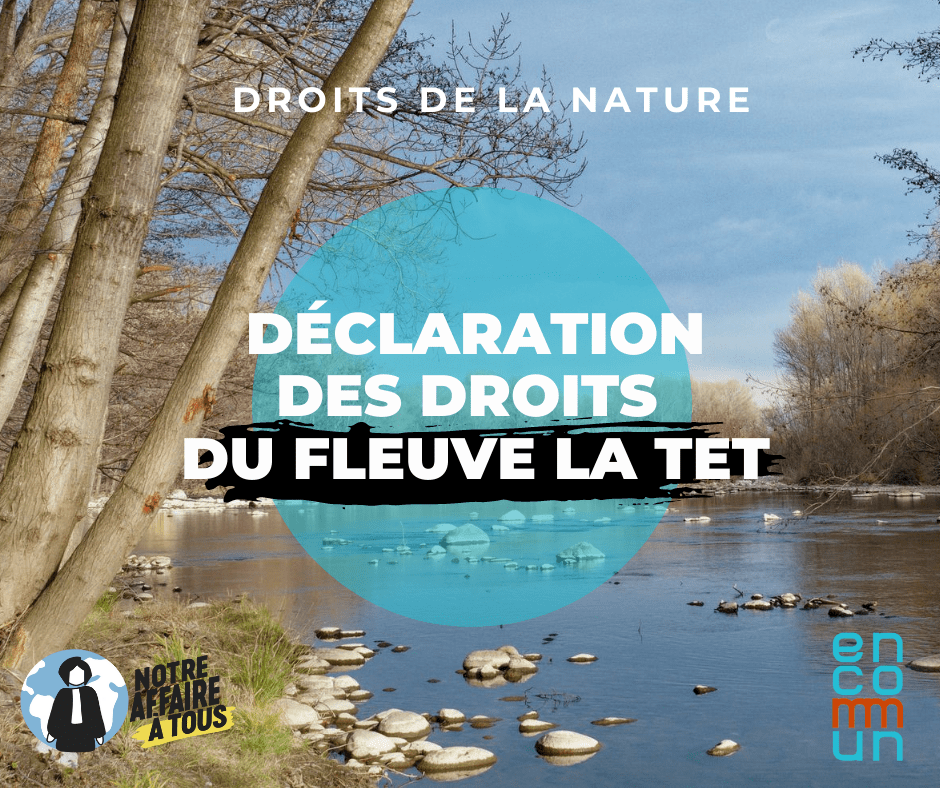Une organisation brésilienne, soutenue par Notre Affaire à Tous, met en garde BNP Paribas pour ses financements à un important producteur de viande bovine brésilien, Marfrig, suspecté d’être impliqué dans la déforestation illégale, le travail forcé et l’accaparement de territoires autochtones

Paris/Goiânia, 17 octobre 2022 – Dans le cadre d’une démarche inédite visant à engager la responsabilité des acteurs financiers en matière de déforestation illégale et de graves violations des droits humains liées à l’industrie bovine brésilienne, l’association brésilienne Comissão Pastoral da Terra (CPT) et l’association française Notre Affaire À Tous (NAAT), soutenues par l’ONG nord-américaine Rainforest Action Network, ont adressé une mise en demeure à la banque française BNP Paribas en raison de son appui financier à Marfrig, la deuxième plus grande entreprise de conditionnement de viande du Brésil. Dans une lettre adressée à BNP Paribas, les avocats de NAAT et CPT affirment que Marfrig se rend coupable de graves violations en raison de l’insuffisante réglementation de sa chaîne d’approvisionnement, contribuant ainsi à la déforestation, à l’accaparement de terres de populations autochtones et à des pratiques analogues à l’esclavage dans les élevages bovins qui fournissent Marfrig. En fermant les yeux sur ces abus et en continuant à aider Marfrig à obtenir des milliards de dollars pour son financement, la lettre affirme que BNP Paribas contribue à ces pratiques illégales et pourrait voir sa responsabilité engagée.
Selon une analyse réalisée par le Center for Climate Crime Analysis (CCCA), portant sur les activités réalisées entre 2009 et 2020 par deux usines de conditionnement de viande exploitées par Marfrig, les fournisseurs de viande bovine de Marfrig auraient été responsables de plus de 120 000 hectares de déforestation illégale dans la forêt amazonienne et la savane du Cerrado au cours de cette période. Il a également été établi que Marfrig s’est, directement et indirectement, approvisionné en bétail auprès d’éleveurs qui élevaient illégalement leurs bêtes sur des territoires autochtones. Une enquête menée par Repórter Brasil a révélé qu’il s’agissait notamment d’exploitations situées sur le territoire autochtone Apyterewa, dans l’État du Pará, l’une des terres autochtones les plus déboisées ces dernières années.
Selon Xavier Plassat, de la Campagne nationale de la CPT contre l’esclavage : « Comme le gouvernement de Jair Bolsonaro a interrompu toute action de reconnaissance légale des terres autochtones, les éleveurs de bétail s’installent sur les territoires traditionnels des populations autochtones en toute impunité.«
En outre, bien que la loi brésilienne interdise rigoureusement les pratiques assimilables à l’esclavage, notamment le travail forcé et la servitude pour dettes, Marfrig s’est également approvisionnée en bétail auprès d’exploitations agricoles impliquées dans de telles pratiques.
Parmi les secteurs qui profitent de conditions analogues à de l’esclavage au Brésil, celui de l’élevage bovin représente un poids exorbitant : un tiers des travailleurs libérés de cette situation entre 1995 et 2020. Selon un rapport de Greenpeace publié l’année dernière, Marfrig ne dispose toujours pas de procédures efficaces pour garantir que les éleveurs de bétail liés à la déforestation illégale ou à des violations des droits de l’homme soient exclus de sa chaîne d’approvisionnement.
Il s’agit de la première mise en garde adressée à une banque pour qu’elle se conforme à ses obligations légales en matière de déforestation. La loi française sur le devoir de vigilance exige que les multinationales opérant en France établissent un plan qui « comporte des mesures raisonnables de vigilance pour identifier les risques et prévenir les violations graves des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la santé et de la sécurité des personnes et de l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle » en France et à l’étranger. Cette plainte est un signal fort à l’attention de tous les acteurs financiers, leur rappelant leurs obligations légales en matière de crise climatique et de violations des droits de l’homme – et les risques juridiques et réputationnels de ne pas s’y conformer immédiatement.
Selon Jérémie Suissa, délégué général de Notre Affaire À Tous : « Il est grand temps que les banques cessent de financer la déforestation. Elles ne peuvent plus prétendre qu’elles ne savent pas que leurs financements et leurs investissements alimentent activement le chaos climatique, l’effondrement de la biodiversité, l’accaparement des terres autochtones et les pratiques s’apparentant à l’esclavage. La loi est de notre côté, BNP Paribas doit changer ses pratiques. »
Contacts presse
Comissão Pastoral da Terra: Fr. Xavier Plassat, Coordinateur de la campagne nationale de la CPT “Ouvre l’œil pour ne pas devenir un esclave”; comunicacao@cptnacional.org.br, + 5563 99221 9957
Notre Affaire à Tous : Abdoulaye Diarra, Chargé de communication, communication@notreaffaireatous.org, 07 82 21 38 90
Rainforest Action Network: Laurel Sutherlin, Responsable de la Communication stratégique, laurel@ran.org, +1 415 246 0161