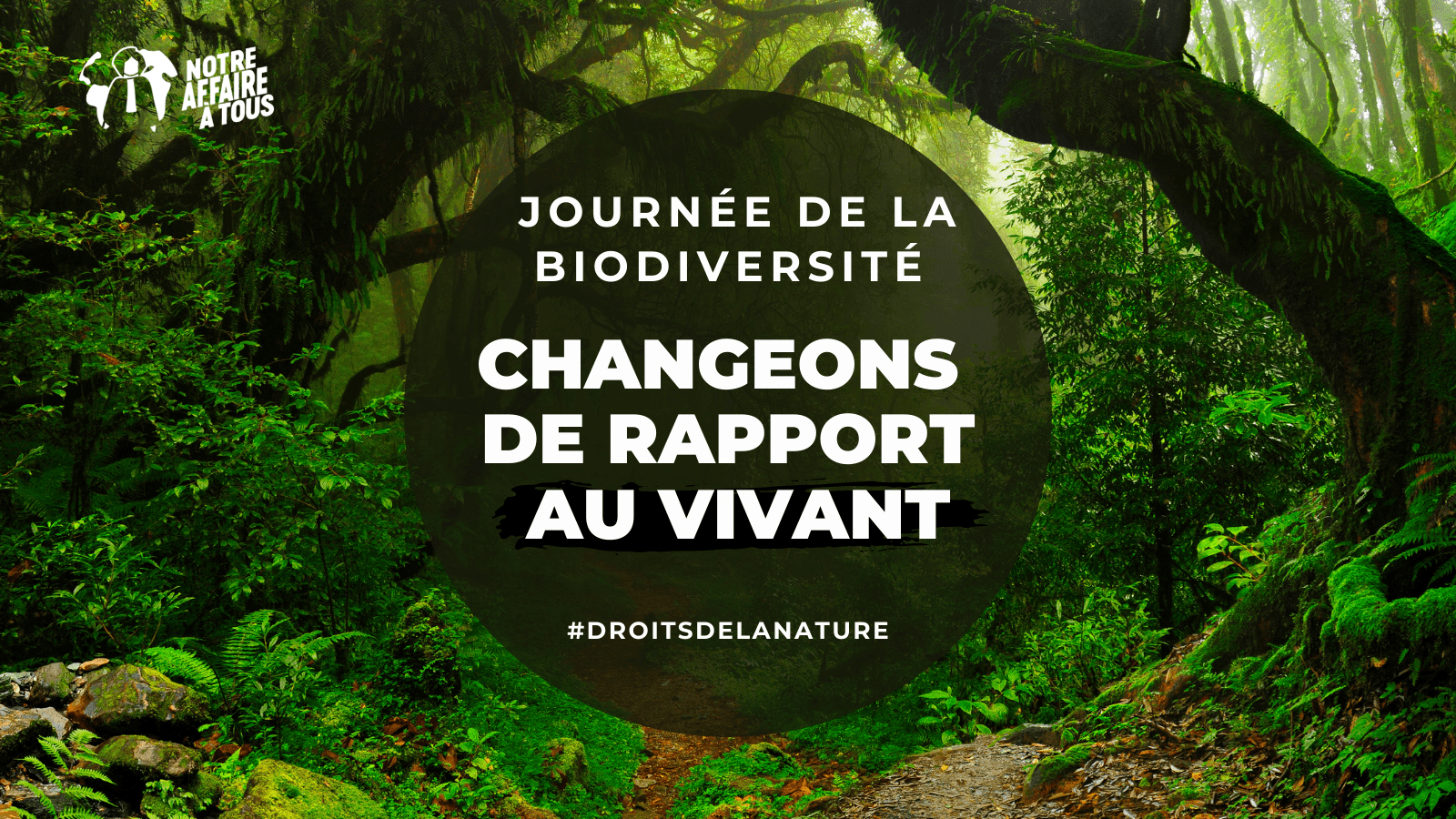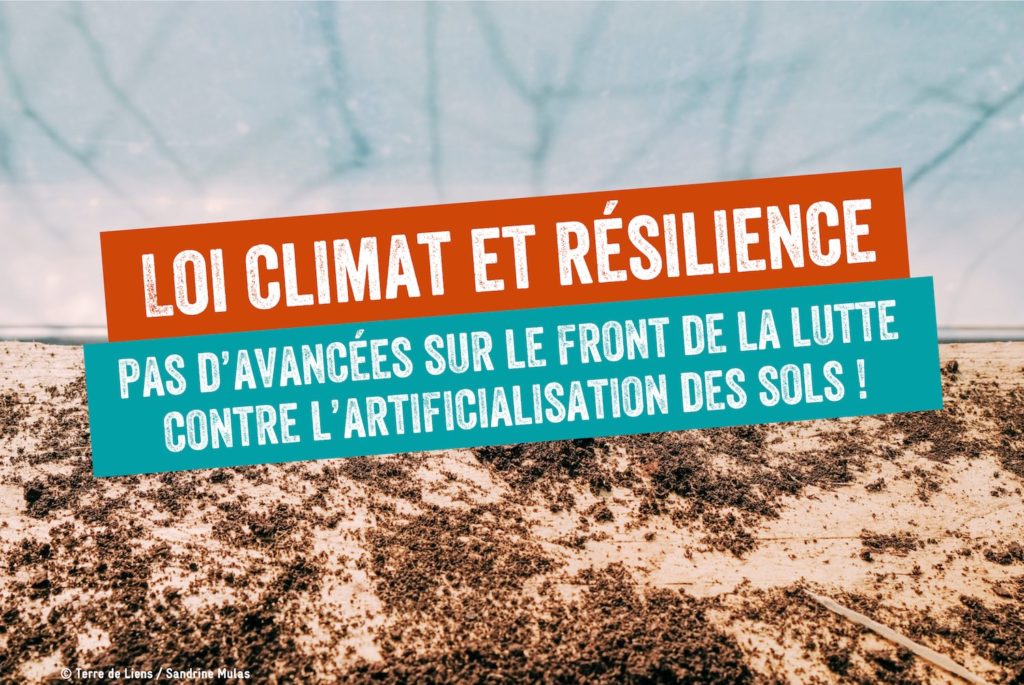ANALYSE DE NOTRE AFFAIRE À TOUS DES DISPOSITIONS DU TITRE VI DU PROJET DE LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE VISANT À RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENVIRONNEMENT ET PROPOSITIONS D’AMENDEMENT
Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (le projet de loi climat et résilience), issu des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, a été publié le 10 février 2021. Le titre VI visant à renforcer la protection judiciaire de l’environnement contient les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement depuis le 22 novembre 2020 et relatives au délit de mise en danger de l’environnement et au “délit général de pollution” annoncé, dont les dispositions ont encore évolué par rapport aux versions précédentes du projet de loi ayant fuité.
Notre Affaire à Tous souhaite ici apporter une analyse de ces dispositions (I) ainsi que des propositions d’amendements (II), en invitant les parlementaires à soit incriminer l’écocide comme proposé par la Convention citoyenne pour le climat, soit à retirer ce terme du projet de loi dans sa rédaction actuelle, l’écocide étant un terme trop important pour être ainsi galvaudé. Enfin, Notre Affaire à Tous souhaite rappeler la nécessité de poursuivre le travail sur les limites planétaires avec la création d’une Haute autorité pour les limites planétaires, qui figurait dans la proposition de la Convention citoyenne pour le climat (III).
1. Analyse des dispositions
Pour faire face au dérèglement climatique en particulier et aux comportements entraînant la destruction de la planète et le dépassement des limites planétaires en général, la Convention citoyenne avait décidé de proposer de criminaliser l’écocide, une proposition pour laquelle Notre Affaire à Tous se bat depuis longtemps.
Le gouvernement a réduit à néant cette ambition, en détournant la définition d’écocide de celle débattue dans le débat national et international qui vise à l’inscrire parmi les crimes les plus graves portant atteinte à des valeurs universelles ; et en proposant à sa place de nouvelles incriminations environnementales qui auraient pu être bienvenues mais sont en réalité rendues quasiment inopérantes au regard de leur champ d’application extrêmement restrictif.
A l’incrimination de l’écocide, le gouvernement a ainsi préféré proposer d’une part l’aggravation des peines applicables aux infractions sectorielles déjà prévues dans le code de l’environnement ; et d’autre part la création de nouveaux délits se caractérisant par des conditions d’application fortement restrictives et par un système incohérent de gradation des peines.
Par conséquent, le gouvernement semble bien éloigné de sa promesse de brandir “le glaive de la justice face aux voyous de l’environnement”.
a. Sur le délit de mise en danger de l’environnement (article 67)
Premièrement, le délit de mise en danger de l’environnement annoncé par les Ministres de la justice et de la transition écologique est réduit aux infractions spécifiques déjà prévues par les articles L. 173-1 et L. 173-2 du Code de l’environnement et par l’article L. 1252-2 du Code des transports : il ne s’agit donc pas d’un délit général de mise en danger de l’environnement pourtant si nécessaire, mais de dispositions concernant un nombre restreint d’actes ne couvrant pas l’ensemble des situations dans lesquelles la nature est mise en danger. La nouvelle infraction prévue est par ailleurs inopérante, tant les conditions requises pour considérer un comportement comme dangereux pour la santé et les éléments de l’environnement sont drastiques. Si nous pouvons nous réjouir de la volonté exprimée de créer un tel délit, ses dispositions ne permettent ainsi même pas de couvrir l’ensemble des situations censées l’être au regard de la Directive /99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal.
D’une part, le délit prévu ne concerne que:
- le fait d’exploiter une installation, soumise à autorisation, à enregistrement, à agrément, homologation, etc. (art. L. 173-1 Code de l’environnement) ;
- le fait de poursuivre une telle exploitation sans se conformer à la mise en demeure de l’autorité administrative (art. L. 173-2 Code de l’environnement) ; ou
- le fait de « transporter par voie ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses dont le transport n’est pas autorisé » (art. L. 1252-5 Code des transports).
Un tel délit ne vise donc pas l’ensemble des comportements susceptibles de mettre l’environnement en danger.
D’autre part, tout comme le délit de pollution généralisée dont il sera fait état ci-après, cette nouvelle infraction ne peut être caractérisée que lorsque de tels comportements ne créent un risque de dommages graves et susceptibles de durer au moins dix ans. Il en découle que ce nouveau délit ne saurait s’appliquer ni à des risques de naufrage comme celui de l’Erika, ni à des risques d’accidents industriels comme celui de Lubrizol !
Nos propositions ci-après visent à créer un délit général de mise en danger de l’environnement pleinement opérationnel.
b. Sur le pseudo délit général de pollution (article 68)
Deuxièmement, le délit général de pollution annoncé par les ministres de la justice et de la transition écologique, a été considérablement amoindri, sectionné en trois délits autonomes spécifiques et non pas généraux : (i) un délit de pollution induit par l’activité d’installations classées selon les articles L. 173-1 et L. 173-2 du code de l’environnement, qui serait introduit à l’article L. 173-3 II ; (ii) un délit de pollution de l’air et des eaux (nouvel article L. 230-1 du Code de l’environnement) et (iii) un délit de pollution des sols (nouvel article L. 230-1 du Code de l’environnement).
Alors que le premier délit ne concerne qu’un nombre restreint de cas ainsi que déjà souligné plus haut, le second est limité à la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence et sécurité prévue par la loi ou le règlement (laissant ainsi impunis les actes de négligence et d’imprudence qui structurent la criminalité environnementale), quand le troisième et dernier est limité à l’abandon et au dépôt de déchets (ne couvrant donc pas le rejet de substances polluantes provenant d’autres sources).
Les conditions de gravité et de durabilité de dix ans s’imposant également ici, ces trois délits seront tout aussi inopérants que le délit de mise en danger.
En bref, parler d’un délit “général de pollution” relève d’un abus de langage : car le gouvernement ne propose pas de sanctionner les atteintes au vivant mais uniquement certains actes restreints, et se contente en réalité de proposer des sanctions plus élevées pour certaines atteintes relativement rares et difficiles à caractériser. Face à la criminalité environnementale, le gouvernement ne brandit guère plus qu’un doigt levé. Face à l’enjeu de préservation de la planète, le gouvernement se refuse encore à reconnaître la valeur intrinsèque du vivant et à condamner les atteintes à la nature pour ce qu’elles sont.
c. Sur le délit d’écocide (article 68)
Troisièmement, le crime d’écocide, fortement voulu par la Convention Citoyenne, est fortement dévoyé. D’une part, ce qui aurait dû être un crime parmi les plus graves portant atteinte aux valeurs universelles est ici intégré comme un délit. D’autre part, ce délit est présenté moins comme une infraction autonome contre les écosystèmes que comme une circonstance aggravante des deux délits spécifiques de pollution de l’air, des eaux et des sols, ainsi que de la nouvelle infraction envisagée par l’art. L. 173-3 Code de l’environnement (nouvel article L. 230-3 du Code de l’environnement). Prétextant répondre à une requête citoyenne, le gouvernement s’écarte ainsi de l’écocide tel qu’il est débattu depuis les années 70.
Sous l’étiquette d’ « écocide », le projet de loi aggrave d’une part le délit de pollution de l’air et des eaux, lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle (et non par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la loi ou par le règlement, et donc de manière non intentionnelle) ; et d’autre part, le projet de loi aggrave le délit de pollution des sols ainsi que les atteintes graves et durables induits par l’exploitation illégale d’une installation soumise à autorisation, lorsque ces faits sont commis « en ayant connaissance du caractère grave et durables des dommages sur la santé, la flore, la faune ou la qualité de l’air, de l’eau ou des sols, susceptibles d’être induits par les faits ». Dans l’un et l’autre cas, la peine de 5 ans d’emprisonnement est portée à dix ans d’emprisonnement ; la peine d’amende est portée d’1 million d’euros à 4,5 millions et peut être augmentée jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Outre que l’incohérence de ce système d’infractions, l’absence de clarté des incriminations, ainsi que la non proportionnalité des même peines prévues à la fois pour des infractions intentionnelles et non intentionnelles – déjà soulignées par le Conseil d’État dans l’avis particulièrement sévère rendu sur le projet de loi dans lequel il déclare que “Le projet de loi n’assure donc pas une répression cohérente, graduée et proportionnée des atteintes graves et durables à l’environnement selon l’existence ou non d’une intention » – un tel système d’infraction banalise la notion d’écocide en l’utilisant comme un moyen pour l’aggravation de faits de pollution qui sont déjà incriminés par d’autres infractions « communes ». Il se détache également de l’essentiel : car là aussi, le gouvernement choisit de sanctionner un nombre restreint d’actes plutôt que de réprimer les graves dommages causés à l’environnement en tant que tels.
Il y a une raison pour laquelle nous demandons l’inscription de l’écocide parmi les crimes les plus graves condamnés par la Cour pénale internationale : il s’agit précisément de leur gravité. Or, des comportements d’une telle gravité ne peuvent figurer que parmi les comportements incriminés (et non pas en tant que délit, donc) et les plus sanctionnés, sans quoi la reconnaissance de l’écocide perd à la fois toute force symbolique, toute capacité de mobilisation de l’opinion et de la communauté internationale, et tout effet dissuasif.
Notre Affaire à Tous souhaite ici rappeler que le terme d’écocide a un sens, et une histoire. Il vient du grec oikos, « maison », et du latin caedere, “tuer”. Cela signifie littéralement “tuer notre maison commune”, la Terre. Utilisé pour la première fois en 1970 par le biologiste Arthur Galston à l’occasion d’une conférence sur la guerre du Vietnam, le définissant comme “la destruction volontaire et permanente de l’environnement dans lequel les gens peuvent vivre d’une manière de leur choix”, le terme est repris par le Premier Ministre suédois, Olof Palme, lors de la toute première Conférence internationale sur l’environnement à Stockholm, en 1972. Voilà donc 50 ans que la communauté internationale reconnaît l’importance de cette incrimination, sans pour autant l’inscrire dans notre droit. Une dizaine d’Etats, à commencer par le Vietnam et une dizaine de pays de l’ex-URSS souhaitant condamner les essais nucléaire sur leurs territoires, l’inscrivent néanmoins dans leurs codes pénaux pendant les années 90s.
Diverses propositions de définition et formulation ont par la suite été discutées dans le cadre du travail de la commission juridique des Nations-Unies lors de la rédaction du Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, dans le milieu universitaire, ou encore chez les praticiens du droit ; et discutées au plus haut niveau de l’Etat, notamment en France.
Plus récemment, la Fondation Stop Ecocide a mis sur pied un panel international d’expert.e.s de très haut niveau afin de proposer une définition du crime d’écocide susceptible d’être inscrite au Statut de Rome en réunissant l’accord des Etats parties à la Cour pénale internationale. Ses conclusions sont attendues pour le premier semestre 2021, et doivent inspirer la rédaction choisie dans les Etats. Soulignant la date rapprochée à laquelle la proposition du groupe d’expert.e.s sera publiée, Notre affaire à tous incite les parlementaires à déposer les amendements que nous suggérons tout en gardant ouverte la possibilité de leur évolution avant la fin de l’examen du projet de loi de sorte à y intégrer les conclusions de ce panel.
d. Remarques générales
La manière dont le gouvernement aborde ces nouveaux délits ne nous permet par ailleurs aucunement de voir :
- Leur lien direct avec le dérèglement climatique, sauf à observer une évolution majeure de la jurisprudence en ce qui concerne la pollution de l’air, à ce jour principalement appréhendée à travers les particules fines ;
- Emerger une approche écosystémique, le gouvernement préférant préserver une approche segmentée de l’environnement (faune et flore, sols, eaux et air) et des délits distincts, plutôt que la formulation déjà prévue par l’article 1247 du Code civil établissant le préjudice écologique et avec une responsabilité civile pour « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou au bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».
Notre Affaire à Tous regrette qu’au-delà du rejet de la proposition de la Convention citoyenne sur l’écocide, un système lisible, cohérent et proportionné de droit pénal de l’environnement ne soit introduit par ce projet de loi. Notre Affaire À Tous déplore également qu’un véritable débat public n’ait pas émergé autour du droit répressif de l’environnement, alors même que les atteintes au vivant mettent en danger la sûreté de la planète et la capacité de l’humanité à habiter la Terre aussi bien que notre sécurité, y compris définie au sens strict : la criminalité environnementale est la quatrième source de financement des groupes armés et organisations terroristes selon Interpol.
Ce droit répressif de l’environnement devrait consister en un système rationnel organisé autour de trois infractions caractérisées par une différente échelle de gravité : (i) une infraction de mise en danger de l’environnement, (ii) une infraction d’atteinte aux éléments de l’environnement et à l’équilibre des écosystèmes, et finalement (iii) l’écocide comme incrimination réservée aux dommages les plus graves, autrement dit aux désastres et aux catastrophes écologiques.
Le droit international, le droit de l’Union européenne ainsi que plusieurs systèmes nationaux vont dans cette direction. Il est temps que le droit français reconnaisse enfin la valeur intrinsèque de la nature et criminalise, à leur juste niveau, les atteintes qui lui sont portées.
DIGEST
- Le projet de loi détourne la notion d’écocide et restreint outre toute mesure l’incrimination des atteintes aux éléments de l’environnement. Il ne criminalise pas les atteintes portées à l’équilibre des écosystèmes.
- Les délits de mise en danger et d’atteinte générale aux éléments de l’environnement, envisagés par le projet de loi, ne concernent qu’un nombre restreint de comportements, ainsi que de dommages ou de risques de dommages révélant un fossé abyssal entre les prétentions du gouvernement et le réel. Ils ne visent en aucun cas la protection de la nature pour son intérêt propre. Ce système de délits environnementaux est par ailleurs voué à être inopérant pour les raisons suivantes : Il vise des catégories restreintes d’auteurs (exploitants d’installations soumises à autorisation, à enregistrement, à agrément, homologation ; opérateurs de déchets). Il n’est mobilisable qu’en situation d’irrespect des autorisations et arrêtés distribués par les autorités publiques ; niant donc la valeur intrinsèque de la nature.Il n’est applicable qu’en cas d’atteintes susceptibles de durer au moins dix ans, assez rares dans le monde réel et difficilement mesurables.Le délit de pollution de l’air et des eaux est, quant à lui, limité à la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité et ne s’applique pas aux fautes d’imprudence et de négligence, pourtant dominantes dans le domaine. Ils s’écartent du droit international, du droit de l’UE et des réformes adoptées par d’autres pays industrialisés.
- Il est difficile de qualifier le “délit d’écocide” finalement retenu par le gouvernement, empêtré dans ses négociations internes entre l’écologie et Bercy, tiré d’un côté par la Convention citoyenne et de l’autre par les lobbies et notamment le Medef ; si ce n’est qu’il use à la fois de termes inappropriés et recouvre un mécanisme quasi-inopérant.
ALERTE
En tout état de cause, le terme d’écocide ne saurait être galvaudé ; en reconnaissant le crime d’écocide comme figurant parmi les crimes les plus graves, nous écrivons l’histoire. La proposition du gouvernement, donnant une autre définition et des contours beaucoup plus lâches à l’écocide, risque non seulement d’insulter l’histoire mais aussi de créer un dangereux précédent et ainsi affaiblir le fragile processus de définition dont cette infraction fait l’objet à l’échelle internationale. Le terme d’écocide ne doit pas figurer parmi les termes figurant dans la loi s’il ne revêt pas l’importance qui lui est donnée par la communauté internationale depuis sa première apparition et utilisation en 1970.
2. Nos propostions
Nous proposons deux scénarios possibles d’amendements au projet de loi climat et résilience:
- Un scénario d’amélioration substantielle du droit pénal de l’environnement pour relever le défi environnemental (scénario 1) ;
- Un scénario a minima visant à rendre opérationnelles les propositions du gouvernement, qui ne le sont aucunement à ce stade (scénario 2).
Nous rappelons à ce titre que la question d’une meilleure réponse pénale aux infractions environnementales et celle de la création de juridictions spécialisées sont soulevées depuis de nombreuses années, et que la “dépénalisation de fait du droit de l’environnement” est une réalité. C’est précisément à ces enjeux que la loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée a tenté de répondre sans pour autant aller au bout de l’exercice : c’est la raison d’être des, amendements que nous proposons. Nous rappelons également qu’à l’échelle européenne comme internationale, la répression des atteintes à l’environnement est un enjeu émergent, et la France en perte de vitesse vis-à-vis d’autres pays européens et occidentaux. Néanmoins, ces mesures doivent s’accompagner de moyens financiers et humains suffisants alloués à la justice environnementale, qui demeurent un point primordial afin de garantir l’effectivité des textes.
Scénario 1
Vers un droit pénal de l’environnement général et autonome et l’incrimination de l’écocide
Dans ce premier scénario, nous proposons:
- Concernant le délit de mise en danger de l’environnement et le délit général de pollution:
- un remplacement du critère cumulatif du caractère grave et durable, par un critère alternatif;
- la suppression de la définition du caractère durable exigeant une durée d’au moins 10 ans ;
- un élargissement de l’élément moral en incluant la négligence et l’imprudence.
- une suppression du délit d’écocide tel que proposé par le gouvernement ;
- une incrimination de l’écocide avec une définition appropriée.
Scénario 2
Amélioration à la marge des propositions du gouvernement afin de rendre les nouvelles incriminations pour le moins opérationnelles
Dans ce deuxième scénario, proposé à contre-coeur tant l’enjeu est immense et urgent, nous proposons uniquement :
- S’agissant du délit de mise en danger de l’environnement et du délit général de pollution :
- le remplacement du critère cumulatif du caractère grave et durable par un critère alternatif ;
- la suppression de la définition du caractère durable exigeant une durée d’au moins 10 ans ;
- l’élargissement de l’élément moral en incluant la négligence et l’imprudence.
- la suppression du délit d’écocide tel que proposé par le gouvernement ;
- l’incrimination de l’écocide avec une définition appropriée.
Rien ne serait pire que d’avoir mis en place de nouvelles infractions inefficaces, en prétendant avoir fait le nécessaire et en balayant d’un revers de la main les essentielles modifications du régime répressif français en matière d’environnement.
Suggestions
Poursuivre le travail sur les limites planétaires avec la création d’une Haute autorité pour les limites planétaires
Afin de finaliser les recherches sur des outils de mesure et réglementaires relatifs aux limites planétaires, afin également de produire de la connaissance et de l’expertise dans la durée, et de fournir rapports d’évaluation et de recommandations aux pouvoirs publics et aux personnes morales de droit privé, la France doit également créer une Haute Autorité aux limites planétaires, dotée d’un budget suffisant, s’élevant pour les trois premières années à au moins 3 millions d’euros annuels. Cette Haute Autorité peut être créée par décret, préférablement en nouvelle Section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’environnement. Nous formulons également une proposition d’amendement législatif.
En complément, l’article L. 225-102-4.-I du Code de commerce pourrait être utilement modifié de la sorte, afin que le secteur privé ait lui aussi pour responsabilité d’oeuvrer au respect des limites planétaires : « Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement et les limites planétaires, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.”
***
Liens utiles