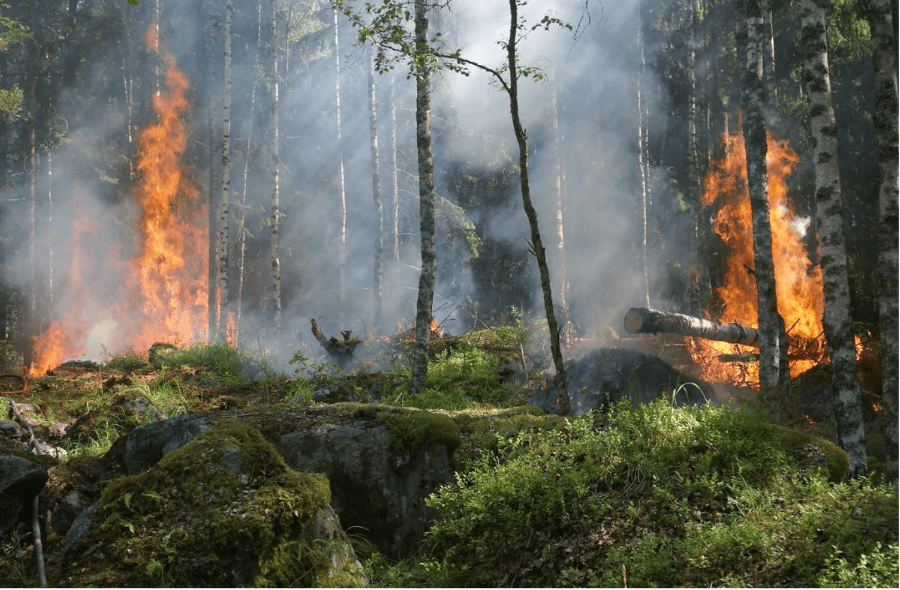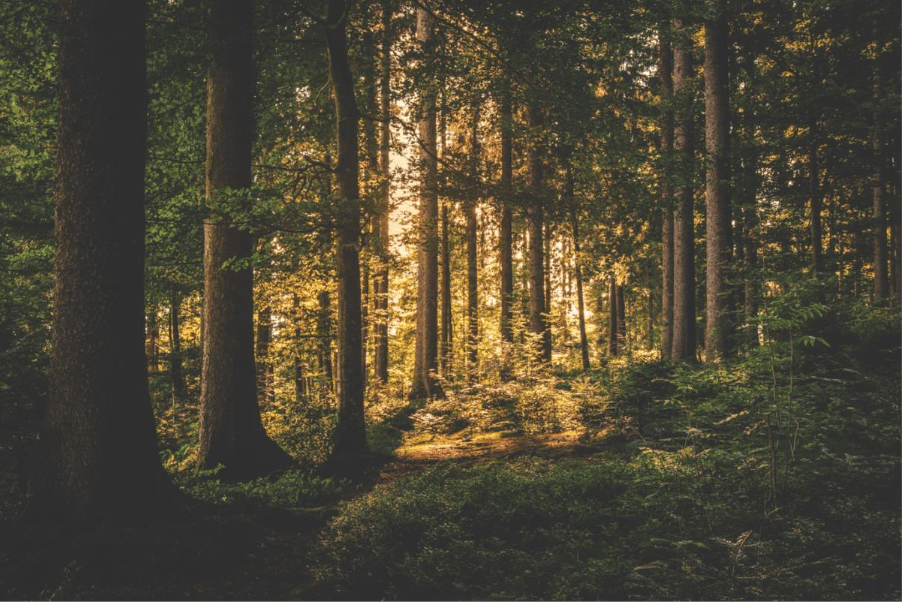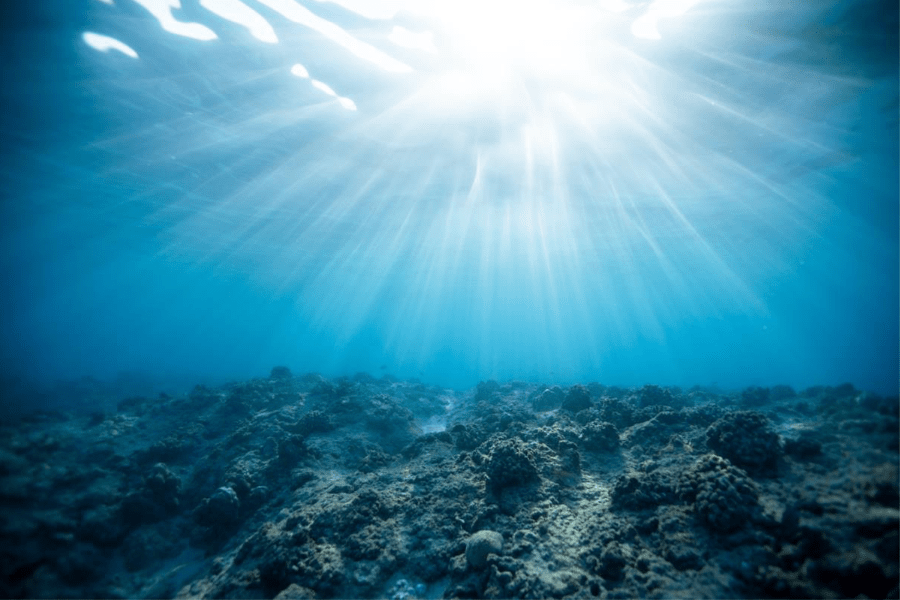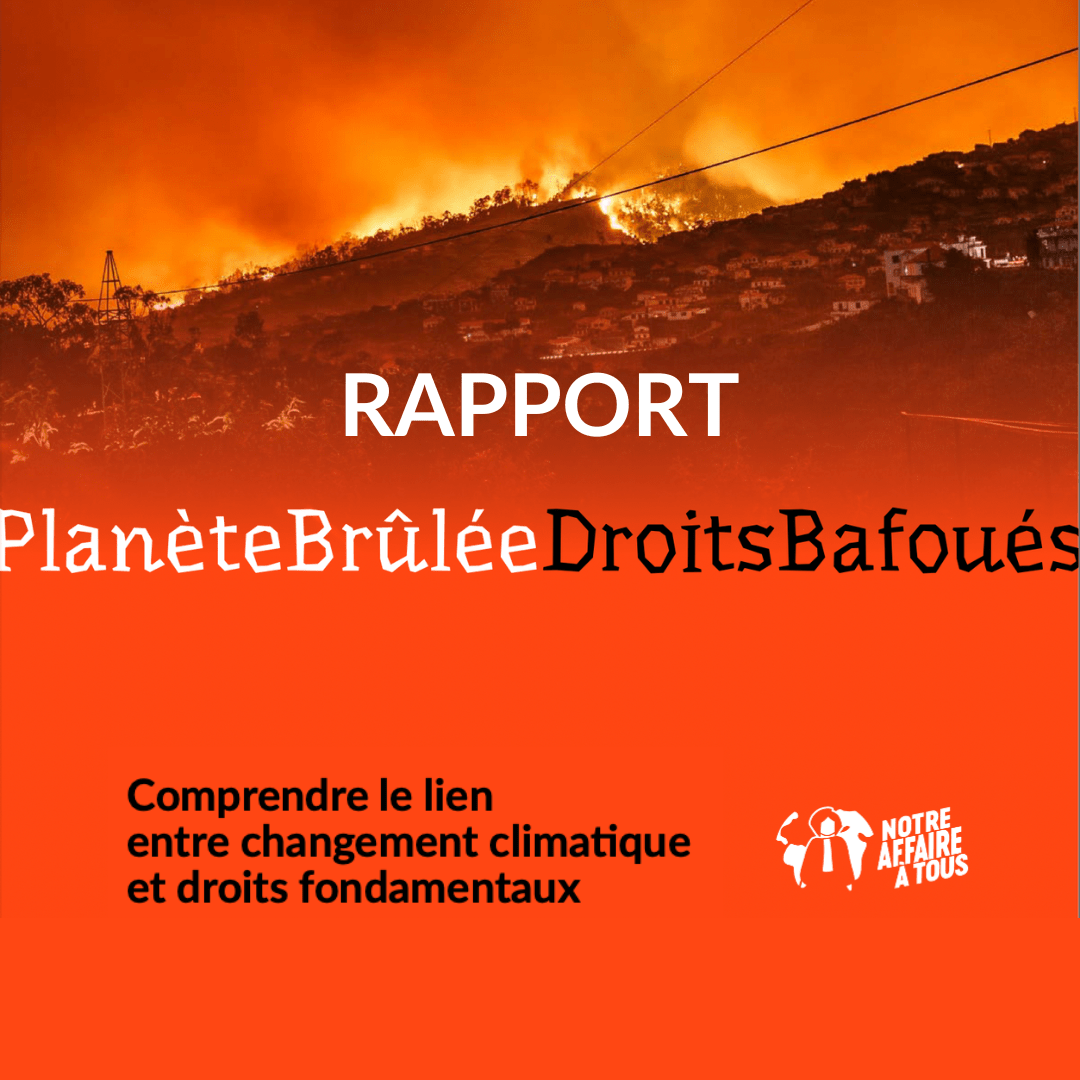A l’occasion du 1er mai, NAAT met en lumière les liens entre les enjeux climatiques et la défense d’un système de retraites plus juste.

“Pas de retraités sur une planète brûlée”. Ce slogan a résonné ces derniers mois lors des manifestations contre la réforme des retraites. Le sujet est porté par différentes associations environnementales et par des militant·e·s écologistes. Ils et elles mettent en avant que l’urgence n’est pas de réformer les retraites mais d’agir pour limiter le changement climatique. Car pour celles et ceux qui auront 60 ans dans 30, 40 ou 50 ans, la problématique risque de ne pas être celle de partir à la retraite mais celle de survivre dans un monde invivable. Il s’agit avant tout d’une question de priorisation : si on ne se préoccupe pas de la question climatique, il risque de ne pas y avoir de retraite du tout. Mais au-delà de l’argument de l’urgence, d’autres éléments lient la question des retraites à celle du climat et de l’environnement. Les deux sujets qui pourraient sembler d’un premier abord sans rapport sont en fait connectés.
En ce 1er mai 2023 qui n’est pas seulement la fête du travail mais une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites porté par Emmanuel Macron, nous revenons sur les principaux enjeux autour des retraites et du climat.
I. L’impact du dérèglement climatique sur le travail : la question des conditions de travail et de la pénibilité
Le dérèglement climatique a un impact sur tous les aspects de notre vie, y compris sur le travail. Les conséquences du réchauffement climatique modifient grandement nos conditions de travail et la pénibilité de certains métiers. L’exemple le plus étudié est celui des vagues de chaleur. Leur conséquences pour les travailleur·euse·s ont fait l’objet d’un rapport de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) en 2019. Selon ce rapport, la chaleur diminue la productivité dès que la température atteint les 24-26°C. Lorsqu’il fait 33-34°C, un·e travailleur·euse opérant à une intensité physique moyenne perd 50% de sa capacité de travail.
Mais c’est surtout la santé et la sécurité des personnes qui sont en jeu. L’exposition à la chaleur peut entraîner pour les travailleur·euse·s des crampes et des malaises, des coups de chaleur et des déshydratations pouvant aller jusqu’à provoquer la mort de la personne. La chaleur et le déficit de récupération lié aux températures élevées la nuit amènent une diminution de l’attention et de la vigilance et un risque plus important d’accidents. Ils aggravent également les tensions au travail, jouent sur l’humeur des personnes, sur leur tolérance vis-à-vis de collègues ou du public. Si les horaires de travail sont décalés pour s’adapter aux fortes chaleurs, cela peut interférer avec la vie privée des personnes et leurs obligations personnelles (garde d’enfant, rendez-vous, etc), ce qui ajoute à la fatigue mentale. Tous les travailleur·euse·s sont concerné·e·s (notamment du fait de la chaleur dans certains bureaux ou d’usines et de l’absence de récupération durant la nuit). D’autres éléments sont également à prendre en compte comme la plus forte volatilité de substances chimiques du fait de la chaleur (pouvant créer des risques d’inflammabilité ou d’inhalation par les personnes), ou comme le port de vêtements de protection empêchant l’évaporation de la sueur. Les personnes travaillant en extérieur dans des métiers physiques comme le BTP, les transports et l’agriculture sont particulièrement concernées. En France au cours de l’été 2022, au moins 7 personnes sont décédées dans des accidents du travail directement imputable à la chaleur, la majorité d’entre elles travaillant dans le BTP et l’agriculture.
Les vagues de chaleur ont également un impact par ricochet sur d’autres secteurs comme ceux de la santé et de l’aide à la personne. En plus de subir les conditions décrites précédemment, les travailleur·euse·s dont le métier est de soigner et d’accompagner les malades et vulnérables (enfants, personnes âgées, personnes en situation de handicap, etc) se retrouvent en première ligne face aux impacts de la chaleur. Leur charge de travail augmente.
Au-delà des vagues de chaleur, de nombreuses autres problématiques émergent. Par exemple, l’augmentation des températures moyennes amènent l’arrivée de nouvelles espèces animales et végétales sur le territoire français. Cela entraîne des risques en matière de zoonoses pour les personnes travaillant avec les animaux (vivants ou morts), en matière d’introduction de nouveaux allergènes (en particulier via les pollens) et de nouveaux agents biologiques pour les métiers de l’environnement, de l’agriculture, du transport mais aussi de la gestion des déchets. Un autre exemple réside dans la modification de la fréquence et de l’intensité des aléas climatiques. Au-delà de l’annulation d’événements et de la diminution du tourisme dans certaines zones, ces aléas créent des risques et des conditions de travail plus difficiles pour les secours et les professionnels de la remise en état des réseaux (électricité, infrastructures routières, etc). Dans un rapport publié en 2018, l’ANSES indique qu’ “à l’exception des risques liés au bruit et aux rayonnements artificiels, tous les risques professionnels sont et seront affectés par le changement climatique et les modifications environnementales”. Tout cela est clairement perçu par les travailleur·euse·s puisque 70% des répondants à une une enquête du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) publiée le 14 février 2023 considèrent que le dérèglement climatique et plus généralement la dégradation de l’environnement peut affecter la santé des salarié·e·s et des agent·e·s.
Ces conditions de travail rendues plus difficiles et pénibles détériorent la santé des personnes. Si tous et toutes sont impacté·e·s, les actifs et actives seniors le sont plus particulièrement. L’avancée en âge augmente les problèmes de santé (maladies chroniques, usures liées aux activités professionnelles répétées au fil des années, etc). Actuellement, selon l’Observatoire de la mutualité française, dans un rapport sur la santé au travail publié en février 2023, “le vieillissement de la population des salariés et le développement des pathologies chroniques qui l’accompagne se traduisent par une augmentation de la morbidité et de la durée des arrêts de travail avec l’âge. En 2017 (dernière donnée disponible), l’accentuation est très nette chez les plus de 60 ans (+ 24 jours d’arrêt maladie en moyenne, par rapport à la classe d’âge inférieure)”. Les travailleur·euse·s seniors ne seront plus toujours en capacité de continuer à exercer leur activité professionnelle dans un environnement aux risques et à la pénibilité augmentés par le réchauffement climatique. Dans son rapport de 2019 concernant les vagues de chaleur, l’OIT insiste sur le fait que les travailleur·euse·s âgé·e·s “ont une résistance physiologique plus faible à des niveaux élevés de chaleur” et explique que “pour les femmes comme pour les hommes, le vieillissement entraîne des changements dans la régulation de la température corporelle. De plus, les personnes de plus de 50 ans risquent davantage de souffrir de maladies cardio-vasculaires.” Pour l’OIT, “ces facteurs doivent être pris en compte dans la conception des mesures d’adaptation.”
Enfin, soulignons que les personnes les plus concernées par les effets négatifs de la réforme des retraites sont aussi celles qui sont le plus touchées par les conséquences du dérèglement climatique. Il s’agit des personnes exerçant les métiers les plus précaires, les métiers les plus difficiles physiquement et souvent les moins bien payés. On peut penser par exemple aux livreurs à vélo, aux plongeurs dans les cuisines, aux saisonniers agricoles, etc. Or, du fait de leur situation économique, ces personnes n’ont bien souvent pas d’autre choix que d’aller travailler malgré les conditions pouvant être dangereuses pour leur santé. Par ailleurs, cette réforme des retraites accroît les inégalités de genre. Actuellement, les femmes ont, selon la DREES, une pension de retraite de droit direct inférieure de 40% à celle des hommes. Cela est lié à des carrières souvent plus hachées car elles ont généralement la tâche de s’occuper des enfants et occupent des métiers moins rémunérateurs. Elles sont pourtant concernées par la dégradation des conditions de travail et l’augmentation de la pénibilité liées au changement climatique, du fait des vagues de chaleur mais aussi de leur surreprésentation dans certains secteurs comme les “métiers du care”. Ces actifs et actives font donc face à un véritable cumul des vulnérabilités et des risques, créant un cocktail qui impacte fortement leur fin de carrière ainsi que leur retraite.
II. La question du financement des retraites : un enjeu pour la transition écologique
En parallèle, la réforme des retraites portée par Emmanuel Macron et le gouvernement d’Elisabeth Borne favorise la financiarisation des retraites. Actuellement, en plus de recevoir une pension de retraite via le financement par répartition, les personnes peuvent – si elles le souhaitent – augmenter les sommes perçues à leur retraite par des dispositifs complémentaires correspondant à une épargne par capitalisation constituée auprès d’investisseurs et d’assureurs. Par le recul de l’âge de départ et la possible diminution des pensions, la réforme pousse les personnes à épargner pour assurer un complément à leur retraite ou pouvoir partir de façon anticipée, malgré une décote. En France, plus de 6 millions de personnes possédaient un plan épargne retraite en 2022. Cependant, là encore, la question des inégalités émerge. Ce type d’épargne n’est pas accessible à tous. Les personnes les plus pauvres n’ont pas forcément les moyens d’épargner ou préfèrent opter pour des produits financiers leur permettant de retirer l’argent immédiatement en cas de besoin.
De surcroît, la financiarisation rend les montants des retraites dépendant des marchés financiers. Or ceux-ci sont particulièrement vulnérables face au dérèglement climatique et à ses conséquences. Les aléas climatiques extrêmes peuvent avoir des impacts sur les cours boursiers et les assurances du jour au lendemain. En 2018, le think tank Asset Owners Disclosure Project estimait qu’il y avait “près de 10 mille milliards de dollars d’actifs non protégés contre les crises économiques qui seront causées par le réchauffement climatique”. Compter sur la retraite par capitalisation, c’est donc mettre en danger les pensions de millions de personnes et prendre le risque d’une paupérisation des retraités. Ce même think tank s’inquiétait de l’absence de prise en compte du changement climatique par les grands fonds de pension pourtant censés agir sur le long terme en gérant l’épargne salariale sur plusieurs dizaines d’années avant que les personnes prennent leur retraite. Devant cette absence de préparation et de mesures concrètes d’adaptation, le Forum Économique Mondial, dans son rapport “Global Risk Report 2020”, souligne : “les fonds de pension risquent d’être confrontés à des déficits catastrophiques en raison de la consolidation et de la transition des industries”.
La capitalisation est également problématique si elle permet de continuer de financer des projets et activités particulièrement émetteurs en gaz à effet de serre, ce qui est actuellement le cas. Nombre d’acteurs financiers continuent d’investir dans les énergies fossiles avec l’argent déposé par les épargnants. Certains acteurs majeurs dans l’épargne des retraites, français et européens comme Swiss Life ou mondiaux comme Blackrock, n’ont d’ailleurs pris aucun engagement concernant la sortie du charbon ou du pétrole, voire sont même accusés de faire obstacle à la transition écologique. Ils participent de ce fait à la crise climatique et environnementale.
III. Emploi, âge de la retraite, nombre de trimestres cotisés… Travailler moins et mieux pour limiter les émissions de gaz à effet de serre
Le consensus scientifique est clair : les changements climatiques en cours sont d’origine anthropique. Les activités humaines et les émissions de gaz à effet de serre qui en découlent sont la cause principale du réchauffement climatique par rapport à l’ère pré-industrielle et des importantes dégradations de l’environnement, y compris l’effondrement de la biodiversité. La solution mise en avant par les scientifiques, en accord avec les gouvernements qui participent à l’élaboration des rapports à destination des gouvernants, est la transformation systémique de notre société. Cela passe par repenser nos modes de production et de travail – et donc aussi nos retraites.
La première problématique est celle liée à l’absence actuelle de mesures concrètes suffisantes concernant la limitation du réchauffement climatique et une transition écologique juste. De nombreuses organisations alertent : en l’absence d’adaptation au changement climatique, de très nombreux emplois seront purement et simplement supprimés. Or, sans emploi, les personnes auront des difficultés à cotiser le nombre de trimestres nécessaires pour partir à la retraite à taux plein ou n’auront pas eu suffisamment de revenus au cours de leur carrière pour assurer une pension de retraite suffisante pour vivre dignement.
A l’inverse, s’engager dans la lutte contre le réchauffement climatique et une transition juste permettra la création d’emplois, notamment d’emplois dits “verts”, et de limiter la perte d’emplois. Cela correspond aussi aux aspirations des salarié·e·s puisqu’une récente étude de l’Unédic montre que 8 actifs sur 10 souhaitent que leur travail soit en adéquation avec la lutte contre le changement climatique.
Au-delà de faire évoluer nos modes de production et le travail qui les accompagne vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement et du climat – et donc de travailler mieux, il s’agit aussi de diminuer nos activités et notre temps de travail – travailler moins pour produire moins. Les recherches sont encore peu nombreuses sur ce sujet mais celles qui existent concluent majoritairement à une baisse de l’empreinte écologique et des émissions de gaz à effet de serre lorsque le temps de travail diminue. Plusieurs facteurs sont mis en avant : la diminution du temps de travail permettrait de diminuer la consommation d’électricité, de limiter les déplacements (trajets domicile – travail), de changer les manières de consommer (cuisiner plutôt que consommer des plats ultra-transformés par exemple), d’améliorer la santé, etc. Si cela s’applique au temps de travail hebdomadaire, cela est également valable à l’échelle d’une carrière. Dans un rapport publié en décembre dernier, l’OIT présentait la retraite anticipée comme l’une des solutions pour une transition juste.
Climat et travail, un lien encore sous-estimé
La question climatique apparaît comme un véritable angle mort de la réforme des retraites. Il est pourtant essentiel de repenser le travail et la retraite dans une optique de limitation du dérèglement climatique et d’adaptation aux impacts de ces changements. La question des retraites qui est par essence un enjeu de long terme ne peut plus aujourd’hui être pensée en dehors des problématiques climatiques et environnementales. Au contraire, elle doit non seulement les prendre en compte mais faire partie des stratégies étudiées pour lutter contre le réchauffement climatique, assurer une transition écologique juste et renforcer l’adaptabilité de notre société.
Pour aller plus loin !
Etes-vous incollable sur le travail et les impacts du changement climatique ? Testez vos connaissances avec notre quizz spécial 1er mai !
(Re)lisez le n°16 de notre revue IMPACT sur le travail et le changement climatique !