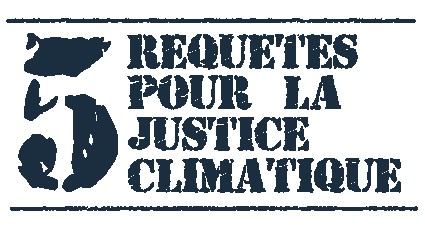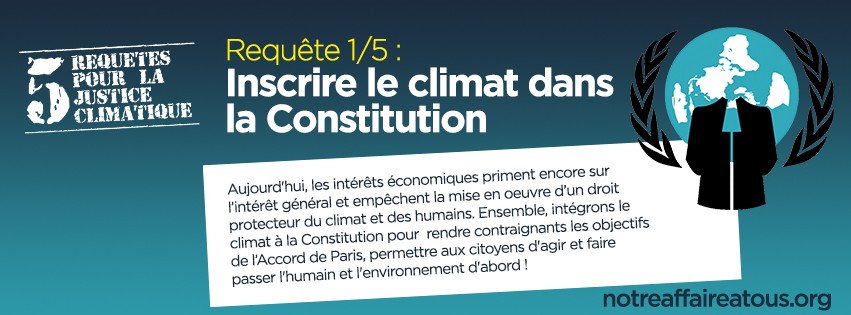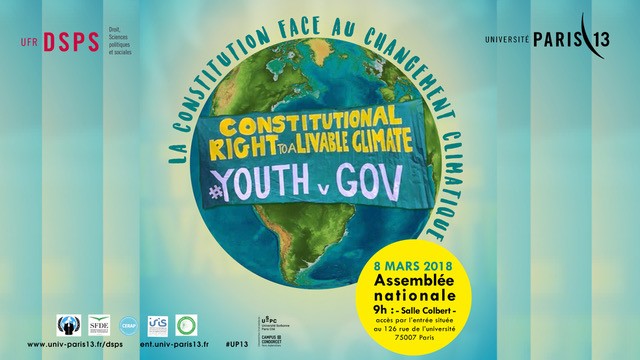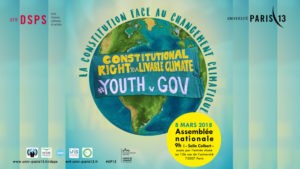Ce vendredi 3 novembre, nous avons réuni de nombreux porteurs de recours climat autour de la planète auprès des meilleurs juristes français afin d’étudier la manière dont la France répond aujourd’hui ou non à son ambition d’être leader du climat. Retrouvez ici notre dossier de presse.
Lors de l’Accord de Paris en décembre 2015, les Etats du monde se sont engagés à protéger le climat. En France, en juillet 2017, le Ministre de l’environnement Nicolas Hulot annonçait ainsi un grand plan climat visant à atteindre la neutralité carbone en 2050. En portant le projet d’un Pacte international contraignant pour l’environnement et en invitant la communauté internationale à Paris le 12 décembre prochain, le Président de la République Emmanuel Macron affirmait l’ambition de la France d’être la force motrice au niveau international de la protection du climat !
Juristes, étudiant-es, chercheurs-ses, associations ou citoyen-nes, nous leur disons : Chiche ! Faisons de la France le pays ayant le droit le plus ambitieux en matières climatique et environnementale !
Partout dans le monde, des citoyen-nes et des juges se sont saisi-es de la question climatique et ont intenté des actions en responsabilité vis-à-vis des gouvernements et des multinationales les plus pollueuses. Ensemble, nous avons étudié les blocages et impasses actuelles de la protection du climat : supériorité des normes commerciales ou de la liberté d’entreprendre vis-à-vis de notre environnement, interprétation trop souple des valeurs et droits fondamentaux, manque d’audace pour désigner les responsables de la dégradation de l’environnement… Notre souhait est d’initier un changement profond de notre droit pour qu’il tienne véritablement compte du climat !
Nous portons donc à la connaissance du chef de l’Etat ces cinq premières revendications pour initier véritablement la révolution démocratique, sociale et environnementale que nécessite la protection du climat. Dans le cas où nous serions entendu-es, nous fournirons une nouvelle liste de propositions à intégrer dans notre droit. Dans le cas où nous ne serions pas entendu-es dans les trois mois, nous aurons alors obligation d’entamer une action en responsabilité de l’Etat français pour manque d’action face au réchauffement climatique.
Notre affaire à tous
Inscrire le climat dans la Constitution !
Aujourd’hui, les juges et législateurs considèrent que la liberté d’entreprendre et le droit de propriété sont plus importants que les dispositions en matière de protection de l’environnement. C’est la position tenue par le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi de Nicolas Hulot mettant fin aux hydrocarbures, les arguments utilisés quant à l’adoption du traité de libre-échange avec le Canada CETA, ou encore les arguments utilisés dans l’affaire du glyphosate…
Nous devons intégrer à nos valeurs fondamentales la supériorité de la protection du climat sur les enjeux économiques ! En intégrant le climat à la Constitution, nous rendrons obligatoire la protection des populations et des écosystèmes victimes du réchauffement climatique et les objectifs de l’Accord de Paris de le limiter à 1,5/2°C. En Autriche, un groupe de citoyen-nes a gagné en première instance contre l’agrandissement de l’aéroport de Vienne, car les émissions induites sont contraires aux objectifs de l’Accord de Paris. Notre proposition vise à permettre d’interdire les projets nuisant au climat et entraînant une augmentation forte des émissions de gaz à effet de serre.
Inscrire le climat dans la Constitution ouvrirait enfin une nouvelle page de la démocratie dans notre pays, en permettant aux élu-es de mettre fin à des activités économiques dès lors qu’elles sont contraires aux obligations de protection de l’environnement et de notre santé.
Reconnaître le changement climatique comme un crime d’écocide !
Le changement climatique conduit la planète vers un état auquel nul n’est préparé : il met en danger nombre d’écosystèmes, la survie de nombreuses espèces animales et végétales, mais aussi nos conditions de vie, notre économie, l’habitabilité des territoires, et, de ce fait, la survie même de l’humanité. Le réchauffement climatique est aussi une atteinte à la paix, à l’origine de nombreux conflits armés : c’est la raison pour laquelle le Prix Nobel 2007 a été attribué au GIEC-Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Le GIEC recommande de ne pas dépasser le seuil de 400 ppm de CO2 dans l’atmosphère, ce seuil est d’ors et déjà dépassé et aucun cadrage juridique ne s’applique aux 100 firmes du monde, responsables de 71% des émissions de gaz à effet de serre depuis 1988 ou encore aux décideurs politiques ou financiers qui les soutiennent, et ce, en tout connaissance du changement climatique.1
Le crime d’écocide, du grec “oïkos”, la maison, et du latin “occidere”, tuer, qualifie les atteintes graves à l’écosystème de la terre, notre maison commune, capables de menacer la sûreté et l’habitabilité de la planète. Cette menace peut être déterminée scientifiquement grâce au concept des limites planétaires, limites à ne pas dépasser si l’humanité veut pouvoir se développer dans un écosystème sûr, c’est-à-dire évitant les modifications brutales et difficilement prévisibles de l’environnement planétaire. Le changement climatique, l’une des 9 limites planétaires définies par le Stockholm Resilience Center et reconnue par l’ONU, est qualifié par une concentration atmosphérique en CO2 comprise entre 350 ppm et 450 ppm. Transgresser en connaissance de cause cette limite constitue incontestablement, un des crimes parmi les plus graves.
Reconnaître toute décision industrielle ou politique conduisant à transgresser la limite climatique comme un crime d’écocide permettra de prévenir et réparer les atteintes majeures au climat, et de pénaliser celles et ceux dont les actions contribuent au changement climatique, notamment les dirigeant-es de firmes multinationales, qu’elles soient françaises ou non via l’attribution de la compétence universelle aux tribunaux français.
Permettre aux citoyen⋅nes de défendre le climat en justice
Le climat se réchauffe et les citoyen-nes en sont les victimes, en premier lieu les plus vulnérables. Pourtant, aucun mécanisme ne leur permet réellement aujourd’hui de garantir l’application de l’Accord de Paris, ni même de dénoncer les responsables, que ce soient des personnes privés (entreprises, gestionnaires de fonds ou associations) ou des personnes publiques (Etats, collectivités, institutions internationales…).
La reconnaissance du préjudice écologique et la loi sur le devoir de vigilance des multinationales constituent de premières avancées. Mais au regard de l’urgence climatique, il est nécessaire de mettre en place des moyens juridiques permettant aux citoyen-nes de défendre le climat en justice.
A cet égard, la France doit :
permettre aux associations de saisir la justice pour s’assurer de la mise en œuvre de l’Accord de Paris ;
donner compétence à toute personne ayant intérêt et qualité à agir, notamment aux associations de protection de l’environnement, d’agir en cas de non respect du devoir de protection de l’environnement ;
élargir la notion de préjudice écologique afin d’y intégrer le changement climatique, indépendamment de ses effets, et l’adosser à une compétence universelle du juge français ;
faciliter et élargir l’action de groupe environnementale, pour qu’elle puisse s’appliquer au climat et que les citoyen-nes puissent agir contre des collectivités publiques ou des acteurs privés.
Réduire vraiment nos émissions !
L’Ademe (Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) tire la sonnette d’alarme : la France est sur les mauvais rails pour atteindre ses objectifs de réduction de 40% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau en 1990 d’ici 2040. Mais il y a bien pire ! : la France n’est à ce jour pas contrainte de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre importées. Or, entre 1995 et 2015, les émissions de CO2 de la France, si on y intègre les émissions de CO2 importées, ont augmenté ! Contrevenant ainsi à l’ensemble de nos obligations nationales et internationales.
Nous souhaitons une loi contraignant notre pays à réduire ces émissions importées et les intégrer aux objectifs généraux. Cette stratégie permettrait notamment d’éviter la substitution d’énergies fossiles produites hors de notre territoire aux exploitations dont la fermeture est prévue pour 2040 par la loi Hulot sur les hydrocarbures.
Réguler l’activité des multinationales et sortir la finance des énergies fossiles
La France est aujourd’hui plus que timide dans la régulation légale et fiscale des acteurs économiques et financiers. Plusieurs années de suite, le grand producteur de pétrole et d’énergie fossile Total a ainsi été exonérée d’impôts et reçoit chaque année plusieurs milliards d’euros via le CICE…
Sans être le seul exemple, le cas des énergies fossiles et notamment du pétrole est éloquent : si nous voulons limiter le réchauffement climatique à 1,5/2°C tel que nous y incitent l’Accord de Paris et le GIEC, nous devons laisser jusqu’à 80% des ressources fossiles aujourd’hui connues dans le sol, nous indique l’Agence internationale de l’énergie. C’est-à-dire : cesser de produire des énergies sales. Or, aujourd’hui en Europe, ce sont 112 milliards d’euros qui sont annuellement dépensés dans ces énergies, dont 4 milliards d’aide directement fournis par l’Union européenne à l’extraction, et de très nombreuses subventions supplémentaires allouées à ces énergies. Selon le FMI, les subventions directes et indirectes aux combustibles fossiles s’élèvent dans le monde à 5340 milliards de dollars par an. Soit 168 000 dollars par seconde.
L’Etat français se considère pionnier et responsable en ayant mis en place, à travers l’article 173 de la loi portant transition énergétique, une obligation de publication des émissions de gaz à effet de serre. Mais il possède toujours des fonds investis dans les énergies fossiles, n’associe à l’article 173 aucune peine ou amende et n’oblige aucunement les entreprises non gestionnaires de fond à adopter des stratégies contraignantes de protection du climat.
Le droit international, notamment le Pacte des droits économiques, sociaux et culturels, nous oblige pourtant à agir, au maximum de notre capacité, sur notre territoire, afin de protéger et d’atteindre le respect de nos droits. Cela passe par l’encadrement des activités des acteurs privés via des outils pouvant être légaux ou fiscaux.
La France doit au plus vite sortir l’ensemble de l’argent public, celui des citoyen-nes, des énergies fossiles (CDC, BPI, etc). Elle doit obliger l’ensemble des acteurs privés à s’inscrire dans des schémas d’investissement 1,5/2°C compatibles et contraindre les entreprises et banques françaises à mettre un terme ) leurs activités et à leurs investissements dans les énergies fossiles.
1 rapport de l’ONG Carbon Disclosure Project (CDP) réalisé en collaboration avec le Climate Accountability Institute (CAI) à partir du rapport de l’équipe de chercheurs de Richard Heede.