Le 6 juillet dernier, Brut revenait, avec Valérie Cabanes, sur la reconnaissance des écocides et la prévention/pénalisation des crimes contre l’environnement.
Parce que « Ceux qui commettent ce crime détruisent les conditions vitales pour tous ».

Le 6 juillet dernier, Brut revenait, avec Valérie Cabanes, sur la reconnaissance des écocides et la prévention/pénalisation des crimes contre l’environnement.
Parce que « Ceux qui commettent ce crime détruisent les conditions vitales pour tous ».

Ce vendredi 3 novembre, nous avons réuni de nombreux porteurs de recours climat autour de la planète auprès des meilleurs juristes français afin d’étudier la manière dont la France répond aujourd’hui ou non à son ambition d’être leader du climat. Retrouvez ici notre dossier de presse.
Lors de l’Accord de Paris en décembre 2015, les Etats du monde se sont engagés à protéger le climat. En France, en juillet 2017, le Ministre de l’environnement Nicolas Hulot annonçait ainsi un grand plan climat visant à atteindre la neutralité carbone en 2050. En portant le projet d’un Pacte international contraignant pour l’environnement et en invitant la communauté internationale à Paris le 12 décembre prochain, le Président de la République Emmanuel Macron affirmait l’ambition de la France d’être la force motrice au niveau international de la protection du climat !
Juristes, étudiant-es, chercheurs-ses, associations ou citoyen-nes, nous leur disons : Chiche ! Faisons de la France le pays ayant le droit le plus ambitieux en matières climatique et environnementale !
Partout dans le monde, des citoyen-nes et des juges se sont saisi-es de la question climatique et ont intenté des actions en responsabilité vis-à-vis des gouvernements et des multinationales les plus pollueuses. Ensemble, nous avons étudié les blocages et impasses actuelles de la protection du climat : supériorité des normes commerciales ou de la liberté d’entreprendre vis-à-vis de notre environnement, interprétation trop souple des valeurs et droits fondamentaux, manque d’audace pour désigner les responsables de la dégradation de l’environnement… Notre souhait est d’initier un changement profond de notre droit pour qu’il tienne véritablement compte du climat !
Nous portons donc à la connaissance du chef de l’Etat ces cinq premières revendications pour initier véritablement la révolution démocratique, sociale et environnementale que nécessite la protection du climat. Dans le cas où nous serions entendu-es, nous fournirons une nouvelle liste de propositions à intégrer dans notre droit. Dans le cas où nous ne serions pas entendu-es dans les trois mois, nous aurons alors obligation d’entamer une action en responsabilité de l’Etat français pour manque d’action face au réchauffement climatique.
Notre affaire à tous
Aujourd’hui, les juges et législateurs considèrent que la liberté d’entreprendre et le droit de propriété sont plus importants que les dispositions en matière de protection de l’environnement. C’est la position tenue par le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi de Nicolas Hulot mettant fin aux hydrocarbures, les arguments utilisés quant à l’adoption du traité de libre-échange avec le Canada CETA, ou encore les arguments utilisés dans l’affaire du glyphosate…
Nous devons intégrer à nos valeurs fondamentales la supériorité de la protection du climat sur les enjeux économiques ! En intégrant le climat à la Constitution, nous rendrons obligatoire la protection des populations et des écosystèmes victimes du réchauffement climatique et les objectifs de l’Accord de Paris de le limiter à 1,5/2°C. En Autriche, un groupe de citoyen-nes a gagné en première instance contre l’agrandissement de l’aéroport de Vienne, car les émissions induites sont contraires aux objectifs de l’Accord de Paris. Notre proposition vise à permettre d’interdire les projets nuisant au climat et entraînant une augmentation forte des émissions de gaz à effet de serre.
Inscrire le climat dans la Constitution ouvrirait enfin une nouvelle page de la démocratie dans notre pays, en permettant aux élu-es de mettre fin à des activités économiques dès lors qu’elles sont contraires aux obligations de protection de l’environnement et de notre santé.
Le changement climatique conduit la planète vers un état auquel nul n’est préparé : il met en danger nombre d’écosystèmes, la survie de nombreuses espèces animales et végétales, mais aussi nos conditions de vie, notre économie, l’habitabilité des territoires, et, de ce fait, la survie même de l’humanité. Le réchauffement climatique est aussi une atteinte à la paix, à l’origine de nombreux conflits armés : c’est la raison pour laquelle le Prix Nobel 2007 a été attribué au GIEC-Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Le GIEC recommande de ne pas dépasser le seuil de 400 ppm de CO2 dans l’atmosphère, ce seuil est d’ors et déjà dépassé et aucun cadrage juridique ne s’applique aux 100 firmes du monde, responsables de 71% des émissions de gaz à effet de serre depuis 1988 ou encore aux décideurs politiques ou financiers qui les soutiennent, et ce, en tout connaissance du changement climatique.1
Le crime d’écocide, du grec “oïkos”, la maison, et du latin “occidere”, tuer, qualifie les atteintes graves à l’écosystème de la terre, notre maison commune, capables de menacer la sûreté et l’habitabilité de la planète. Cette menace peut être déterminée scientifiquement grâce au concept des limites planétaires, limites à ne pas dépasser si l’humanité veut pouvoir se développer dans un écosystème sûr, c’est-à-dire évitant les modifications brutales et difficilement prévisibles de l’environnement planétaire. Le changement climatique, l’une des 9 limites planétaires définies par le Stockholm Resilience Center et reconnue par l’ONU, est qualifié par une concentration atmosphérique en CO2 comprise entre 350 ppm et 450 ppm. Transgresser en connaissance de cause cette limite constitue incontestablement, un des crimes parmi les plus graves.
Reconnaître toute décision industrielle ou politique conduisant à transgresser la limite climatique comme un crime d’écocide permettra de prévenir et réparer les atteintes majeures au climat, et de pénaliser celles et ceux dont les actions contribuent au changement climatique, notamment les dirigeant-es de firmes multinationales, qu’elles soient françaises ou non via l’attribution de la compétence universelle aux tribunaux français.
Le climat se réchauffe et les citoyen-nes en sont les victimes, en premier lieu les plus vulnérables. Pourtant, aucun mécanisme ne leur permet réellement aujourd’hui de garantir l’application de l’Accord de Paris, ni même de dénoncer les responsables, que ce soient des personnes privés (entreprises, gestionnaires de fonds ou associations) ou des personnes publiques (Etats, collectivités, institutions internationales…).
La reconnaissance du préjudice écologique et la loi sur le devoir de vigilance des multinationales constituent de premières avancées. Mais au regard de l’urgence climatique, il est nécessaire de mettre en place des moyens juridiques permettant aux citoyen-nes de défendre le climat en justice.
A cet égard, la France doit :
permettre aux associations de saisir la justice pour s’assurer de la mise en œuvre de l’Accord de Paris ;
donner compétence à toute personne ayant intérêt et qualité à agir, notamment aux associations de protection de l’environnement, d’agir en cas de non respect du devoir de protection de l’environnement ;
élargir la notion de préjudice écologique afin d’y intégrer le changement climatique, indépendamment de ses effets, et l’adosser à une compétence universelle du juge français ;
faciliter et élargir l’action de groupe environnementale, pour qu’elle puisse s’appliquer au climat et que les citoyen-nes puissent agir contre des collectivités publiques ou des acteurs privés.
L’Ademe (Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) tire la sonnette d’alarme : la France est sur les mauvais rails pour atteindre ses objectifs de réduction de 40% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau en 1990 d’ici 2040. Mais il y a bien pire ! : la France n’est à ce jour pas contrainte de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre importées. Or, entre 1995 et 2015, les émissions de CO2 de la France, si on y intègre les émissions de CO2 importées, ont augmenté ! Contrevenant ainsi à l’ensemble de nos obligations nationales et internationales.
Nous souhaitons une loi contraignant notre pays à réduire ces émissions importées et les intégrer aux objectifs généraux. Cette stratégie permettrait notamment d’éviter la substitution d’énergies fossiles produites hors de notre territoire aux exploitations dont la fermeture est prévue pour 2040 par la loi Hulot sur les hydrocarbures.
La France est aujourd’hui plus que timide dans la régulation légale et fiscale des acteurs économiques et financiers. Plusieurs années de suite, le grand producteur de pétrole et d’énergie fossile Total a ainsi été exonérée d’impôts et reçoit chaque année plusieurs milliards d’euros via le CICE…
Sans être le seul exemple, le cas des énergies fossiles et notamment du pétrole est éloquent : si nous voulons limiter le réchauffement climatique à 1,5/2°C tel que nous y incitent l’Accord de Paris et le GIEC, nous devons laisser jusqu’à 80% des ressources fossiles aujourd’hui connues dans le sol, nous indique l’Agence internationale de l’énergie. C’est-à-dire : cesser de produire des énergies sales. Or, aujourd’hui en Europe, ce sont 112 milliards d’euros qui sont annuellement dépensés dans ces énergies, dont 4 milliards d’aide directement fournis par l’Union européenne à l’extraction, et de très nombreuses subventions supplémentaires allouées à ces énergies. Selon le FMI, les subventions directes et indirectes aux combustibles fossiles s’élèvent dans le monde à 5340 milliards de dollars par an. Soit 168 000 dollars par seconde.
L’Etat français se considère pionnier et responsable en ayant mis en place, à travers l’article 173 de la loi portant transition énergétique, une obligation de publication des émissions de gaz à effet de serre. Mais il possède toujours des fonds investis dans les énergies fossiles, n’associe à l’article 173 aucune peine ou amende et n’oblige aucunement les entreprises non gestionnaires de fond à adopter des stratégies contraignantes de protection du climat.
Le droit international, notamment le Pacte des droits économiques, sociaux et culturels, nous oblige pourtant à agir, au maximum de notre capacité, sur notre territoire, afin de protéger et d’atteindre le respect de nos droits. Cela passe par l’encadrement des activités des acteurs privés via des outils pouvant être légaux ou fiscaux.
La France doit au plus vite sortir l’ensemble de l’argent public, celui des citoyen-nes, des énergies fossiles (CDC, BPI, etc). Elle doit obliger l’ensemble des acteurs privés à s’inscrire dans des schémas d’investissement 1,5/2°C compatibles et contraindre les entreprises et banques françaises à mettre un terme ) leurs activités et à leurs investissements dans les énergies fossiles.
1 rapport de l’ONG Carbon Disclosure Project (CDP) réalisé en collaboration avec le Climate Accountability Institute (CAI) à partir du rapport de l’équipe de chercheurs de Richard Heede.
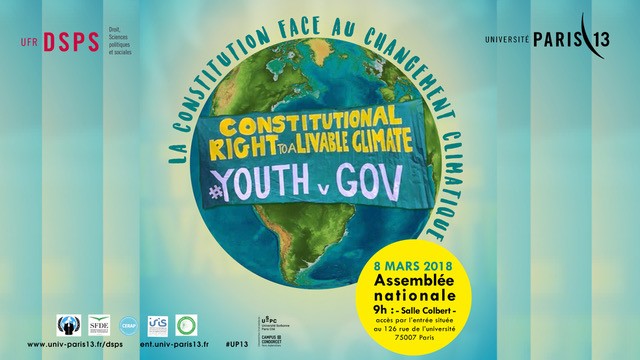
Dans le cadre de l’accord de Paris, les États se sont engagés à limiter la hausse des températures à 1,5°C. Pour atteindre un tel objectif, il est nécessaire d’amorcer une réduction drastique de nos émissions de gaz a effet de serre. Cependant, celles-ci ne cessent d’augmenter !
Face à l’urgence, les citoyen.ne.s s’efforcent de mobiliser les outils à leur disposition pour contraindre les pouvoirs publics à l’action et lutter contre les changements climatiques.

En ce début 2018, nous proposons deux conseils de lecture aux plus passioné-es !
Le « consortium ETO » regroupe de nombreuses organisations non-gouvernementales européennes autour des obligations extra-territoriales des Etats. Prenant leurs sources dans le droit international existant, notamment dans le domaine des droits humains, celles-ci ont été regroupées par de nombreux juristes de multiples pays et retranscrites en doctrine au sein des Principes de Maastricht. Le consortium cherche désormais à faire émerger ces obligations des Etats de préserver, protéger et améliorer les droits humains, au maximum de leur capacité sur leur propre territoire mais également au-delà de leurs frontières. Les rencontres organisées permettent également de mettre en débat et de créer des synergies entre la défense des différents droits : humains, sociaux, culturels ou… de l’environnement, évidemment !
ETOC Conference Europe – September 2017 – report de la dernière rencontre, qui s’est tenue les 28 et 29 septembre dernier, à Bruxelles, avec la participation de Marie Toussaint au nom d’End Ecocide on Earth et les croisements avec les recours climat.
Propositions de la Fondation pour la Nature et l’Homme pour un changement constitutionnel tenant compte des limites planétaires, colloques scientifiques de plus en plus nombreux pour transformer notre droit afin qu’il tienne compte du climat : les milieux intellectuels se saisissent de ces questions et formulent des propositions. Avec un constat : ils/elles ne sont pas toujours les forces imaginatives et créatrices les plus efficaces !
Notre affaire à tous invite donc les non-spécialistes à se saisir eux aussi de ces questions, en lien avec notre campagne pour faire vraiment faire de la France le pays leader du climat et à venir y réfléchir et les porter avec nous ! Vous retrouverez ici la brochure du projet de recherche Impulsion, mené par Mathilde Hautereau-Boutonnet, « QUEL DROIT POUR SAUVER LE CLIMAT« . De nombreuses sources de réflexion, et d’idées !
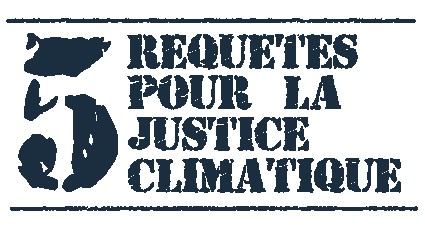
Le 3 novembre dernier, nous lancions notre campagne pour vraiment faire de la France le pays leader du climat. Nous rendons aujourd’hui publique notre lettre à l’Etat français.
A Monsieur le Président de la République,
Emmanuel Macron
A Monsieur le Premier Ministre,
Edouard Philippe
A Monsieur le Ministre de la Transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot
Objet de la demande : Changer notre droit pour faire de la France le pays leader du climat
Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Premier Ministre,
Monsieur le Ministre de la Transition écologique et solidaire,
Nous soumettons à votre haute bienveillance différentes propositions pour que l’Etat français devienne un pays leader de la lutte contre le changement climatique.
En tant que pays développé, la France a une responsabilité toute particulière dans la catastrophe climatique en cours. Au regard de cette responsabilité, mais aussi et surtout des engagements pris par la France avec l’Accord de Paris, notre pays devrait être à la fois à la pointe des politiques de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et exemplaire quant au respect de ses engagements internationaux en la matière. Nous saluons la prise de position ambitieuse de la France pour défendre l’accord de Paris, qui doit à présent être suivie de politiques à la hauteur de ces déclarations afin d’impulser une dynamique de changement pour défendre l’objectif de limitation du réchauffement climatique à 1,5°C.
Toutefois, nous pensons que le droit français actuel est inadapté à l’urgence climatique. Preuve en est : les émissions importées n’ont cessé d’augmenter depuis vingt ans, rendant notre bilan global négatif, tandis que le récent avis du Conseil d’Etat sur le projet de loi visant à interdire les hydrocarbures a souligné l’importance de conjuguer le respect des intérêts économiques et la protection de l’environnement, là où des milliers de scientifiques nous interpellent sur le peu de temps qu’il nous reste pour agir.
Cette situation est un facteur d’injustice au regard des lourdes menaces que fait peser le réchauffement climatique sur l’existence de nombreuses populations, y compris de nombreux citoyens français. Les incendies de l’été en Provence et les ouragans du mois de septembre dans les Caraïbes ont ainsi rappelé avec force que les citoyen-ne-s français-es ne seront pas épargné-e-s par les conséquences du réchauffement climatique.
C’est à vous, Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, qu’incombe la lourde responsabilité de réduire au maximum les risques que fait peser le réchauffement climatique sur la population française. Ne pas agir ni changer le droit maintenant vous exposera dans le futur à des poursuites judiciaires : lorsque des victimes françaises de catastrophes climatiques viendront engager votre responsabilité à la fois sur les plans administratif, civil et pénal.
L’Association Notre Affaire À Tous, composée de nombreux juristes et citoyens, insérée dans un réseau mondial pour la justice climatique et la responsabilité des Etats vis-à-vis du changement climatique, vous adresse ainsi ces cinq premières propositions, que nous vous invitons à mettre en oeuvre dans les plus proches délais :
1/ Inscrire le climat dans la Constitution :
Aujourd’hui, les intérêts économiques priment encore sur l’intérêt général et empêchent la mise en oeuvre d’un droit protecteur du climat et des humains. Inscrire le climat dans la Constitution permettrait de rendre contraignants les objectifs de l’Accord de Paris et ferait primer l’humain et l’environnement sur les intérêts économiques.
2/ Reconnaître le changement climatique comme un crime d’écocide :
Le changement climatique conduit la planète vers un changement irréversible de la biosphère. Or 100 firmes sont responsables à elles seules de 71% des émissions de gaz à effet de serre depuis 1988, en toute connaissance du changement climatique et ce sans craindre de sanctions légales. L’inclusion du changement climatique dans la catégorie du crime d’écocide permettrait de répondre à ce manque afin de prévenir, sanctionner et réparer les atteintes majeures portées au climat.
3/ Permettre aux citoyen-nes de défendre le climat en justice :
Le climat se réchauffe et fait déjà des victimes, avant tout parmi les plus vulnérables. Pourtant, aucun mécanisme ne leur permet aujourd’hui de défendre leurs droits, de garantir l’application de l’Accord de Paris, ni même de dénoncer les responsables, que ce soient des personnes privées (entreprises, gestionnaires de fonds ou associations) ou des personnes publiques (Etats, collectivités, institutions internationales…). Nous vous demandons de permettre aux citoyen-nes de défendre le climat en justice.
4/ Réduire réellement nos émissions de gaz à effet de serre :
La France a un objectif de réduction de 40% de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990 d’ici 2040. Or entre 1995 et 2015, les émissions de CO2 de la France ont augmenté en prenant en compte les émissions de CO2 issues de nos importations. Le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour réduire les émissions importées.
5/ Réguler l’activité des multinationales et sortir la finance des énergies fossiles :
La régulation légale et fiscale des acteurs économiques et financiers demeure insuffisante pour contraindre et orienter l’activité du secteur privé. Certaines entreprises, malgré l’incompatibilité inhérente de leur activité avec les objectifs affichés par la France, sont soutenues par l’Etat via l’exonération d’impôts et l’octroi de subventions. C’est notamment le cas du secteur des énergies fossiles qui bénéficie de 112 milliards d’euros de subventions à l’échelle européenne qui engagent les fonds publics.
Nous avons porté ces propositions à la connaissance du grand public en lançant une campagne et en publiant cette tribune dans Libération : http://www.liberation.fr/debats/2017/11/03/pour-faire-de-la-france-le-pays-leader-du-climat_1607688. Dans le cas où vous vous engageriez à les mettre en œuvre dans les trois mois à venir, nous sommes prêts à y travailler avec vous et à vous fournir de nouvelles propositions. Le climat n’attend pas.
Nous vous prions de croire Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Ministre de la Transition écologique et solidaire, en l’assurance de notre considération très distinguée.
A Paris,
Les membres de l’association notre Affaire à Tous,
Représentée par sa présidente, Marie TOUSSAINT
Marie Pochon
août 27, 2018
Marie Toussaint, présidente de Notre Affaire à Tous et membre de l’association End Ecocide on Earth, revenait pour le magazine Géo sur le combat pour la reconnaissance juridique du crime…
Lire la suite
notreaffaire
juillet 16, 2018
Le 6 juillet dernier, Brut revenait, avec Valérie Cabanes, sur la reconnaissance des écocides et la prévention/pénalisation des crimes contre l’environnement. Parce que « Ceux qui commettent ce crime détruisent les conditions…
Lire la suite
Notre affaire à tous
mai 20, 2018
Ce vendredi 3 novembre, nous avons réuni de nombreux porteurs de recours climat autour de la planète auprès des meilleurs juristes français afin d’étudier la manière dont la France répond…
Lire la suite
Dans l’émission de France Culture « La Grande table », diffusée fin octobre, Valérie Cabanes*, juriste et cofondatrice de l’association Notre affaire à tous, est venue expliquer le concept d’écocide et la nécessité de le criminaliser pour assurer la survie des générations futures. Quelques jours plus tard, elle était de nouveau l’invitée de France culture dans l’émission « Les Nouvelles vagues », aux côtés de Marie Toussaint, présidente de Notre affaire à tous et de Christophe Bonneuil, historien des sciences et de l’environnement.
 Non, le monde ne tourne pas rond. Et les illustrations de cet état de délabrement sont criantes, énumérées à l’antenne de France Culture par Valérie Cabanes, juriste, porte-parole du mouvement Ecocide on Earth et cofondatrice de Notre affaire à tous : « Nous avons franchi un certain nombre de limites planétaires, définies par le Stockholm Resilience centre en 2009, au-delà desquelles la vie n’est plus en capacité de se régénérer».
Non, le monde ne tourne pas rond. Et les illustrations de cet état de délabrement sont criantes, énumérées à l’antenne de France Culture par Valérie Cabanes, juriste, porte-parole du mouvement Ecocide on Earth et cofondatrice de Notre affaire à tous : « Nous avons franchi un certain nombre de limites planétaires, définies par le Stockholm Resilience centre en 2009, au-delà desquelles la vie n’est plus en capacité de se régénérer».
Ces limites planétaires, les voici : les principales sont le changement climatique qui est devenu irréversible et qui va devenir intolérable pour de nombreuses populations et le seuil d’érosion de la biodiversité qui a été dépassé, nous entraînant dans une 6e extinction des espèces. Celui de l’acidification de l’océan menace la vie marine. La pollution des sols et les rejets écotoxiques compromettent la santé des générations à venir. Enfin, la déforestation massive se poursuit.
Un tableau peu réjouissant qui s’accompagne d’une pluie de conséquences dramatiques. « Dans les décennies qui viennent, s’alarme Valérie Cabanes lors de l’émission « Les Nouvelles vagues », on s’attend à 60 millions de réfugiés climatiques d’Afrique subsaharienne et 250 millions dans le monde entier d’ici 2050. Et si l’on garde ce cap industriel qui nous mène vers +3° à + 4°, c’est probablement une personne sur sept devra quitter son domicile. » En cause, les sécheresses à répétition, la famine, la montée des eaux…
« Nous sommes la nature »
Face à ces prévisions apocalyptiques, la juriste exhorte à sortir d’un état de sidération, voire de déni. Surtout, il est essentiel de repenser notre rapport à la nature : « Nous sommes la nature. Il n’y a pas l’homme exclu de son environnement. L’humain est interdépendant de tous les cycles écologiques […] A partir du moment où l’on s’exclut de cet environnement-là, on se conduit d’une manière qui met en danger les conditions d’existence des générations à venir. » Plus encore, pour l’historien Christian Bonneuil, « ce que nous vivons n’est pas juste une crise écologique globale, mais un basculement géologique, un basculement pour la terre ».
 L’urgence est constituée, et les juristes de l’association Notre affaire à tous militent pour une reconnaissance de l’écocide** – terme qui désigne cette atteinte portée à l’habitabilité de la terre – comme 5ème crime reconnu par la Cour pénale internationale. « L’écocide nous oblige à sortir du champ juridique actuel, à établir de nouvelles valeurs, à créer de nouveaux sujets de droits », tels que « la reconnaissance de droits à l’écosystème terre », mais aussi la prise en compte de «l’intérêt des générations futures », développe Valérie Cabanes. Il deviendrait alors possible, grâce à un nouveau cadre juridique contraignant, d’ester en justice au nom de l’écosystème terre et au nom du droit des générations futures à jouir d’un environnement sain. Autrement dit, criminaliser l’écocide permettrait d’engager « la responsabilité pénale des dirigeants des multinationales », « discipliner les activités industrielles qui polluent et menacent de façon globale l’existence des personnes actuelles et celles à venir ».
L’urgence est constituée, et les juristes de l’association Notre affaire à tous militent pour une reconnaissance de l’écocide** – terme qui désigne cette atteinte portée à l’habitabilité de la terre – comme 5ème crime reconnu par la Cour pénale internationale. « L’écocide nous oblige à sortir du champ juridique actuel, à établir de nouvelles valeurs, à créer de nouveaux sujets de droits », tels que « la reconnaissance de droits à l’écosystème terre », mais aussi la prise en compte de «l’intérêt des générations futures », développe Valérie Cabanes. Il deviendrait alors possible, grâce à un nouveau cadre juridique contraignant, d’ester en justice au nom de l’écosystème terre et au nom du droit des générations futures à jouir d’un environnement sain. Autrement dit, criminaliser l’écocide permettrait d’engager « la responsabilité pénale des dirigeants des multinationales », « discipliner les activités industrielles qui polluent et menacent de façon globale l’existence des personnes actuelles et celles à venir ».
Bien que la bataille juridique se livre à l’échelle des grandes instances internationales, sa présidente Marie Toussaint a précisé également – à l’antenne de l’émission « Les Nouvelles vagues » – qu’à l’échelle nationale, l’association Notre affaire à tous agit aussi pour que « la France œuvre autant qu’elle le doit du fait de sa responsabilité historique pour ne pas dépasser le réchauffement planétaire de 1,5°C, ainsi que nous y incite l’Accord de Paris. »
« Pays les plus vulnérables »
Reste que les militants de ce mouvement doivent faire face aux oppositions des grandes puissances, prêtes à tout pour défendre leurs intérêts. Pour Valérie Cabanes, l’espoir repose en partie sur la Cour pénale internationale, dans la mesure où, contrairement à l’ONU, les Etats qui en sont signataires sont égaux dans leurs votes. « Or, sur les 124 Etats parties de la CPI, plus des 2/3 ont la volonté de créer un cadre contraignant pour l’activité des multinationales et des états complices ou qui les subventionnent. Pour adopter un amendement au Statut de Rome, il faut obtenir 2/3 des votes des Etats parties à la CPI ». Ainsi, « l’espoir vient des pays les plus vulnérables ». En attendant, et face aux obstacles politiques, économiques et juridiques qui se dressent, « nous demandons aux juges d’être courageux et de créer des jurisprudences, de façon à ce que le droit évolue vers la reconnaissance de l’écocide dans le droit international », enjoint la juriste.
Si le mot écocide est d’ores et déjà accepté au scrabble, le voir inscrit dans le droit international reste un défi à la charge de la société civile. Pour qu’un jour proche, des tribunaux comme celui, symbolique, qui a jugé la firme Monsanto à la Haye fin octobre 2016, deviennent enfin réalité.
Par Elodie Crézé
*Valérie Cabanes est l’auteure de l’ouvrage « Un nouveau droit pour la terre, pour en finir avec l’écocide », publié aux éditions du Seuil (2016).
** Terme employé pour la première fois en 1966 pour qualifier le crime de guerre qu’a constitué l’usage d’un défoliant appelé «agent orange», par l’armée américaine lors de la guerre du Vietnam
A écouter :
La Grande table, France culture : « Écocide : faut-il repenser les droits de la Terre ? » émission du 21 octobre 2016
Les Nouvelles vagues, France culture : « Pour en finir avec l’«écocide» » émission du 31 octobre 2016

Mardi 15 mars, les députés votaient l’inscription dans le code civil, du préjudice écologique. Pour les associations concernées et pour de nombreux juristes, ce mécanisme consacre un progrès considérable pour la protection de l’environnement.
L’amendement adopté par l’Assemblée nationale définit le préjudice écologique comme une « atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes, ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement« . Cette formulation reprend les termes de la jurisprudence Erika et permet enfin d’en solidifier les acquis.
« Inscrire l’obligation de réparation des atteintes à la nature dans le texte du code civil, c’est un événement historique et juridique majeur« , souligne Yann Aguila, avocat spécialisé en droit de l’environnement, ancien membre du Conseil d’Etat et membre du Club des juristes.
La députée Delphine Batho (SRC) a parlé d’un « mal pour un bien« , faisant référence au tollé de l’amendement gouvernemental du 1er mars dernier et au travail de collaboration avec les parlementaires et les juristes qui aura suivi. En effet, l’amendement, pointé du doigt par les associations, aurait pu signifier la fin du principe pollueur-payeur en limitant les conditions de réparation du préjudice écologique.
Au total, 60 amendements auront été déposés. Curieusement, 16 amendements portés par les députés UDI et LR ont tenté de rétablir dans le texte, les conditions d’encadrement de la réparation qui avait été proposé par le ministère de l’environnement. Ces amendements ont rapidement été écartés en séance publique, n’obtenant ni le soutien de la commission, ni le soutien du gouvernement. Autant dire que ce dernier ne tenait pas à voir revenir ces dispositions qui lui avaient valu les foudres des défenseurs des droits de la nature.
Ce court épisode de la loi biodiversité démontre à quel point la société civile est aujourd’hui mobilisée. L’association Notre affaire à tous avait réagi rapidement, en lançant une pétition en partenariat avec End Ecocide et Engage, pour réclamer la reconnaissance du préjudice écologique. Mais la vigilance reste de mise jusqu’à l’adoption définitive du projet de biodiversité, puisque le Sénat pourrait encore modifier le texte.
L’amendement adopté, introduit le principe d’une réparation prioritairement en nature des atteintes à l’environnement. A titre subsidiaire et si la réparation en nature est impossible, le juge pourra prononcer une réparation pécuniaire.
Ce mécanisme, proposé par le rapport « Mieux réparer l’environnement » du Club des juristes en 2012 et par le rapport « Pour la réparation du préjudice écologique » du groupe de travail Jégouzo de 2013, s’inscrit dans une logique de réparation et non de financiarisation du préjudice fait à l’environnement.
Afin de prendre en compte les situations où existe un obstacle de fait ou de droit à la réparation en nature du préjudice écologique, le juge pourra prononcer des dommages-intérêts. Les sommes pourront être répartis entre divers acteurs de la protection de l’environnement. On peut donc imaginer qu’en cas de marée noire, le juge pourra ainsi répartir ces montants entre une association de préservation du littoral, une association de protection des oiseaux et la collectivité territoriale en charge du nettoyage des côtes. Une flexibilité qui va donc vers plus d’efficacité dans la lutte contre les atteintes à l’environnement.
Une avancée majeure pour les associations de protection et de défense de l’environnement se prépare au Parlement. Si ce texte est adopté définitivement, il permettrait à toute personne ayant « intérêt et qualité à agir » de réclamer la réparation d’un préjudice écologique.
Pour de jeunes associations comme Notre Affaire à tous, il s’agit d’une excellente nouvelle, car le projet de loi actuel ne limite pas le droit d’agir aux associations agréées ou âgées d’au moins cinq ans (comme c’était le cas dans l’amendement gouvernemental retiré). D’autres acteurs importants, tels que les « opérateurs de compensation ou encore les agriculteurs biologiques qui ont un intérêt à la conservation des écosystèmes, pourront agir en réparation du préjudice écologique« , précise Sébastien Mabile, avocat spécialisé en droit de l’environnement.
Il s’agit d’une disposition fondamentale. La nature ne pouvant pas agir en justice pour elle-même, l’action en réparation du préjudice écologique est ce que l’on appelle une action « pour le compte d’autrui« . Pour pouvoir représenter au mieux les intérêts de la Nature, il est donc primordial que toutes les vigies de l’environnement puissent agir.
Lors des débats en séance publique, les députés écologistes ont tenté d’introduire le mécanisme de l’amende civile dans le projet de loi, en vain (PDF677). Ce dispositif aurait permis de « sanctionner plus fortement un pollueur qui a agi sciemment ou par recherche du profit, car celui-ci ne doit pas simplement être condamné à réparer, mais aussi sanctionné« , comme le rappelait le député Sergio Coronado.
L’amendement déposé prévoyait que « lorsque l’auteur du dommage a commis intentionnellement une faute grave, le juge peut le condamner au paiement d’une amende civile. Cette amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur ou aux profits qu’il en aura retirés (…) si le responsable est une personne morale, elle peut être porté à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxe« .
Mais le juge ne peut prononcer une amende civile que lorsque celle-ci est prévue dans un texte.
Le gouvernement n’a pas soutenu cet amendement, invoquant la difficulté d’articuler ce mécanisme avec le droit pénal en matière de dommage environnemental. Pourtant, les chiffres de la répression pénale en matière de contentieux de l’environnement montrent que les responsables sont rarement condamnés. La justice privilégie les mesures alternatives (régulation à la demande du parquet ou composition pénale) et ne prononce la plupart du temps que des amendes.
C’est donc pour de mauvaises raisons et on peut le regretter, que ce dispositif, qui aurait permis de dissuader les pollueurs qui profitent encore des lacunes du droit de l’environnement pour faire du profit, a été écarté.