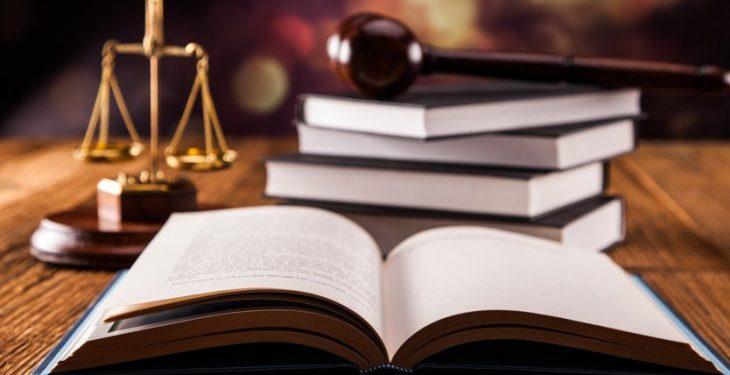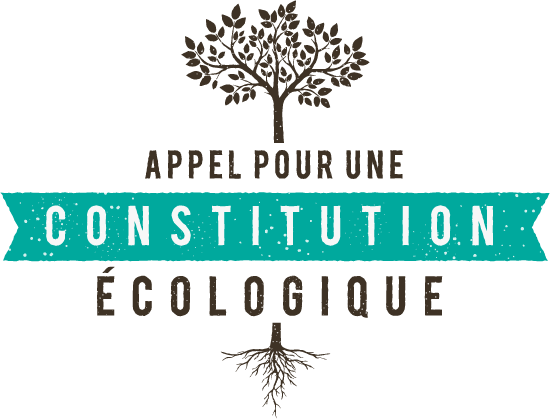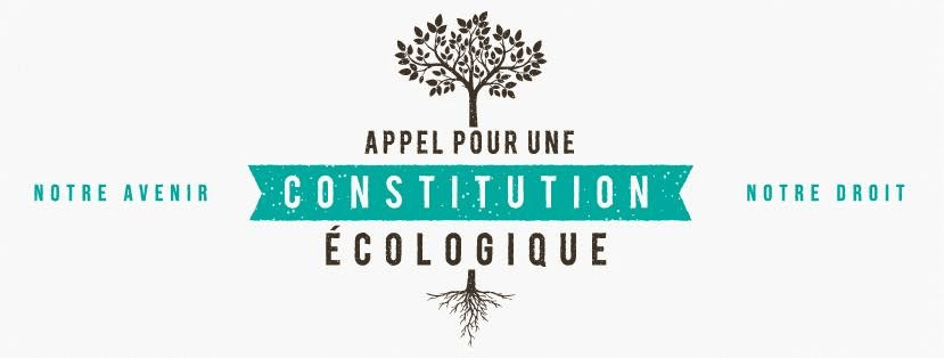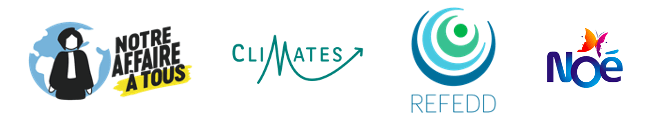Nous lançons à Lyon le quatrième recours demandant l’annulation d’un plan local sur la pollution de l’air en moins d’un an, et il n’est pas une exception : la faiblesse des plans locaux de l’État sur la qualité de l’air est systémique et persistante. Cette tribune nationale, publiée sur Le Monde à l’occasion de la Journée Mondiale de la Santé, unit des voix qui exigent de l’État qu’il se donne enfin les moyens de protéger la santé de ses citoyen.ne.s tout en intégrant réellement le paramètre de la justice sociale.

La pollution de l’air : un danger mortel invisible…
En France, la pollution de l’air est responsable de plus de 40 000 décès prématurés par an, dont plus de 4 300 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (Santé Publique France). En 2021, une étude coordonnée par l’université Harvard a même réévalué le nombre de décès prématurés en France à près de 100 000. Au-delà de cet état de fait, les études se multiplient pour montrer le lien entre la pollution de l’air et différentes maladies : asthme, maladies cardiovasculaires et pulmonaires, cancers, maladies du foie, ou d’autres maladies du type Alzheimer ou Parkinson. La pollution de l’air est ainsi avant tout une question de santé publique.
C’est également un enjeu de justice sociale. De fait, les personnes les plus vulnérables sont celles qui sont le plus exposées aux pollutions. Dans l’agglomération lyonnaise par exemple, les personnes vivant à proximité des grands axes routiers ou autour de la Vallée de la chimie, dont les revenus sont en moyenne plus faibles (Insee), sont aussi celles qui souffrent le plus de la pollution de l’air.Ces impacts ont un coût, sanitaire et socio-économique, estimé à près de 100 milliards d’euros par an en France (Sénat).
…En décalage avec l’inaction de l’Etat
Ce constat est alarmant, mais le plus inquiétant est le décalage entre les enjeux soulevés par la pollution de l’air et les mesures pour le moins insuffisantes engagées par l’Etat et ses services.
En octobre 2022, le Conseil d’Etat condamnait à nouveau l’Etat pour son inaction en matière de pollution de l’air, et plus précisément pour son non-respect des normes européennes, notamment dans l’agglomération lyonnaise. L’Etat ne fait toujours pas assez pour protéger ses citoyen·ne·s et leur offrir un air sain, conformément à l’obligation édictée par la loi sur l’air de 1996. En septembre 2022, le Conseil d’Etat reconnaissait aussi le droit de tou·te·s à vivre dans un environnement sain comme liberté fondamentale.
Pourtant, l’Etat possède plusieurs leviers d’action pour limiter la pollution de l’air, dont les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA), mis en place par les préfectures pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants. A Lyon, la deuxième version du PPA (PPA-2) avait été reconnue en 2019 comme insuffisante par le tribunal administratif. En novembre 2022, la nouvelle version du PPA (PPA-3) a été adoptée. Ce nouveau plan aurait pu être l’occasion pour l’Etat de réhausser ses ambitions contre la pollution de l’air, mais il demeure insuffisant et incohérent. En effet, peu d’objectifs sont chiffrés, les calendriers de mise en œuvre des mesures sont trop peu ambitieux et rarement précisés, et il est déjà certain que les moyens alloués par l’Etat seront insuffisants pour mettre en œuvre la totalité des mesures du PPA…
Pour toutes ces raisons, et parce que protéger la santé de tou·te·s ainsi que l’environnement devrait être la priorité de l’Etat, plusieurs associations et habitant·e·s de l’agglomération lyonnaise ont décidé de demander l’annulation du PPA-3 lyonnais, afin de faire reconnaître son insuffisance et d’en obtenir une version plus ambitieuse.
Cette problématique du PPA lyonnais n’est pas spécifique à l’agglomération : la faiblesse des plans locaux de qualité de l’air est systémique et persistante, et doit être dénoncée partout. Depuis plusieurs mois, d’autres PPA sont remis en question ailleurs : par les Amis de la Terre Marseille pour l’agglomération marseillaise, par le Collectif Citoyen 06 pour l’agglomération niçoise, par la Mairie de Grenoble pour l’agglomération grenobloise.
Nous, scientifiques, représentant·e·s de la société civile, avocat·e·s, politiques, citoyen·ne·s, appelons à des plans locaux de lutte contre la pollution de l’air réellement protecteurs. Nous demandons à ce que la pollution de l’air soit désormais considérée comme un enjeu prioritaire de santé publique et de lutte contre les inégalités sociales et environnementales. Nous exigeons un droit à respirer !
#pourundroitarespirer
Premiers signataires
Clément Drognat, Coordinateur de La Rue est à Nous – Lyon
Emma Feyeux, Présidente de Notre Affaire à Tous – Lyon
Florian Brunet, Directeur de France Nature Environnement – Rhône
Jérémie Suissa, Directeur Général de Notre Affaire à Tous
Nadine Lauverjat, Directrice Générale de Générations Futures
Tony Renucci, Directeur Général de Respire
Soutenue par :
Adrian Saint-Pol, Porte-parole de Greenpeace Lyon
Airy Chrétien, Fondateur du Collectif Citoyen 06 – Nice
Alicia Pillot, Fondatrice de PEPS’L
Anne Souyris, Maire adjointe de Paris sur la santé publique et environnementale, la lutte contre les pollutions, et la réduction des risques
Charles de Lacombe, Porte-parole d’Alternatiba ANV Rhône
Claire Dulière, Coordinatrice plaidoyer de Zéro Déchet Lyon
Dan Lert, Maire adjoint de Paris en charge de la transition écologique, de l’eau et de l’énergie
David Belliard, Maire adjoint à Paris en charge de la transformation de l’espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie
Éric Piolle, Maire de Grenoble
Frédérique Bienvenue, Co-présidente de La Ville à Vélo – Lyon Métropole
Gabriel Amard, Député de la sixième circonscription du Rhône
Hélène Leleu, Avocate au Barreau de Lyon
Isabelle Michallet, Maîtresse de conférences, Université Jean Moulin Lyon 3
Louise Tschanz, Avocate au Barreau de Lyon
Marie Pochon, Députée de la troisième circonscription de la Drôme
Marie-Charlotte Garin, Députée de la troisième circonscription du Rhône
Sandrine Berterreix, Anthony Delcambre, Marie Guirguis et Orianne Moulinier, Alliance Santé Planétaire
Sylvain Delavergne, Coordinateur de Clean Cities Campaign France
Thomas Bourdrel, Coordinateur de Strasbourg Respire
Thomas Dossus, Sénateur du Rhône