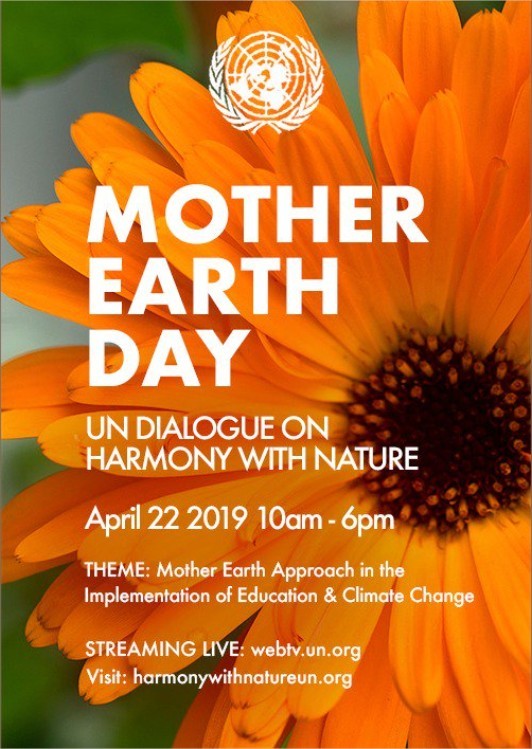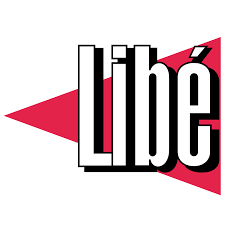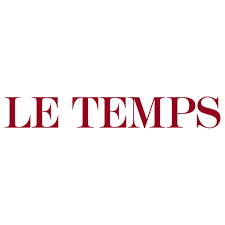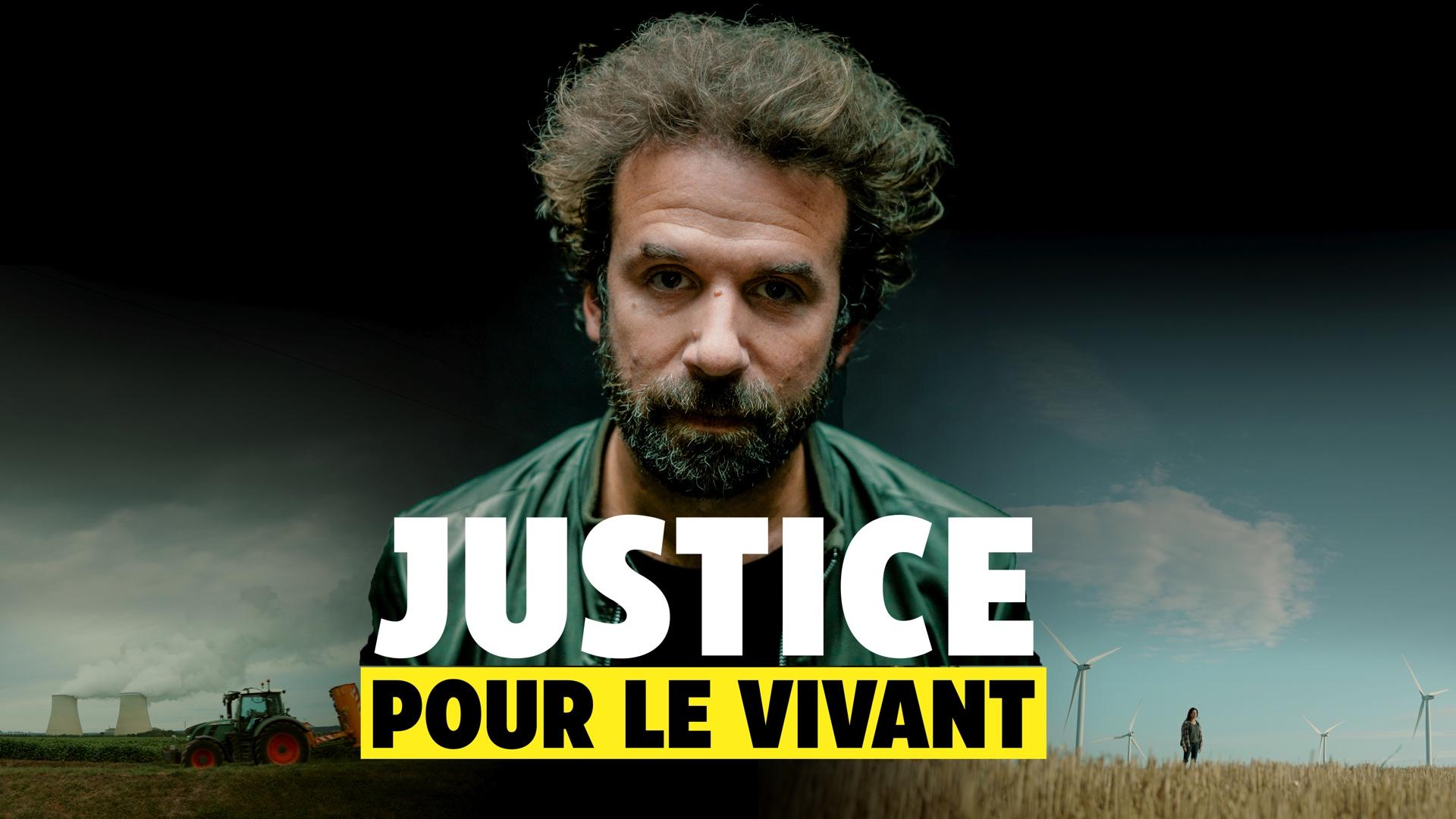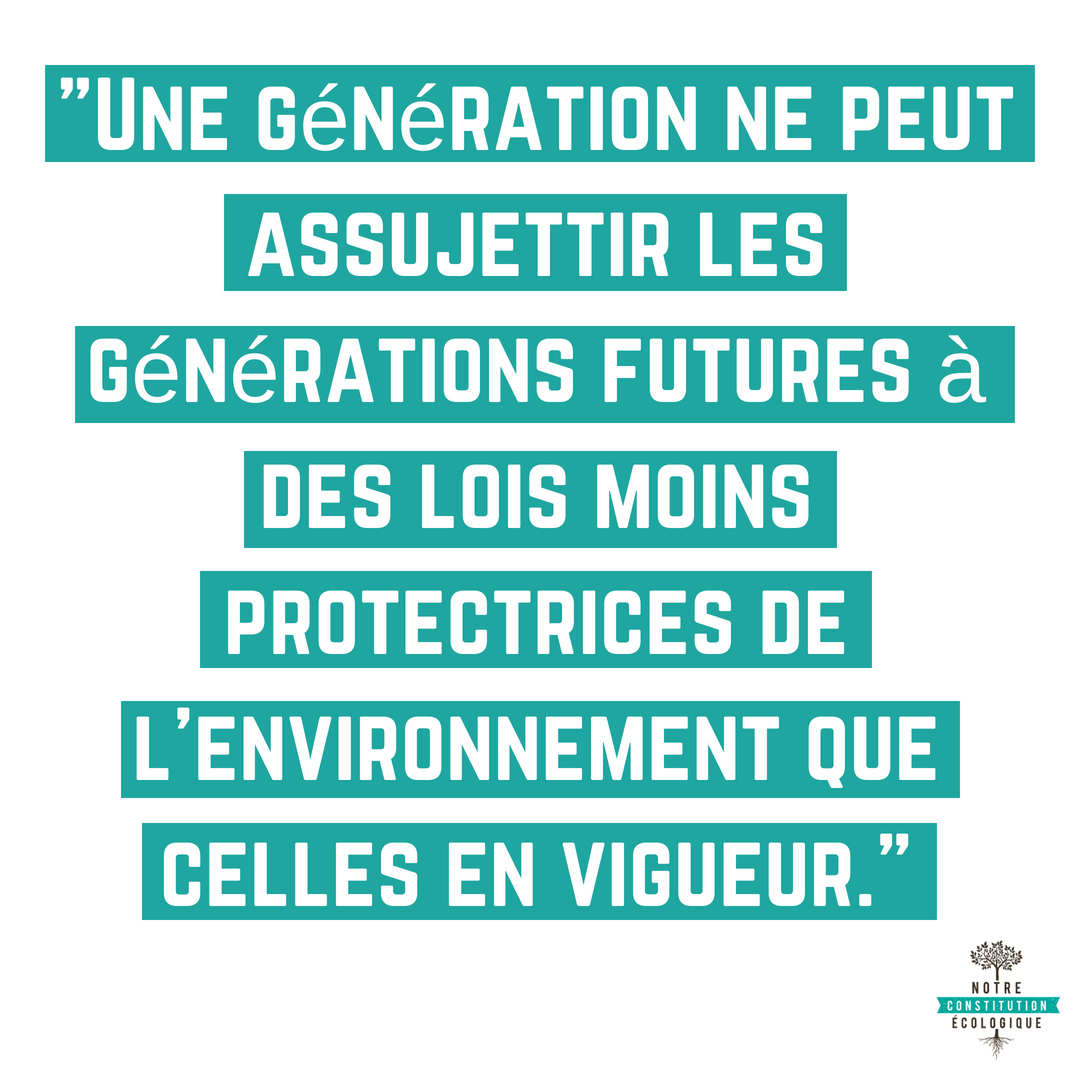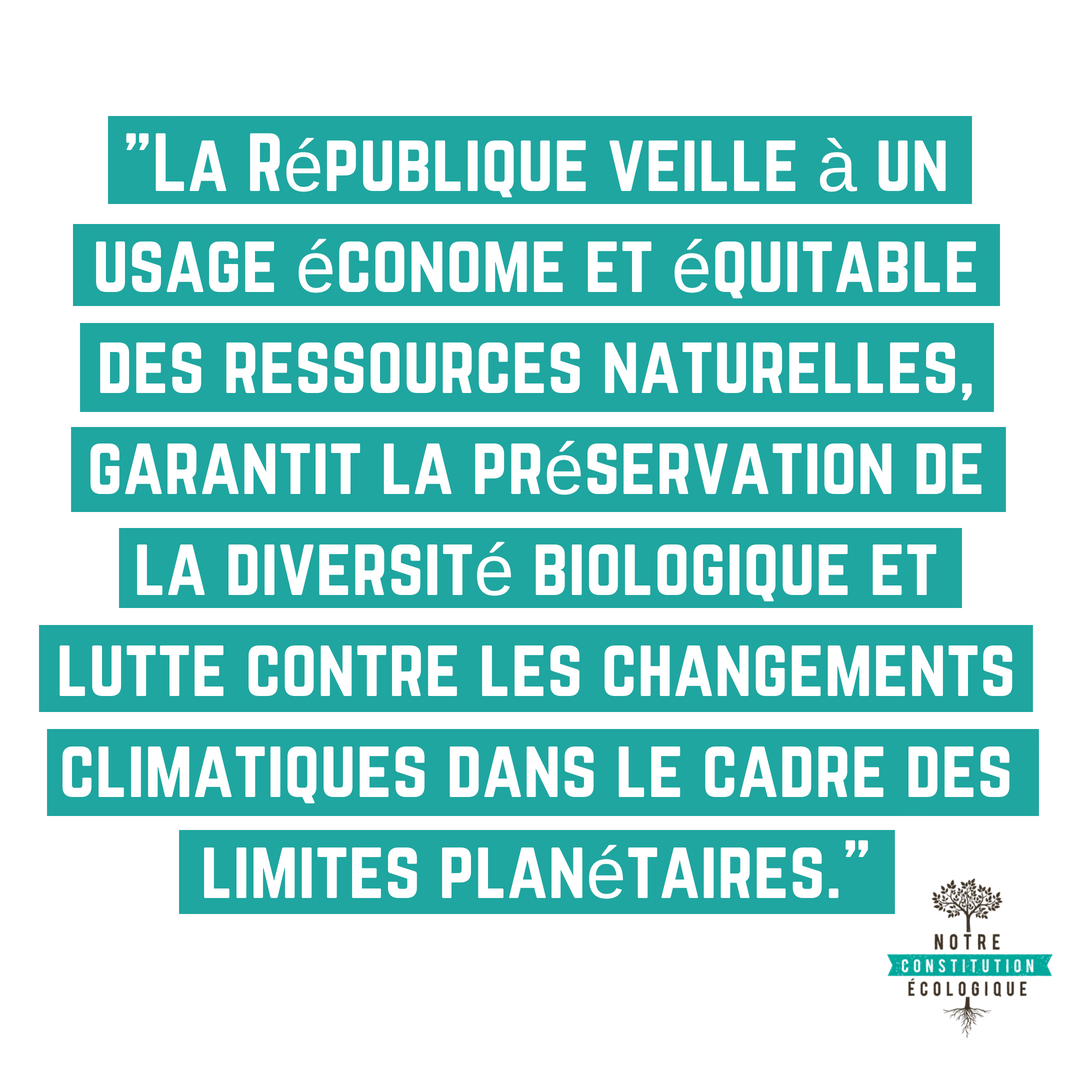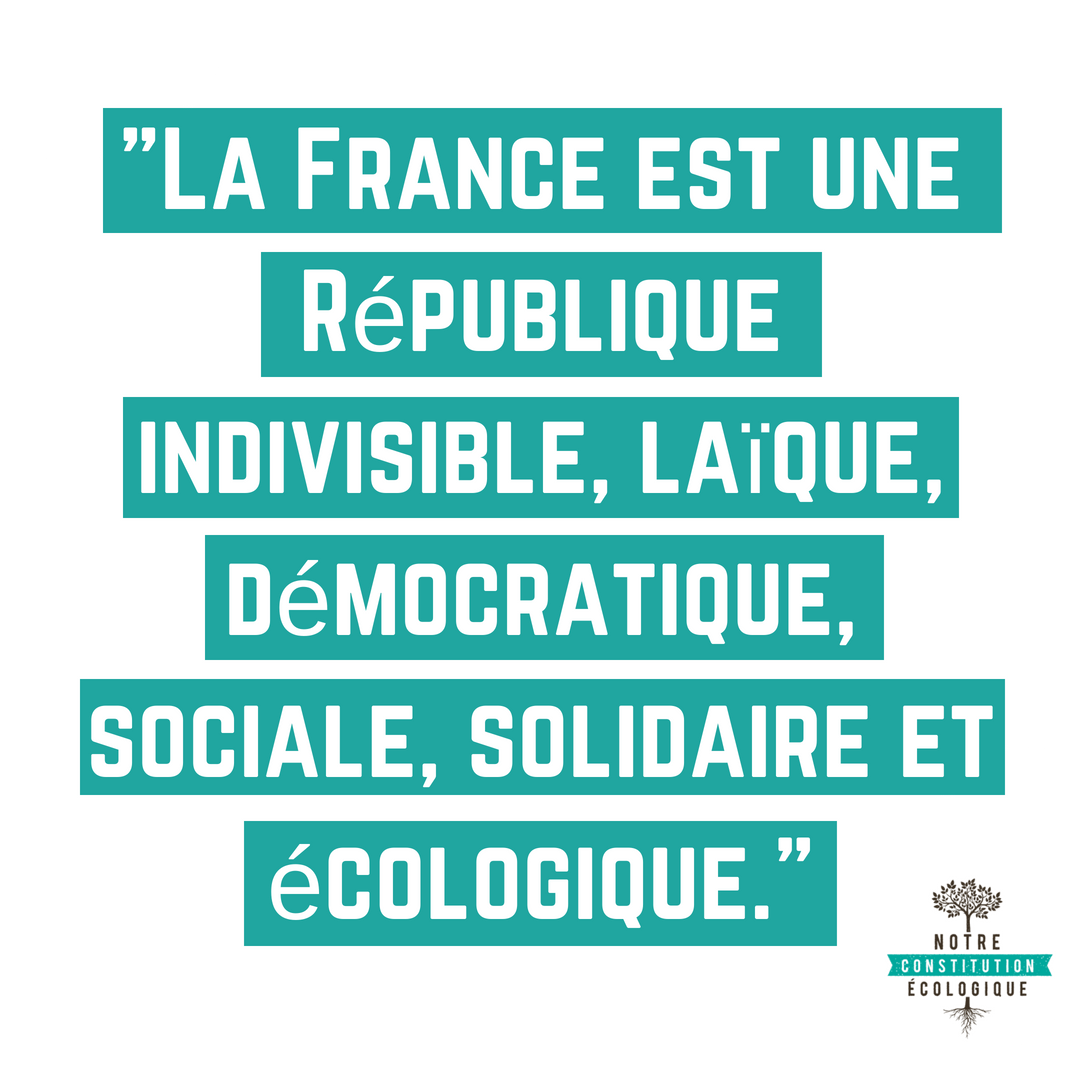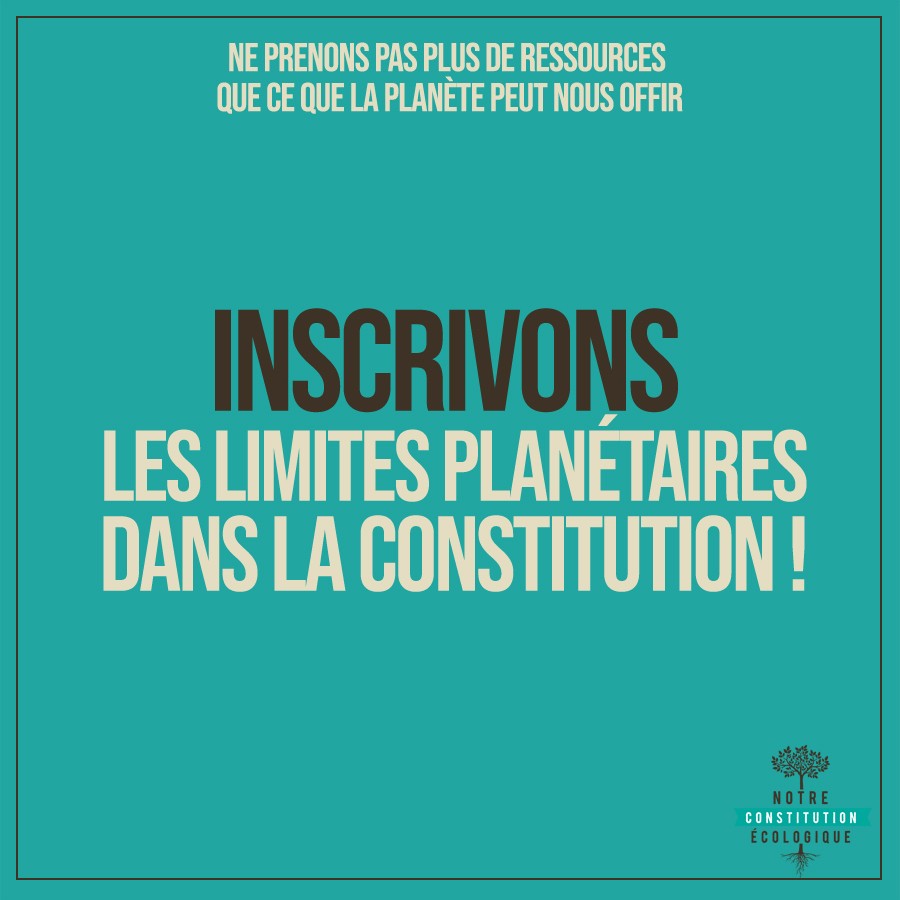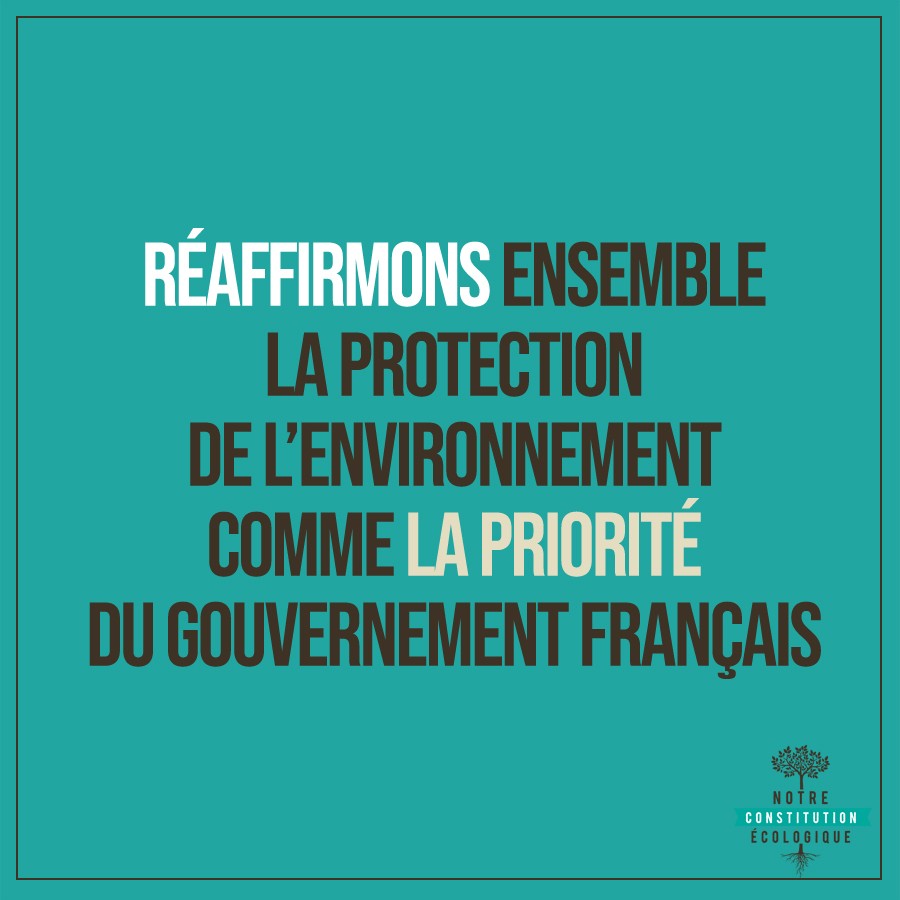La Convention Citoyenne pour le Climat est une consultation citoyenne mise en place par le gouvernement afin de donner la parole aux citoyens et citoyennes pour accélérer la lutte contre le changement climatique. Réunissant cent cinquante personnes, toutes tirées au sort, elle a pour mandat de définir une série de mesures permettant d’atteindre une baisse d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 (par rapport à 1990) dans un esprit de justice sociale.
Dans ce cadre, les associations Notre Affaire à Tous et Nature Rights ont décidé de contribuer aux travaux de la Convention Citoyenne pour le Climat en présentant une proposition en faveur de la reconnaissance du crime d’écocide et des limites planétaires.
Notre contribution
Citoyennes, Citoyens,
Selon le bulletin annuel de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) publié lundi 30 octobre 2017, en 2016 jamais la concentration dans l’atmosphère de dioxyde de carbone (CO2) n’avait atteint un niveau aussi élevé. « La dernière fois que la Terre a connu une teneur en CO2 comparable, c’était il y a 3 à 5 millions d’années : la température était de 2 à 3°C plus élevée et le niveau de la mer était supérieur de 10 à 20 mètres par rapport au niveau actuel » . Selon le secrétaire général de l’OMM, le Finlandais Petteri Taalas : « Les générations à venir hériteront d’une planète nettement moins hospitalière ».
Selon le dernier rapport spécial du GIEC de 2018, il faut diviser de près de moitié nos gaz à effet de serre (GES) en 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050 pour avoir une chance suffisamment raisonnable de prévenir un dérèglement dangereux du système climatique. Une telle trajectoire, aussi ambitieuse soit elle, nous laisserait seulement 50% de chances succès de contenir la température en dessous de 1.5°C et 85% pour limiter la température à 2°C. Dit autrement, une telle trajectoire est la seule voie possible pour nous assurer un avenir tolérable. Il faut donc agir avec volontarisme dans tous les secteurs économiques afin de soustraire la quantité requise de GES de l’atmosphère (environ 30 Gt à 40 Gt GES par an).
Or, tous les acteurs susceptibles d’agir en faveur d’une limitation drastique des émissions de GES démontrent bien peu d’efforts quels que soient leurs discours. Ni les États, ni les 100 entreprises responsables de 71% des émissions de gaz à effet de serre depuis 1988, ni les banques ne semblent prendre le cap d’une transition énergétique, encore moins celui de l’abandon de technologies industrielles dévastatrices, et ce malgré l’Accord de Paris. Selon l’ONU Environnement, les engagements pris en 2015 par les 195 pays parties prenantes de l’accord de Paris ne permettront que d’accomplir « approximativement un tiers » des efforts nécessaires et la Terre s’achemine aujourd’hui vers une hausse du thermomètre de 3 °C à 3,2 °C à la fin du siècle. Selon le rapport Carbon Majors Dataset du Carbon Disclosure Project de 2017, 50% des GES ont été émis depuis 1988, année où a été mis en place le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Malgré leur connaissance de la dangerosité de leurs activités, les grandes entreprises d’énergies fossiles n’ont cessé de freiner leur développement climaticide. Au lieu d’investir dans les énergies propres, elles ont commencé à investir dans des énergies fossiles non-conventionnelles telles que les sables bitumineux ou le pétrole de schiste, ayant un impact désastreux sur l’environnement. Selon ce rapport, si l’extraction des énergies fossiles continue au rythme des 28 dernières années, les températures devraient même augmenter de 4 °C d’ici à la fin du siècle par rapport à l’ère préindustrielle.
Les financeurs n’ont eux, jamais cessé de subventionner la recherche et l’exploitation des sources d’énergie fossiles En Europe, 112 milliards d’euros sont annuellement dépensés dans ces dernières, dont 4 milliards d’aide directement versées par l’Union européenne à l’extraction, ainsi que de nombreuses subventions supplémentaires. Selon une étude publiée par le FMI en 2015, les subventions directes et indirectes aux combustibles fossiles s’élèvent encore dans le monde à 5340 milliards de dollars par an.
Les scientifiques du GIEC affirment dans un rapport en préparation que même en contenant le réchauffement à 1,5ºC, tâche extrêmement ardue, le niveau des mers s’élèvera encore et se poursuivra pendant des siècles.
En cause principalement, la fonte des calottes glaciaires amorcée avec des températures 20° supérieures aux normales saisonnières durant les mois de novembre 2016 et 2017 en Arctique.
L’Europe devrait subir de meurtrières vagues de chaleur, des inondations, des tempêtes et autres phénomènes extrêmes qui pourraient faire jusqu’à 152.000 morts par an d’ici à la fin du siècle, contre environ 3.000 par an actuellement, selon une autre étude d’août 2017 financée par la Commission européenne.
Parallèlement le déclin de la biodiversité, constaté sur tous les continents habités du monde devrait s’accélérer. La Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (ci-après IPBES, acronyme anglais également utilisé en français) annonce qu’en Europe, 42 % des animaux terrestres et des plantes ont enregistré un déclin de leurs populations au cours de la dernière décennie, de même que 71 % des poissons et 60 % des amphibiens. Les rapports scientifiques confirmeraient que la Terre est en train de subir sa sixième extinction de masse, ce qui, selon l’IPBES « met en danger les économies, les moyens d’existence, la sécurité alimentaire et la qualité de vie des populations partout dans le monde ». De fait, les disparitions d’espèces ont été multipliées par 100 depuis 1900, soit un rythme sans équivalent depuis l’extinction des dinosaures il y a 66 millions d’années.
Pour le WWF qui a commandé une étude à deux universités australienne et anglaise, le constat global est tout aussi effroyable : si le réchauffement se poursuit jusqu’à + 4,5 °C, la moitié des espèces risqueront de disparaître d’ici à 2080 dans 35 écorégions prioritaires comme l’Amazonie, la Grande Barrière de corail, le désert de Namibie ou le delta du Mékong, des régions qui abritent nombre d’espèces emblématiques, endémiques et en danger. Or, les modèles qui simulent le mieux la période actuelle ont tendance à projeter, pour le futur, un réchauffement proche de 5°C selon une étude publiée par Nature en décembre 2017, menée par les chercheurs Patrick Brown et Ken Caldeira de la Carnegie Institution for Science.
Le changement climatique et l’érosion de la biodiversité conduisent la planète vers un état auquel nul n’est préparé : il met en danger nombre d’écosystèmes, la survie de nombreuses espèces animales et végétales et les conditions de vie de l’humanité. Il nous faudrait d’une part reconnaître non seulement la menace à la paix que représente le changement climatique, mais aussi la menace à l’écosystème Terre dans son ensemble quand il se conjugue à une érosion vertigineuse de la biodiversité. Il est temps de contraindre l’activité industrielle au respect des limites de la planète au-delà desquelles elle deviendrait inhospitalière
Dans son discours devant la communauté internationale lors de la COP23 de Bonn, le Président de la République a évoqué le franchissement du “seuil de l’irréversible” et le risque que les équilibres de la planète ne se rompent. Cet effet de seuils doit être inscrit dans le droit afin de permettre aux institutions de notre État de cadrer les activités qui menacent ces équilibres planétaires.
D’autant plus que ces seuils ont pu être identifiés et chiffrés. Une équipe internationale de 26 chercheurs, menés par Johan Rockström du Stockholm Resilience Centre et Will Steffen de l’Université nationale australienne, a identifié dès 2009 neuf processus et systèmes régulant la stabilité et la résilience du système terrestre – les interactions de la terre, de l’océan, de l’atmosphère et de la vie qui, ensemble, fournissent les conditions d’existence dont dépendent nos sociétés. Des valeurs seuils ont été définies pour chacun de ces processus ou systèmes, des limites qui ne doivent pas être dépassées si l’humanité veut pouvoir se développer dans un écosystème sûr, c’est-à-dire évitant les modifications brutales et difficilement prévisibles de l’environnement planétaire. Ces limites planétaires relèvent d’une démarche scientifique qui, élevées au rang de normes, permettraient de faire évoluer le droit vers une approche écosystémique reconnaissant notre lien d’interdépendance avec l’écosystème Terre. Nous sommes une espèce vivante impliquée dans ce réseau d’échanges de matière et d’énergie, à nous de nous comporter de façon efficace, c’est-à-dire qui n’en compromette pas le fonctionnement.
Le changement climatique et l’intégrité de la biosphère sont, selon les scientifiques, les « limites fondamentales » et interagissent entre elles. Leur franchissement nous conduit vers un « point de basculement » caractérisé à la fin par un processus d’extinction irréversible d’espèces et des conséquences catastrophiques pour l’humanité. Quand la biosphère est endommagée, son érosion impacte le climat. La couverture végétale et le sol n’assument plus leur rôle crucial de régulation climatique directe, outre de stockage et de recyclage du carbone. La déforestation entraîne la disparition locale définitive des nuages et des pluies. La perte de plancton marin enraye la pompe à carbone qu’est l’Océan. Or, l’équipe de Steffen et Rockström met de plus en garde sur le fait que depuis 2015 d’autres limites, en plus de celle du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité, sont dépassées. Il s’agit du changement d’usage des sols et de la modification des cycles biogéochimiques (phosphore et azote) et d’autres limites à surveiller : l’usage de l’eau douce, l’acidification des océans, la déplétion de la couche d’ozone, les aérosols atmosphériques, la pollution chimique (plus largement l’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère). Elles sont, elles aussi, liées ; ce qui signifie que la transgression de l’une d’entre elles peut augmenter la chance de se rapprocher d’autres limites.
Le « Rapport sur l’état de l’environnement » de l’Agence européenne pour l’environnement rendu en 2010 hisse les limites planétaires au rang de « priorité environnementale ». La Commission européenne exploite ce concept en 2011 afin de définir ses objectifs : « D’ici à 2050, l’économie de l’UE aura cru de façon à respecter les contraintes de ressources et les limites planétaires ». Ban Ki Moon, secrétaire général des Nations unies, évoque, lui aussi, lors de l’Assemblée générale de 2011 les limites planétaires comme outil de mesure scientifique. S’adressant aux dirigeants du monde, il déclare : « Aidez-nous à défendre la science qui montre que nous déstabilisons notre climat et dépassons les limites planétaires à un degré périlleux ». Le Groupe de haut niveau de l’ONU sur la viabilité du développement mondial (UN High-Level Panel on Global Sustainability) inclut alors la notion de limites planétaires (planetary boundaries) dans son rapport de 2012 nommé « Pour l’avenir des hommes et de la planète: choisir la résilience » et précise que son ambition à long terme « est d’éliminer la pauvreté, de réduire les inégalités, de faire profiter le plus grand nombre de la croissance, de rendre les modes de production et de consommation plus viables, de lutter contre les changements climatiques et de prendre en considération les limites planétaires. » Cela afin de réaffirmer « le rapport historique publié en 1987 par la Commission mondiale de l’environnement et du développement sous le titre « Notre avenir à tous » (document de l’ONU publié sous la cote A/42/427, annexe) et connu sous le nom de rapport Brundtland. »
Les limites planétaires sont définies comme suit pour:
- Le changement climatique :
- seuil à 350 ppm de CO2 dans l’atmosphère pour rester en deçà de 1° d’ici à 2100,
- Changement du forçage radiatif global depuis l’époque pré-industrielle (en watts par mètre au carré) +1 W/m2 max / actuellement +2,88 W/m2.
- L’érosion de la biodiversité : le taux d’extinction « normal » des espèces doit rester inférieur à 10 espèces par an sur un million.
- Les apports d’azote et de phosphore à la biosphère et aux océans (résultant notamment de l’agriculture et de l’élevage intensifs) :
- N(azote)= Limiter la fixation industrielle et agricole de N2 à 35 Mt/an, soit environ 25% de la quantité totale de N2 fixée par an naturellement par les écosystèmes terrestres
- P (phosphore) : < 10× = limite de flux de phosphore vers l’océan ne dépassant pas 10 fois celui de son altération naturelle au fond de l’Océan.
- Le changement d’usage des sols : Pourcentage de la couverture terrestre mondiale convertie en terres cultivées = ≤ 15% de la surface terrestre libre de glace convertie en terres cultivées.
- L’acidification des océans : Concentration en ions carbonates par rapport à l’état moyen de saturation de l’aragonite dans les eaux de surface des océans (Ωarag) = ≥ 80% par rapport à l’état de saturation moyen préindustriel, y compris la variabilité saisonnière naturelle et saisonnière
- L’appauvrissement de l’ozone stratosphérique : Concentration d’O3 stratosphérique, DU = <5% de réduction par rapport au niveau préindustriel de 290 UA.
- L’usage de l’eau douce : Consommation d’eau bleue / km3 / an sur Terre = < 4,000 km3/an
Restent à déterminer :
8. La dispersion d’aérosols atmosphériques : Concentration globale de particules dans l’atmosphère, sur une base régionale.
9. La pollution chimique (composés radioactifs, métaux lourds, composés organiques synthétiques tels que pesticides, produits et sous-produits chimiques industriels à longue durée de vie et migrant dans les sols et l’eau parfois sur de très longues distances. Les chercheurs proposent de considérer aussi l’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère comme les nanoparticules et molécules de synthèse).
Faire appliquer des limites planétaires
La reconnaissance des limites planétaires intégrées à la loi permettra au législateur mais aussi au juge d’apprécier la dangerosité d’une activité industrielle en s’appuyant sur les valeurs seuils déterminées par le Stockholm Resilience Center, et donc d’être en mesure de considérer si une activité industrielle est tolérable ou non.
Le dernier rapport sur l’état de l’environnement en France énonce “qu’outre le fait de constituer un cadre d’analyse novateur, l’approche inédite des limites planétaires correspond à la nécessité d’actualiser les informations environnementales en offrant aux citoyens et aux décideurs une compréhension plus globale de la situation nationale”.
Il est donc désormais nécessaire de doter la France d’une instance scientifiquement reconnue et compétente pour garantir l’application et le respect des limites planétaires. Elle aurait pour mission de garantir le respect des limites planétaires, de transcrire ces limites planétaires au niveau national et de réévaluer ces données de façon périodique tous les cinq ans compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
Prévoir et sanctionner les activités écocidaires
Malgré la reconnaissance du préjudice écologique en droit civil ainsi que la directive européenne 2008/99 sur l’introduction de sanctions pénales environnementales, les crimes et délits autonomes contre l’environnement ne sont toujours pas appréhendées pénalement en France. Afin d’envisager en droit national, la poursuite des atteintes aux communs planétaires ou au système écologique de la Terre, il conviendra de prévoir la possibilité d’appréhender les écocides commis sur le territoire national ainsi que dans certains cas, en dehors du territoire de la République.
Afin de prévenir le franchissement et/ou de revenir en deçà de certaines limites planétaires, comme en matière de protection du climat par un contrôle effectif des émissions d’origine anthropique. En prévoyant le retour au seuil de 350 ppm, jugé comme étant réellement le plus sûr en matière de prévention des effets du changement climatique (objectif 1°C), la reconnaissance du crime d’écocide s’appuyant sur l’instrument des limites planétaires pourrait permettre in fine de réguler drastiquement les activités polluantes, à la hauteur des enjeux environnementaux. La justice serait ainsi en capacité de rechercher la responsabilité objective de l’auteur d’activités ayant participé de manière non négligeable au franchissement des limites planétaires en tenant compte de l’intention, la négligence, la connaissance des risques encourus.
La loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre visant à lutter contre l’impunité des multinationales, adoptée en 2017 à la toute fin du mandat de F. Hollande grâce au travail et aux exigences sans relâche de la société civile, pourrait être complété de différentes façons avec une loi sur l’écocide et les limites planétaires. Avec une telle combinaison, les entreprises transnationales seraient dans l’obligation de prévenir l’écocide non seulement en France, mais également dans tous les autres pays dans lesquels elles opèrent. Un renforcement significatif de la protection de l’environnement pourrait donc être obtenue par ce biais.
Les effets concrets de la reconnaissance du crime d’écocide
Le terme “écocide” a été utilisé pour la première fois en 1972 par le Premier ministre suédois Olof Palme, pour qualifier la guerre du Vietnam et l’épandage de défoliant, l’Agent orange, par l’armée américaine sur les forêts vietnamiennes. Des manifestations avaient alors eu lieu aux Etats-Unis pour que l’écocide soit reconnu comme un crime contre la paix. Mais les tentatives ont toujours échoué, notamment à cause de la pression d’Etats comme la France, qui y voyait un risque pour le nucléaire.
Or “l’agent orange” n’est en définitive qu’un herbicide extrêmement efficace, dérivé d’autres produits largement utilisés dans l’agriculture, mais aussi comme arme de guerre, afin de détruire la végétation vietnamienne dans laquelle se cachait les Viêt-Cong. Les conséquences écologiques désastreuses furent multiples : disparition de nombreuses espèces végétales, destruction massive de la faune dont certaines espèces sont désormais menacées, voir proche de l’extinction. Ce sont donc des écosystèmes entiers qui ont été détruits, de manière irréversible pour certains même si le gouvernement a mis en place des politiques de décontamination et de reforestation.
Qui sont les responsables ?
Les sociétés chimiques ayant produit les différents agents contenus dans l’agent orange, tels Monsanto ou encore Dow Chemical, sont encore aujourd’hui leader dans les domaines de la chimie et de l’agro-alimentaire. Elle rejettent toute responsabilité arguant qu’elles n’ont fait que fournir les composés et qu’elles ne peuvent être poursuivies pour leur utilisation, imputable à l’armée américaine.
Pourtant, au Vietnam, des enfants naissent encore aujourd’hui avec des malformations dues à la pollution de l’Agent orange.
Pourrions-nous aujourd’hui créer de nouveaux outils juridiques pour faire face efficacement à des activités écocidaires ? Faire évoluer la loi, reconnaître le crime d’écocide ainsi que des normes garantissant le respect des limites planétaires, permettrait de donner de facto des droits aux générations futures en agissant en leur nom et pour la protection de leurs intérêts afin de prévenir les dommages écologiques.
La question du glyphosate est d’actualité brûlante. Suite aux procédures engagés par de nombreux agriculteurs malades, la justice américaine a, depuis quelques années, commencé à condamner Monsanto à des peines financières monumentales. Progressivement, le caractère toxique des produits massivement mis sur le marché, et contenant du glyphosate, responsable pour le développement d’affections sanitaires, tend à être reconnu. Mais s’il semble que Monsanto pourrait bien être confronté à des milliers de plaintes en raison du préjudice humain engendré, qu’en est t’il des procédures qui pourraient également être engagées pour la pollution et destruction des écosystèmes naturels ?
Face à une contamination massive de nos écosystèmes, les dispositions légales actuelles semblent obsolètes, il suffit pour cela de se référer aux récentes jurisprudences relatives aux arrêtés anti-pesticides édictés par de nombreuses municipalités et annulées par la justice. Plutôt que de compter sur une évolution lente et incertaine de la lecture du juge, de nouveaux outils, clairs et proportionnés, devraient être mis en place pour répondre efficacement aux enjeux sociétaux, sanitaires et écologiques et appréhender les comportements écocidaires pointés du doigts.
Citons un dernier exemple afin d’illustrer les enjeux de la reconnaissance des limites planétaires et du crime d’écocide :
Les gaz à effet de serre (GES) émises par l’entreprise Total s’élèvent environ chaque année à 450 Mt CO2e, ce qui représente environ 1% des GES à l’échelle mondiale. Total fait partie des 20 plus grands pollueurs actuels et historiques (cf. résultats de R. Heede et du Carbon Disclosure Project). Total a connaissance qu’elle contribue de façon substantielle, ou du moins de manière non négligeable au réchauffement climatique.
Ce comportement est-il constitutif d’un écocide ? Total, en ayant parfaitement conscience des dangers liés au changement climatique, ne change pas substantiellement de comportement et continue de croître dans dans le pétrole et le gaz, en investissant presque exclusivement (à 95%) dans les hydrocarbures (cf. p. 68 du document de référence de Total de 2018).
La reconnaissance du crime d’écocide permettrait de remédier concrètement à cette situation. Les dirigeants de Total n’auraient d’autre choix que d’adopter des mesures climatiques drastiques et de changer son modèle économique, pour se prémunir de sanctions pénales en matière d’écocide. Par conséquent, la reconnaissance du crime d’écocide permettrait donc de renforcer substantiellement la protection du climat et des écosystèmes planétaires,
Dans le cas d’un recours, le juge pourra ainsi disposer d’un outil d’appréciation indispensable pour imposer des mesures conservatoires. Un tel cadre ouvrirait la voie à une justice pénale préventive en matière environnementale, climatique et sanitaire.
Le juge devra nécessairement s’appuyer sur des éléments scientifiques en s’appuyant par exemple sur une expertise qu’il aura soit ordonnée, soit en se basant sur des éléments fournis par les parties à l’instance ou des éléments extérieurs au procès comme les avis d’autorités administratives consultées au cours de procédures antérieures. Ces éléments auront la charge d’infirmer ou de démontrer qu’une ou plusieurs des valeurs seuils pré-définies par le Stockholm Resilience Center pour chacune des limites planétaires sont en passe d’être transgressées.
Les connaissances scientifiques susmentionnés ont permis de retenir plusieurs axes de réforme législative. Actuellement, des discussions sont en cours de façon transpartisane entre parlementaires, députés et sénateurs, convaincus par l’importance de reconnaître des droits à la nature et de sanctionner le crime d’écocide afin de faire progresser le droit.
Le soutien de la société civile, notamment à travers le positionnement de la Convention citoyenne pour le Climat serait un soutien de taille. Pour l’ensemble de ces raisons, nous sollicitons une audition de la part de la Convention Citoyenne pour le Climat afin de vous présenter nos propositions.