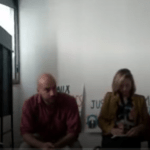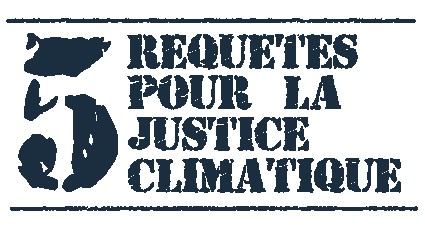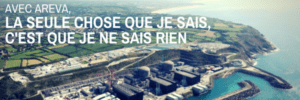Discours de Valérie Cabanes, membre fondatrice et présidente d’honneur de Notre Affaire à Tous, sur les liens entre reconnaissance des droits de la nature, l’Affaire du Siècle et la reconnaissance des droits climatiques, prononcé à l’occasion du wébinaire de l’ELGA (Ecological Law and Governance Association) en avril 2019.
Sénèque le Jeune aurait dit:
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles.«
Nous sommes tous conscients des effets du changement climatique et de ses conséquences effrayantes. Nous sommes maintenant capables d’identifier les raisons de ce changement, nous savons ce qu’il faut faire et comment limiter l’élévation des températures et les catastrophes naturelles. On nous dit comment changer notre comportement individuel et comment, collectivement, nous devrions nous attaquer au problème, mais nous croyons toujours que les moyens d’action collectifs sont uniquement entre les mains de nos représentants. Nous les regardons en tant que spectateurs, nous constatons qu’ils ne respectent pas leurs engagements, que leurs actions sont lentes et faibles. Mais alors…. devrions-nous attendre que le ciel nous tombe sur la tête?
Face aux périls qui nous menacent, chacun de nous, comme le colibri, doit intervenir pour éteindre le grand feu. Mais il est également essentiel de nous connecter afin d’agir de manière universelle. C’est la « synchronicité » de nos actions qui amènera le changement. Plus nous agirons en synchronicité, plus nous aurons confiance dans nos capacités collectives, plus nous pourrons agir comme une grande vague.
Nous ne pouvons pas simplement l’espérer, nous devons aussi l’incarner. Le philosophe Jiddu Krishnamurti l’explique différemment: «La révolution doit commencer avec vous et moi. Cette révolution, cette transformation individuelle, ne peut avoir lieu que lorsque nous comprenons la relation, ce qui est un processus de connaissance de soi ». Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est de ressentir des émotions. Dans notre vie, ce sont en effet nos pensées et nos émotions qui alimentent nos actions, qui à leur tour produisent nos résultats.
Nous devrions ouvrir notre cœur à l’empathie pour ceux qui souffrent déjà de sécheresses ou d’inondations et nous devrions aussi croire que nous pouvons réussir ensemble pour éviter le grand effondrement. Nous sommes comme un arbre: nos pensées et nos émotions correspondant aux racines. Nos actions correspondant au tronc. La densité de nos actions est proportionnelle au diamètre du tronc. Nos résultats correspondant aux fruits. La quantité de fruits symbolise celle des résultats. En France, nous avons décidé de devenir un grand arbre.
Depuis les années 60, les gouvernements français successifs ont toujours différé les décisions courageuses nécessaires pour lutter contre le changement climatique. Dans ce contexte, avant la COP21, j’ai co-fondé en août 2015 une ONG appelée Notre Affaire à Tous pour promouvoir la justice climatique, les droits de la nature et la reconnaissance de l’écocide actuel.
Étant donné que les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté depuis l’accord de Paris en 2015 en France, nous avons lancé le 18 décembre 2018 avec 3 autres ONG, la Fondation pour la nature et l’homme, Greenpeace France et Oxfam France, une campagne citoyenne intitulée « L’Affaire du Siècle » pour soutenir notre décision commune de poursuivre l’Etat français pour ne pas avoir fait assez pour le climat depuis des décennies et pour son incapacité à respecter ses engagements internationaux.
En 3 jours seulement, la pétition en ligne a été signée par 1 million de personnes, atteignant plus de 2 millions de signatures un mois plus tard, ce qui en fait la pétition la plus signée de l’histoire française. Nous avons ensuite adressé au gouvernement une demande préliminaire démontrant que l’État était inactif face au changement climatique. Ouvrant une période de deux mois pendant laquelle l’État peut choisir de répondre ou non.
Dans notre déclaration, nous avons évoqué les effets du changement climatique sur l’environnement, la santé humaine, le respect des droits fondamentaux et l’égalité sociale, tels que décrits par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son dernier rapport.
Parmi les actions jugées nécessaires pour atteindre notre objectif, nous demandons au gouvernement de réduire l’empreinte carbone de la France, d’abandonner l’utilisation de l’énergie fossile et nucléaire, tout en passant aux énergies renouvelables, d’améliorer l’efficacité énergétique et de préparer un plan national d’adaptation et d’atténuation des changements climatiques. Le 15 février, nous avons reçu une lettre officielle du ministère de la transition écologique et solidaire à l’attention des 2 millions de signataires de «L’affaire du siècle», dans laquelle nous lisions, et je cite: «Les moyens nécessaires pour répondre à cette urgence sont loin d’obtenir une adhésion évidente et systématique des citoyens ». De plus, cette lettre appellait à un changement de comportement individuel.
Pour nous, cette rhétorique semblait être de mauvaise foi et irresponsable envers les générations futures. En fait, les citoyens sont bien conscients des menaces liées au changement climatique, en particulier les jeunes, qui savent qu’ils seront ceux qui subiront les conséquences du changement climatique dans quelques décennies.
Je tiens à souligner qu’une vidéo à l’appui de «L’affaire du siècle» a été réalisée en collaboration avec deux collectifs de français YouTubers intitulés «On Est prêt» et «Il est encore temps» et elle a été visionnée plus de 14 millions de fois en ligne en un seul mois. Il est important de le mentionner car le public ciblé était principalement composé d’adolescents et de jeunes adultes. Aujourd’hui, cette même population, qui se sent de plus en plus concernée par ces questions, n’a pas non plus les moyens de faire entendre sa voix et d’influencer les décisions politiques. Devant l’inaction de leurs gouvernements, ils perdent même confiance en leurs représentants élus.
Pour cette raison, «L’Affaire du Siècle» a été perçue comme un moyen très concret et efficace de demander une action immédiate du gouvernement. À la suite de cet appel, les jeunes se sont massivement joints à la Grève climatique mondiale pour le futur, inspirée par Greta Thunberg le 15 mars de cette année, qui a mobilisé plus de 1 million et 400 000 personnes dans le monde – la plus grande marche climatique de l’histoire. Ils ont également participé à la «Marche du siècle» organisée le 16 mars en France à l’intention de tous les citoyens et réunissant 350 000 personnes.
Stimulés par ce soutien massif de la société civile et après la réponse décevante reçue du gouvernement français, nous avons pris la décision de porter l’affaire devant le tribunal administratif de Paris le 14 Mars dernier. Nous suivons clairement la voie ouverte par d’autres citoyens du monde, profondément inspirés par leur succès. Je pourrais mentionner le cas du recours de la fondation Urgenda aux Pays-Bas, où le pouvoir judiciaire a ordonné au gouvernement néerlandais de revoir à la hausse ses objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou celui des 25 jeunes en Colombie.
Comme vous en avez entendu parler, la Cour suprême colombienne a ordonné à la présidence et aux ministères de l’Environnement et de l’Agriculture de créer un «pacte intergénérationnel pour la vie de l’Amazonie colombienne», mais a également reconnu que l’Amazonie colombienne était un moyen de protéger cet écosystème vital comme «Entité faisant l’objet de droits». Ce jugement nous montre tout le chemin à faire pour traiter efficacement la question du changement climatique mais également d’autres questions écologiques telles que l’effondrement de la biodiversité, la pollution globale, la rareté de l’eau douce, l’acidification de l’océan. Les conditions de vie sur Terre telles que nous les connaissons depuis 10 000 ans sont menacées, mettant en péril la vie des générations à venir.
En France, notre prochain objectif est d’obtenir du gouvernement un amendement à la Constitution qui stipule dans son premier article que «La République garantit une utilisation durable et équitable des ressources naturelles, garantit la préservation de la diversité biologique et lutte contre le changement climatique au sein de la société. le cadre des limites planétaires. Il assure la solidarité entre les générations. Une génération ne peut pas soumettre les générations futures à des lois moins protectrices de l’environnement que celles en vigueur ».
Nous préconisons également la reconnaissance des droits sur les écosystèmes naturels. Convaincus par l’ampleur du mouvement de nos citoyens, les membres du Sénat français ont accepté de présenter un avant-projet de loi sur le crime d’écocide. En tant que membre de l’Alliance mondiale pour les droits de la nature, j’ai été invitée à une audition devant la Commission des lois. Je pense vraiment que nous devons discuter des avantages de la reconnaissance des droits des générations futures et des droits de la nature pour protéger tous les êtres vivants de l’extinction massive et des catastrophes climatiques.
Si les conditions de vie elle-même sont menacées sur Terre, comment pourrions-nous garantir la réalisation de droits humains fondamentaux tels que le droit à l’eau, à la nourriture, au logement ou à la santé?
Comment pouvons-nous espérer maintenir la paix entre les peuples et les nations?
Nous devons reconnaître le devoir de l’humanité de protéger la vie à long terme, c’est le seul moyen de garantir sa sécurité.
Nous devons également reconnaître que les écosystèmes et les communautés naturelles ont le droit d’exister et de s’épanouir, de jouer leur rôle dans la communauté de la vie sur Terre. Nous ne pouvons plus nier notre parenté avec les animaux, les plantes et les arbres, ni éviter la réalité biologique selon laquelle nous sommes des êtres de la nature.
Si notre capacité à prendre conscience de nous-mêmes nous a conduits, insidieusement, à nous imaginer extérieurs à la réalité, cette conscience individuelle devra alors s’orienter vers une conscience universelle dans laquelle tout le monde accepte d’être une simple note dans cette grande symphonie de la vie et de la société, et, au-delà, le cosmos. Tout en restant enracinés au sol.
Et cela ne peut être fait que par une conscience profonde du principe d’interdépendance qui nous lie à tous, qui nous lie à la Terre et à tous les autres êtres vivants. Nous devrions incarner une vision du monde profondément égalitaire en ce sens que chacun est reconnu dans sa fonction vitale et que chacun sait qu’il est nécessaire aux autres.
Le philosophe persan Rumi l’a résumé simplement: « Vous n’êtes pas une goutte d’eau dans l’océan, vous êtes tout un océan dans une goutte d’eau. » Cette pensée holistique est commune à de nombreuses traditions spirituelles et trouve sa source dans la sagesse des peuples autochtones. Cela leur a permis de trouver la place qui leur revient et de vivre pendant des millénaires en harmonie avec la nature.