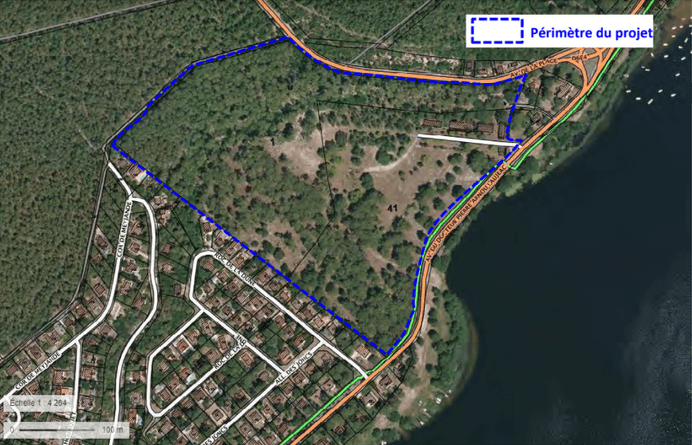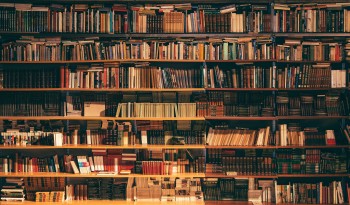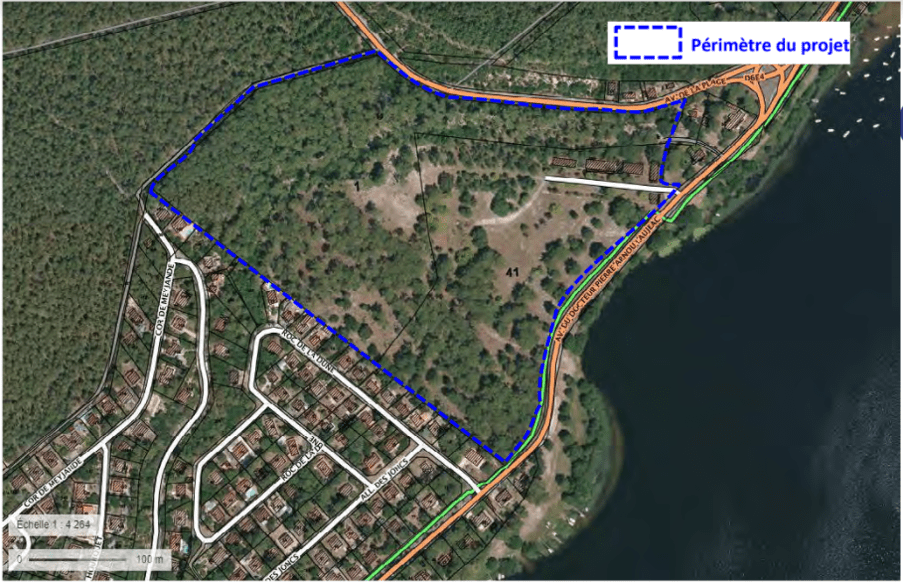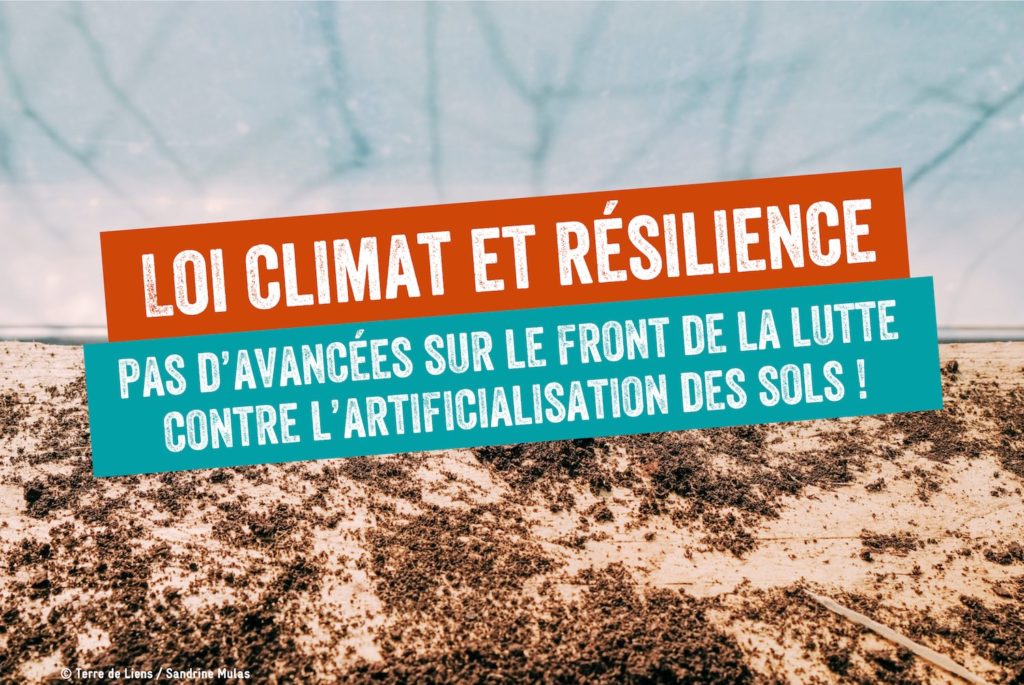La Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) estime qu’environ 1 million d’espèces sont aujourd’hui menacées d’extinction. Dans un tel contexte, il est impératif d’assurer la sauvegarde de la richesse écosystémique de notre territoire. En moyenne 27 000 hectares sont artificialisés annuellement en France, avec comme principaux responsables la construction de logements neufs et l’industrie(1). Face à ce constat, la loi Climat et Résilience de 2021 a imposé l’atteinte d’un taux d’artificialisation nette des sols d’ici 2050(2).
Concrètement, la loi impose , d’ici à 2031, une réduction de moitié du rythme d’artificialisation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) observé au cours des dix années précédant le 24 août 2021. Pour assurer une mise en œuvre adaptée et effective de cet objectif, la loi a désigné l’échelon régional comme étant au cœur de sa déclinaison. Ce sont les outils d’urbanisme infrarégionaux et locaux qui devront assurer la coordination de l’objectif ZAN au niveau régional.
Les ONG environnementalistes, dont Notre Affaire À Tous, considèrent que ce dispositif est indispensable pour limiter la destruction de la biodiversité en France et de tous les services qu’elle rend, et soutiennent une mise en œuvre rationnelle . Il ne s’agit pas de s’opposer au développement territorial, mais de mettre en place un développement équilibré qui prenne également en compte la protection de l’environnement, et la nécessité de construire des territoires résilients qui permettront d’atténuer les effets de la chute de la biodiversité.
Les collectivités territoriales, de leur côté, sont soumises à de nombreuses contraintes d’ordre économique et social, outre les enjeux environnementaux. L’objectif ZAN, tel que défini par la loi et précisé par deux décrets d’application du 29 avril 2022, a suscité de nombreuses inquiétudes pour les élu.e.s. Ils.elles dénoncent notamment une recentralisation rigide en matière d’aménagements, tant en faveur de la protection de l’environnement que pour la réindustrialisation du pays.
Les collectivités territoriales sont au cœur de l’atteinte de l’objectif ZAN, puisque ce sont elles qui devront effectuer un compromis sociétal entre développement économique, atteinte des objectifs de logements sociaux, maintien d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Face à la nécessité de préciser l’articulation entre l’atteinte de l’objectif ZAN et la prise en compte de ces enjeux, le Sénat a introduit une proposition de loi, le 14 décembre 2022, visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs ZAN au cœur des territoires. L’examen en séance entamé depuis le 14 mars ne présage rien de rassurant quant aux amendements du texte actuellement discutés.
Une proposition de loi mettant en péril l’objectif ZAN
La territorialisation nécessaire de l’objectif ZAN
Les dispositifs législatifs des vingt dernières années n’ont pas abouti à mettre en œuvre une réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles, et forestiers. En effet, ceux-ci fixaient des objectifs qui étaient insuffisamment opposables au niveau local. Ainsi les dispositifs sont devenus des objectifs généraux qui ne se sont pas appliqués sur le terrain, et l’artificialisation des sols a pu s’intensifier.
Par conséquent, il est indispensable que l’objectif ZAN soit le plus opposable possible, et soit territorialisé à petite échelle.
La loi Climat et résilience prévoit ainsi d’accorder à la région, et notamment à travers le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), d’importantes prérogatives en matière d’orientations d’aménagement pour une gestion économe des sols. Pour en assurer l’effectivité, elle impose un rapport de compatibilité avec les autres documents de planification tels que les Schémas de cohérence territorial (SCOT) ou Plans locaux d’urbanisme (PLU) non soumis à un SCOT, vis-à-vis des objectifs fixés par le SRADDET. Désormais, ces documents locaux d’urbanisme ne pourront contredire ces objectifs.
Toutefois, la proposition de loi sénatoriale prévoit de revenir sur cette évolution et d’imposer à la place un simple rapport de prise en compte, qui signifie que les documents d’urbanisme locaux ne doivent pas s’éloigner des orientations fondamentales de la norme supérieure, le SRADDET, mais pourront y déroger en justifiant de l’intérêt d’une opération particulière. Cette évolution correspondrait finalement à transformer une obligation en en simple recommandation, ce qui, en somme, reviendrait à un abandon de l’objectif ZAN.
Cette dérogation s’inscrit dans une série de dérogations envisagées par le législateur afin d’alléger le poids des contraintes pesant sur les collectivités territoriales pour atteindre l’objectif ZAN.
Une série de dérogations excessives conduisant à une dénaturation du dispositif Zéro Artificialisation Nette
La proposition des sénateurs souhaite approfondir la prise en compte des spécificités des territoires dans la mise en œuvre de l’objectif ZAN. Cette opération est délicate puisqu’elle induit le risque de rendre inopérant cet objectif à travers des dérogations qui, cumulées, annihilerait l’effort de réduction de l’artificialisation. Plusieurs points suscitent l’inquiétude des associations environnementales :
1/ Au vu des inquiétudes soulevées par les collectivités territoriales rurales, les sénateurs ont inclu une garantie rurale offrant la possibilité aux communes et EPCI de prévoir une “surface minimale de développement communal” de 1 hectare.
Ce plancher minimum de 1 hectare est trop élevé compte tenu du nombre de communes rurales concernées par cette garantie, comme l’a relevé la vice Présidente de la région Nouvelle Aquitaine l’a évoqué lors de son audition du 14 février 2023 au Sénat. Il s’agirait plutôt de mettre en place une garantie rurale évaluée, adaptée et plus restrictive afin d’encourager et de faciliter la continuité de l’effort de sobriété foncière.(3).
2/ Les sénateurs souhaitent aussi répondre aux difficultés subies par les communes et EPCI littoraux face aux recul du trait de côte rendant de nombreuses parcelles inutilisables. Le texte prévoit également que, dans les communes littorales, “les surfaces artificialisées rendues impropre à l’usage en raison de l’érosion côtière [soient] considérées comme ayant fait l’objet d’une renaturation”. De surcroît, les opérations de relocalisation ne seraient pas comptabilisées comme de l’artificialisation. Néanmoins un amendement propose que les terres délaissées fassent l’objet d’une réelle renaturation afin de garder la cohérence de stratégie de lutte contre l’artificialisation des sols, nous attendons donc beaucoup du vote à venir sur cet amendement.
Il est indéniable que les collectivités territoriales subissant la réduction progressive de leur territoire à cause du phénomène d’érosion côtière doivent absolument être accompagnées, notamment au regard de l’atteinte de l’objectif ZAN. La réalisation de cet objectif est, nous le rappelons, indispensable pour enrayer la perte dramatique de la biodiversité et faire face aux effets déjà ressentis du changement climatique.
Ainsi, l’enjeu est double : soutenir financièrement les travaux de renaturation et désimperméabilisation des terres perdues, et repenser l’aménagement des territoires dans le cadre de la relocalisation. La proposition de loi doit prendre en compte ces enjeux, sous peine d’accélérer le rythme d’artificialisation sur le littoral et faillir à l’objectif ZAN.
3/ La territorialisation de l’objectif ZAN soulève la problématique de la prise en compte des projets d’ampleur ou d’intérêt national. Dans un souci d’équité entre les territoires, la proposition de loi prévoit que les projets d’intérêt national majeur ne soient pas intégrés et fassent l’objet d’une comptabilisation séparée afin de ne pas pénaliser les seuls territoires qui les accueillent.
Cette justification est compréhensible, mais il est impératif que ces projets soient limitativement énumérés, et non présumés comme étant d’intérêt national majeur comme le prévoit le texte. Or, l’enveloppe nationale prévue est beaucoup trop large car y inclut beaucoup de types de projets, qui se revendiqueront tous d’intérêt national majeur pour échapper à la comptabilisation régionale, À plus forte raison, les amendements votés élargissent d’autant plus le périmètre de cette enveloppe nationale, par exemple avec les projets industriels « représentant un intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne », ou les projets internationaux, nationaux, interrégionaux. En somme, l’intérêt économique prend encore plus de place dans la mise en concurrence entre développement économique et protection de l’environnement, et relève désormais d’un intérêt national majeur (nouvelle notion juridique) alors que l’effondrement de la biodiversité est déjà alarmant.
En outre, la comptabilisation de cette enveloppe isolée est très floue, et l’on se demande comment l’objectif ZAN va être respecté en instaurant une trajectoire parallèle aux régions, qui comprend autant de projets structurants et consommateurs de terres. Cela est à mettre en relation avec la garantie rurale, qui aurait en soi pu être souhaitable si les projets d’ampleur étaient comptabilisés strictement.
En somme, cette proposition de loi souhaite introduire un ensemble de régimes dérogatoires, qui certes prennent en compte les spécificités des territoires, mais pour autant complexifient et mettent grandement à mal la mise en œuvre du ZAN. L’accentuation de la territorialisation de cet objectif doit se faire sans pour autant dénaturer le dispositif prévu par la loi Climat et Résilience.
La complexification de la notion même d’artificialisation
Outre des critères excessifs incompatibles avec l’objectif ZAN, la proposition de loi appauvrit également la notion de zones non-artificialisée. Elle propose de considérer comme non artificialisées les surfaces végétalisées à usage résidentiel, secondaire ou tertiaire (tels que les parcs urbains, les jardins privés etc…). Dans le cas où elles seraient finalement artificialisées, au sens de recouverte par du bâti ou une couche minérale, cette artificialisation ne serait pas comptabilisée dans l’objectif ZAN.
La définition des surfaces non-artificialisées est déterminante dans l’atteinte de l’objectif ZAN, et cette disposition en est l’illustration. Si aujourd’hui les surfaces végétalisées à usage résidentiel, secondaire ou tertiaire participent au maintien du cadre de vie, notamment au sein des îlots de chaleur, elles n’ont cependant pas de comparaison avec d’autres types de surface qui sont plus fournies écologiquement et ont des fonctionnalités plus riches pour la biodiversité.
Reconnaître ce type de surface comme étant non-artificialisé, c’est ouvrir la porte à des opérations de renaturation considérées comme suffisantes (4), malgré la faible valeur écologique d’une pelouse, à titre d’exemple. La notion de renaturation devient alors dénuée de sens, et le concept même d’artificialisation nette se retrouve vidé de sa substance.
Quand bien même cette disposition ait pour objectif de conserver ces espaces naturels au sein des villes dans le contexte de la densification, le code de l’urbanisme (5) garantit d’ores et déjà que tout ouverture à l’urbanisation d’ENAF (espaces naturels, agricoles, et forestiers) a soit justifiée par une étude de densification des zones déjà urbanisées. Le zonage PLU, le contrat ORE, sont des outils permettant également une protection de ces espaces.
Ainsi cette disposition est injustifiée, mais permet de relever la faiblesse de la dualité de la définition de l’artificialisation dans la loi Climat et Résilience : tous les ENAF n’ont pas la même valeur écologique, et il conviendrait de les distinguer en fonction de ces données (une pelouse n’est pas aussi riche en biodiversité, qu’un bois).
Les lacunes de la proposition de loi s’agissant de la renaturation des sols
La renaturation est reléguée à la fin de la proposition de loi, dont les rédacteurs auraient dû saisir l’opportunité pour affiner la définition du processus de renaturation. Cette dernière constitue une solution de repli imparfaite en cas d’artificialisation, puisqu’il est difficile, voire illusoire, de considérer que renaturer un autre espace peut compenser la perte d’un sol aux fonctionnalités écologiques importantes et pérennisées.
L’enjeu est d’éviter que des mesures de renaturation soient considérées valides sans qu’il soit scientifiquement établi que ce processus permette une restauration équivalente à la biodiversité détruite par l’artificialisation entreprise.
Le bon état écologique des sols s’envisage sur le long terme, contrairement à la vision court-termiste du processus de renaturation en compensation de l’artificialisation. L’absence d’artificialisation d’un sol qui remplit des fonctionnalités écologiques est plus important pour la biodiversité et le climat que l’amélioration d’un sol, qui apportera moins à ces enjeux.
Des mesures provisoires permettant dès maintenant la poursuite de l’objectif ZAN
Malgré un certain nombre de dispositions risquant de porter atteinte à l’essence même de l’objectif ZAN, il est important de saluer une initiative permettant aux collectivités territoriales d’amorcer, dès à présent, la poursuite de cet objectif.
En effet, le texte propose d’instaurer un droit de préemption sur les biens et les droits immobiliers contribuant à la préservation de la nature en ville, ou présentant un potentiel fort en matière de renaturation ou de recyclage foncier.
Ce dispositif doterait les communes ou les EPCI de la possibilité de se substituer à l’acquéreur d’un bien ou d’un terrain au titre de la lutte contre l’artificialisation d’espaces naturels. L’application de ce droit de préemption est soumise au classement en zone de préemption de la zone concernée, ce au sein du document d’urbanisme en vigueur (SCOT, PLU ou carte communale).
En l’attente de l’intégration dans les documents d’urbanisme des dispositifs d’atteinte de l’objectif ZAN, la proposition de loi prévoit la possibilité pour les communes ou les EPCI de surseoir à statuer sur les demandes d’urbanisme qui sembleraient aller à l’encontre de la lutte contre l’artificialisation des sols.
Ces prérogatives permettraient de doter les collectivités territoriales de prérogatives permettant une meilleure prise en compte des enjeux de l’artificialisation à une échelle locale. Ces mesures ont pour avantage de pallier l’inquiétude des collectivités de perte de leurs prérogatives à cause du dispositif ZAN, sans pour autant dénaturer cet objectif.
Notes :
(1) : France Stratégie, “Objectif « Zéro artificialisation nette » : quels leviers pour protéger les sols ?”, Juillet 2019
(2) : L’artificialisation nette désigne le solde entre l’artificialisation et la renaturation
(4) : La loi climat et résilience définit elle-même la notion : « La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé. » (article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme)
(5) : Art. L. 151-5, 2°, code de l’urbanisme : “Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153-27.”