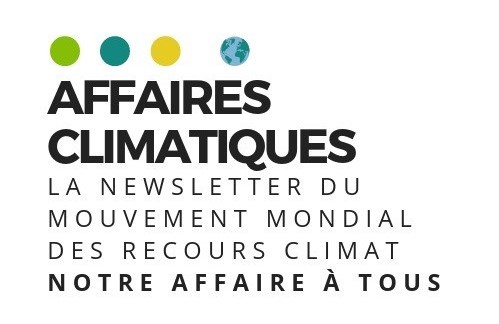Chers lectrices, chers lecteurs,
Ce n’est pas la première fois que nous évoquons la question de la protection du droit à un environnement sain dans notre lettre de diffusion. Dans cette treizième lettre, nous avons le plaisir de partager avec vous les notes écrites du webinaire que nous avons organisé quelques jours avant l’adoption par le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU d’une résolution reconnaissant le droit universel à un environnement sain. Ce webinaire a permis à des spécialistes de la question de dresser un panorama clair de l’historique et des enjeux d’une telle reconnaissance.
Dans cette lettre, nous vous proposons également, un podcast sur les suites de l’Affaire Grande-Synthe, puisque dans sa décision de juillet, le Conseil d’Etat devait déterminer si, oui ou non, il était nécessaire de prononcer des injonctions à l’encontre de l’Etat français, en matière de contentieux climatique.
Comme à l’accoutumée, vous retrouverez les contributions de nos bénévoles sur l’actualité du contentieux climatique et environnemental en France et dans le monde.
Si vous êtes juriste et souhaitez, vous aussi, contribuer à notre lettre de diffusion, n’hésitez pas à nous contacter sur l’adresse email suivante : sandycassanbarnel@gmail.com.
Bonne lecture et très bonnes fêtes de fin d’année!
Sandy Cassan-Barnel
Référente groupe veille-international Naat.
FOCUS : Webinaire sur les enjeux de la reconnaissance du droit à un environnement sain
Le 8 octobre 2021, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a, pour la première fois, reconnu que le fait de disposer d’un environnement sain, propre, sûr et durable, était un droit humain universel. « Cette résolution historique constitue un tournant majeur dans les efforts que l’humanité doit déployer pour traiter de la crise climatique et environnementale », commentait alors David Boyd, rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et l’environnement.
À quelques jours du vote pour l’adoption de cette résolution, et alors que 850 organisations de la société civiles, mouvements sociaux, communautés locales, et peuples indigènes adressaient une lettre au Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies demandant la reconnaissance de ce droit, Notre Affaire à Tous organisait un webinaire sur le droit à un environnement sain. Vous pouvez désormais retrouver les notes écrites de cet éclairage en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Pour en discuter et afin de saisir tous les enjeux d’une telle reconnaissance, nous avons accueilli Grâce Favrel, avocate et bénévole du groupe international de Notre Affaire à Tous, Roxane Chaplain, assistante parlementaire de la députée européenne Marie Toussaint et membre de Notre Affaire À Tous ; Hélène Tigroudja, professeure de droit international public et membre du Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies ; Sébastien Duyck, juriste du Center for International Environmental Law ; Michel Tabbal, chargé de mission questions internationales à la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme ; et Maria-Isabel Cubides, chargée de mission à la fédération internationale pour les droits humains.
AFFAIRES CLIMATIQUES
Affaire du siècle, l’Etat condamné à réparer son préjudice écologique
Le 14 Octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rendu une seconde décision historique dans l’Affaire du Siècle, après trois années de mobilisation, le soutien de 2,3 millions de personnes, et une première décision rendue en février 2021, reconnaissant la responsabilité climatique de l’État. Désormais, l’État français sera dans l’obligation d’agir de manière rapide et concrète dans la protection du climat.
En effet, si l’Etat est désormais juridiquement contraint de respecter sa trajectoire de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, la France est également condamnée à réparer les conséquences préjudice écologique dont elle est responsable sur la période 2015-2018 au plus tard le 31 décembre 2022 !
Affaire Grande-Synthe : une décision historique
Située sur le littoral Nord et particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, la Commune de Grande-Synthe a d’abord demandé à l’État d’adopter les mesures nécessaires pour lutter contre la crise climatique. Faute de réponse des intéressés, la Commune a ensuite formé une recours en excès de pouvoir contre les décisions implicites de rejet de ses demandes.
Dans une décision historique, le juge administratif prononce l’annulation de ces décisions et ordonne l’édiction des mesures nécessaires pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français avant le 31 mars 2022. Loin d’être anodine, cette date vise à faire de la question climatique un débat primordial lors des élections présidentielles d’avril 2022.
Cour constitutionnelle allemande : la loi fédérale pour la protection du climat est jugée illégale
Des citoyens et associations ont contesté la constitutionnalité de la loi pour la protection du climat de l’État fédéral allemand prise en 2019 pour violation de leurs droits fondamentaux.
Cette loi votée le 12 décembre 2019 prévoyait que le pays soit neutre en carbone en 2050 mais que les émissions ne soient réduites que de 55 % en 2030 (par rapport à 1990).
La Cour constitutionnelle allemande a censuré la loi en accueillant partiellement les arguments des demandeurs.
Cour européenne des droits de l’Homme : le recours des "aînées"
Une association de femmes seniors luttant pour l’environnement ont demandé aux tribunaux suisses de constater l’insuffisance des mesures prises par la Suisse pour réduire les émissions de gaz à effet de serre conformément à l’accord de Paris et de conclure à l’illégalité des carences de l’Etat.
Cette requête invite la Cour de Strasbourg à prendre position sur la marge d’appréciation devant être laissée aux Etats en matière climatique.
Affaire Total : la tentative ratée d’une exception d’incompétence
Dans le cadre d’un recours en défaillance du plan de vigilance de Total par cinq associations et quatorze collectivités territoriales, la société Total a soulevé une exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire, et demande que l’affaire soit portée devant le tribunal de commerce.
Le Tribunal judiciaire rejette la demande d’exception d’incompétence matérielle opposée par Total et se déclare compétent pour statuer sur le litige.
Équateur : le recours de la Communauté Waorani contre PetroOriental
La Cour Provinciale de Justice d’Orellana en Equateur rend un jugement défavorable en 1ère instance à l’action intentée par la communauté autochtone Waorani de Miwaguno, avec l’aide de plusieurs associations telles que la FIDH, contre la compagnie pétrolière chinoise PetroOriental.
La Cour expose que les preuves apportées sont insuffisantes pour démontrer l’existence d’un dommage causé au droit de la Nature et des peuples indigènes.
AFFAIRES ENVIRONNEMENTALES
Retour sur le recours People vs Arctic Oil
Après l’attribution de licences de prospection et d’extraction pétrolière en mer de Barents par le gouvernement norvégien, une coalition de particuliers et d’associations environnementales saisit le tribunal de district d’Oslo, au motif que la délivrance de ces titres viole l’Accord de Paris.
Confrontée au rejet du Tribunal, la coalition saisit la Cour de Strasbourg sur le fondement du droit à la vie, protégé par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi que le droit à la vie privée, prévu par son article 8.
Cette affaire en dit long sur la reconnaissance d’un droit global à un environnement sain.
Recours de la LPO contre des entreprises productrices de néonicotinoïdes
Le 21 mai 2021, la ligue pour la protection des oiseaux a assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon plusieurs entreprises de l’industrie des produits phytopharmaceutiques en vue de faire cesser toute commercialisation de produits contenant de l’imidaclopride, un pesticide de la famille des néonicotinoïdes.
La LPO souhaite aussi faire reconnaître et réparer le préjudice écologique (déclin des oiseaux des populations d’oiseaux des milieux agricoles notamment) causé par ces produits.
Commune de Malakoff : un arrêté anti-pesticide (encore) annulé par le juge administratif
Par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annule un arrêté de la mairie de Malakoff visant à restreindre l’usage des pesticides sur le territoire de la commune, au motif que l’existence d’une police spéciale en matière de produits phytopharmaceutiques, confiée aux autorités de l’Etat, fait obstacle à l’exercice par le maire des ses pouvoirs de police générale, y compris ses pouvoirs au titre de la police des déchets.
Recours de FNE pour un encadrement effectif de l’usage des pesticides
Par cet arrêt, le Conseil d’Etat juge que les dispositions réglementaires en vigueur ne permettent pas de garantir que l’utilisation de pesticides sera systématiquement encadrée voire interdite dans les sites terrestres Natura 2000, en méconnaissance des exigences de la directive du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
Première affaire sur les droits de la nature aux Etats-Unis
L’action, engagée par le président d’une association locale de défense de l’environnement, est fondée sur les dispositions de la Charte du comté d’Orange (Floride) adoptées en novembre 2020, qui reconnaissent expressément le droit des eaux et rivières du comté d’exister, de s’écouler, d’être protégées contre la pollution et de maintenir un écosystème sain.
Elle est dirigée contre un projet de développement résidentiel et commercial de plus de 1900 hectares impliquant la destruction de centaines d’hectares de zones humides et la dégradation de plusieurs rivières.
Affaire du collectif des maires anti-pesticides
Les nouvelles règles d’épandage des pesticides en agriculture prises par le Gouvernement fin 2019 ont de nouveau été contestées devant le Conseil d’État.
Par cette décision, le Conseil d’État ordonne au Gouvernement de compléter la nouvelle réglementation sous 6 mois : les distances minimales d’épandage doivent être augmentées pour les produits qui ne sont que « suspectés » d’être cancérogènes, mutagènes ou toxiques ; des mesures doivent être prises pour protéger les personnes travaillant à proximité ; et une information des riverains doit être organisée en amont de l’utilisation de ces produits.
Recours de l’Association Générations futures contre l’épandage de pesticides
À l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par l’Association Générations Futures, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’article L.253-8 du code de l’environnement, subordonnant à des mesures de protection des riverains l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité d’habitations, ces mesures étant définies dans des chartes d’engagements départementales, après concertation entre les utilisateurs des produits et les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées.
Recours de Bayer contre l’interdiction de l’utilisation des néonicotinoïdes
Par cet arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne confirme que la Commission européenne était en droit d’interdire l’utilisation des néonicotinoïdes sur les cultures attractives pour les abeilles, sur le fondement du principe de précaution et même en cas d’incertitude.
Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’un pourvoi contre un jugement du Tribunal de l’Union européenne rejetant la demande d’annulation de Bayer contre un règlement d’exécution de la Commission européenne, adopté à l’issue du réexamen de deux substances actives de la famille des néonicotinoïdes, restreignant considérablement les possibilités d’utilisation de celles-ci.
L’ambition de cette newsletter ? Donner les moyens à toutes et tous de comprendre les enjeux de telles actions en justice face à l’urgence climatique ! Abonnez-vous pour recevoir, chaque mois, les actualités et informations sur ces affaires qui font avancer, partout dans le monde, nos droits et ceux de la nature face aux dégradations environnementales et climatiques : le combat qui se joue dans les tribunaux est bien celui de la défense des pollués face aux pollueurs, nouvel enjeu du XXIe siècle