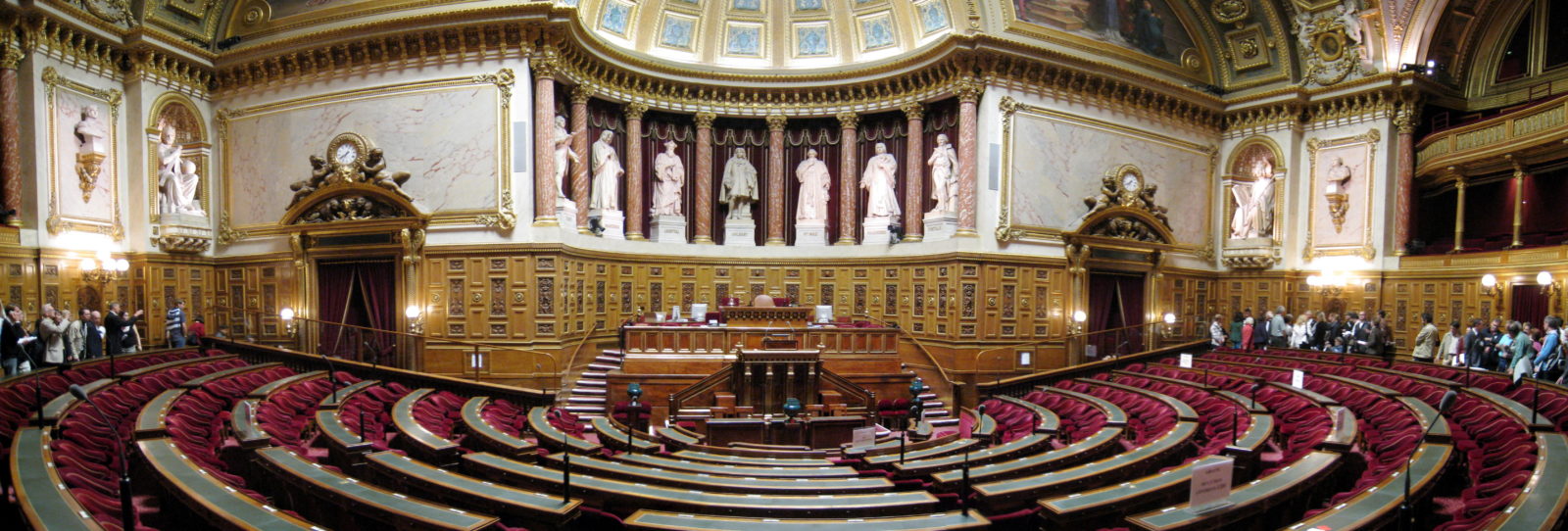26 mars 2018, le journal Le Monde nous annonce que la France est enfin passée en 2017 sous les 3% de déficit public. Et pourtant, nous sommes plus déficitaires que jamais…
Les rapports rendus lors de la 6ème session de l’IPBES, l’organe scientifique et technique pour la biodiversité qui s’est réuni du 17 au 24 mars à Medellin en Colombie, nous ont à nouveau alerté sur l’important déclin de la biodiversité mondiale que nous sommes en train de connaître. Nous consommons plus de ressources naturelles que la terre ne peut en produire.
Sur les quatre grandes zones géographiques du monde, seule l’Amérique du sud paraît relativement épargnée avec un bilan consommation/existence des ressources positif, alors que les 3 autres zones (l’Afrique, l’Asie-Pacifique et l’Europe-Asie Centrale) sont déficitaires. Les rapports appellent ainsi à plusieurs réactions afin d’enrayer ce déclin :
👉 Valoriser la contribution immatérielle de la diversité biologique : c’est le sens de l’approche par services écosystémiques défendue dans les différents rapports de l’IPBES, approche qui permet d’évaluer les contributions de la nature au développement des populations de manière chiffrée. Ainsi pour l’Europe et l’Asie Centrale, la valeur médiane estimée de la valeur économique des contributions immatérielles de la nature aux populations est estimée à 1117 $ par hectare et par an.
Pour rappel, la Convention sur la diversité biologique (UN, 1992) inscrit clairement les Etats qui y sont parties, dès son article 1er, dans un objectif d’utilisation durable de la diversité biologique. A une autre échelle, la déclaration de Rio (UN, 1992) reconnaît au niveau international l’interdépendance des humains avec les espèces qui l’environnent. Elle nous invite à penser la biodiversité comme le socle de toutes nos existences tant physiologiques que culturelles.
👉 Agir sur nos modes de production et de consommation : les rapports de l’IPBES mentionnent explicitement que cette disparition de la biodiversité est en lien direct avec les méthodes de l’agriculture productiviste et encouragent dans le même temps le maintien et le développement d’une utilisation « traditionnelle » des terres, en lien avec les populations autochtones et locales.
Pour rappel, la Convention sur la diversité biologique (UN, 1992), reconnaît au niveau international à son article 8j la nécessité de préserver et maintenir les modes de vies traditionnels qui représentent un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité.
👉Développer et maintenir des zones protégées : les rapports nous alertent sur la réduction globale des surfaces des zones dédiées à la conservation des espèces et de leurs habitats. C’est pourtant un des outils les plus efficaces pour protéger la biodiversité, en plus bien sûr d’apprendre à vivre avec elle de manière plus respectueuse et durable.
Pour rappel, la Convention sur la diversité biologique (UN, 1992), reconnaît au niveau international à son article 8 la nécessité pour les Etats de développer des zones protégées afin de préserver les écosystèmes. Elle rejoint en cela d’autres conventions plus ciblées comme la Convention de Ramsar sur les zones humides (UN, 1971).
👉Construire une politique environnementale « intégrée » : les rapports de l’IPBES rappellent quasiment unanimement que la biodiversité mondiale est notre première arme pour lutter contre les grandes catastrophes environnementales, dont le réchauffement climatique. Le Docteur Anne Larigauderie, secrétaire exécutive de l’IPBES le résume ainsi : « Des écosystèmes plus riches et plus diversifiés sont plus à même de faire face aux perturbations – telles que les événements extrêmes ou l’émergence de maladies. Ils sont notre police d’assurance contre les catastrophes imprévues et, utilisé de manière durable, ils offrent également plusieurs des meilleures solutions à nos défis les plus urgents ». Il est donc nécessaire de prendre en compte à tous niveaux dans toutes nos politiques publiques, les avantages et les risques pour la biodiversité.
Pour rappel, les objectifs d’Aïchi pour la diversité biologique (UN, 2010) et les objectifs de développement durable (UN, 2015) tracent déjà les grandes lignes d’une politique environnementale « intégrée ».
Dès 1970, lors de la conférence environnementale mondiale de Stockholm, les États étaient alertés sur les menaces qui pesaient sur la biodiversité et délivraient de premiers engagements sur la voie de la résilience écologique. Plus de 50 ans après, alors même que nous avons développé des instruments politiques, juridiques et scientifiques à même de nous permettre de mettre en oeuvre des solutions efficaces, nous n’avons toujours pas su prendre la mesure de l’urgence. Il est plus que temps de s’y mettre !
Article écrit par Pierre Spielewoy, référent du Groupe de Travail Juristes de Notre Affaire à Tous